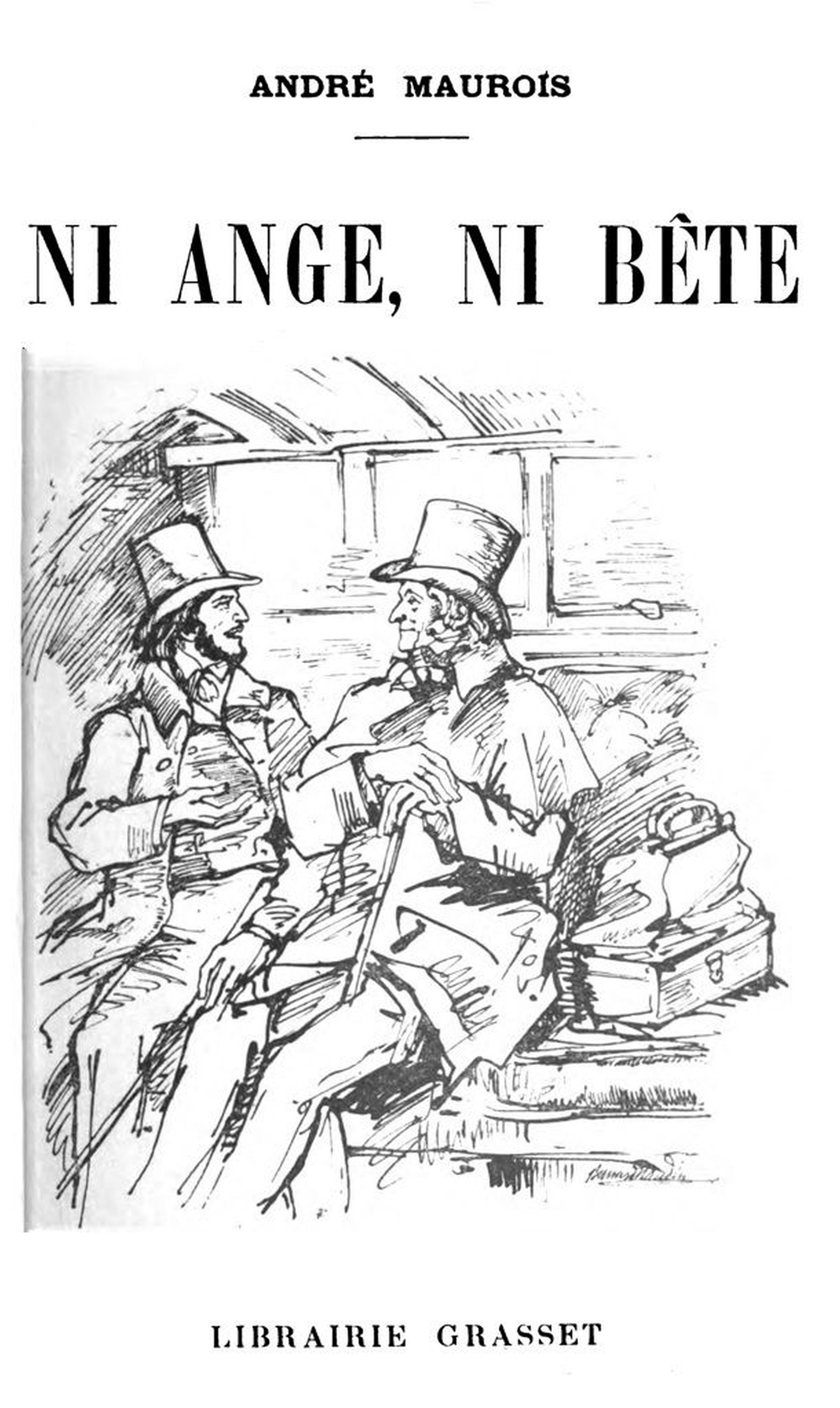
The Project Gutenberg EBook of Ni ange, ni bête, by André Maurois This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Ni ange, ni bête Author: André Maurois Release Date: September 23, 2020 [EBook #63271] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NI ANGE, NI BÊTE *** Produced by Laura Natal Rodrigues at Free Literature (Images generously made available by Hathi Trust.)
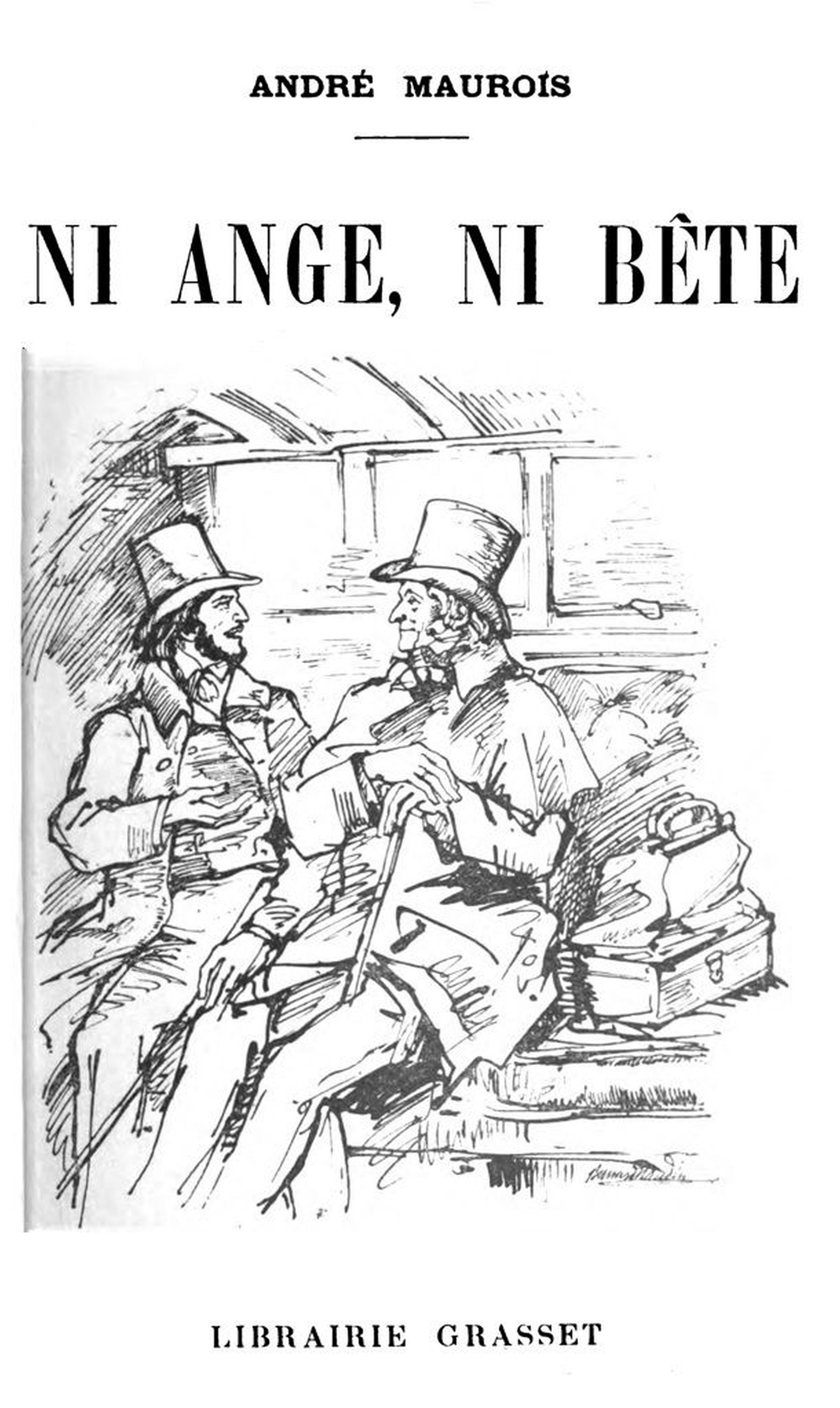
Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction réservés pour tous pays
Copyright by André Maurois, 1919
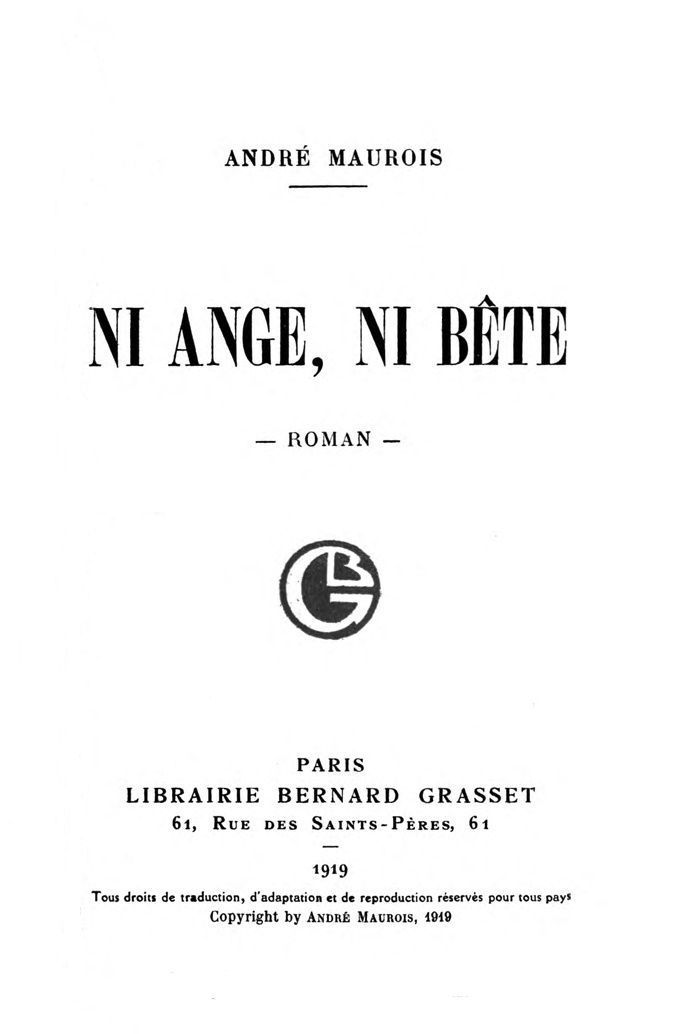
PREMIÈRE PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
DEUXIÈME PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
TROISIÈME PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Pour devenir un parfait
philosophe, il me manquait
surtout une passion, à la
fois profonde et pure, qui
me fit assez apprécier le
côté affectif de l'humanité.
Auguste Comte.
Au temps où le roi Louis-Philippe régnait sur les Français, M. Bertrand d'Ouville, rentier et archéologue abbevillois, revenant un matin d'Amiens en diligence, se trouva seul dans la voiture avec un jeune homme grave et barbu, dont le chapeau en tronc de cône et le gilet à la Robespierre proclamaient assez naïvement les opinions républicaines.
—Excusez-moi, monsieur, dit le vieillard, dès qu'ils eurent franchi le pavé bruyant des faubourgs, ne seriez-vous pas le nouvel ingénieur de l'arrondissement d'Abbeville?
—Oui, monsieur, dit l'autre, très surpris, et examinant sans bienveillance ce petit homme à la voix précieuse.
—Ce n'est pas par curiosité, croyez-le, que je me suis permis de vous interroger. Je m'occupe d'archéologie, mes recherches me mettent en rapports assez fréquents avec vos services et j'attendais votre arrivée. Je me nomme Bertrand d'Ouville.
Le jeune homme salua et dit sèchement: «Philippe Viniès». La redingote doctrinaire, le haut col de velours noir lui inspiraient une méfiance sévère.
—Vous paraissez très jeune, reprit le vieillard, croisant lentement ses jambes maigres, vous venez sans doute de sortir de l'École?
—Oui, monsieur; Abbeville est mon premier poste.
—J'espère que vous vous y plairez. La société y est, sottement à mon avis, très fermée aux fonctionnaires. Mais j'avais fait ouvrir à votre prédécesseur quelques maisons agréables. Un ingénieur n'est pas un préfet, et pourvu que vous ne parliez ici ni de religion, ni de science, ni d'art, ni de politique...
—Je vous remercie, monsieur, dit le jeune homme avec effort, mais je dois vous dire en toute franchise que mes opinions sont fort avancées. J'ai dû accepter un poste du gouvernement du Roi: je sais que cela m'oblige à ne point conspirer, mais cela me laisse le droit de dire ma pensée, ce qui me fera, je pense, peu d'amis.
Philippe Viniès, après ce petit discours, toussa légèrement et regarda le vieillard d'un air assez fier.
—Hélas! dit celui-ci avec humilité; il faut avouer que notre bonne ville n'entend rien aux révolutions. Nos pères y mirent jadis tant de négligence qu'ils ne guillotinèrent personne, et n'auraient même jamais arrêté un ci-devant si la Convention, émue de ce scandale, n'avait envoyé à Abbeville un représentant en mission. Comme il paraissait brave homme, on consentit, pour lui faire plaisir, à emprisonner deux nobles et un prêtre. On dut attendre son départ pour les remettre en liberté, mais pendant les quinze jours que dura leur détention, le geôlier ne manqua pas un soir de les autoriser à coucher chez eux.
—Vous admirez cette tiédeur, monsieur? dit Philippe Viniès avec quelque âpreté. Si vous ne veniez de m'apprendre vous-même qu'il ne faut pas ici parler de politique...
—Distinguons, monsieur, coupa le vieux provincial de sa voix mesurée et satisfaite; tout ce que nous vous demandons, c'est de ne jamais mettre en danger la sécurité de notre bonne ville. Rien de plus. Soyez d'ailleurs légitimiste à Londres, républicain à Paris; dites, si cela vous divertit, du mal de tous les gouvernements, mais qu'Abbeville sache bien clairement que vous obéirez à tous.
«Si vous le permettez, je vais déjeuner.»
Et M. Bertrand d'Ouville tira d'un panier une aile de poulet, du pain et du vin blanc: Philippe Viniès développa une grappe de raisin qu'il se mit à picorer.
—Puis-je vous offrir un peu de poulet, dit le vieillard: ma cuisinière me charge toujours de vivres comme pour un escadron.
—Je vous remercie, je me nourris presque exclusivement de fruits et de laitage.
—Par hygiène?
—Non, par principe, par goût et par habitude.
Le vieillard sourit et resta enfin silencieux; les cahots de la patache endormirent les deux hommes.
*
* *
Quand Philippe se réveilla, il vit que son compagnon mettait de l'ordre dans son sac.
Sous la brume bleutée qui dessinait au long des coteaux la vallée marécageuse de la Somme, on devinait maintenant la petite ville, bien assise au milieu des campagnes vassales. Les pentes des ravins et les courbes des routes convergeaient vers la masse indécise de ses toits bleus. Sur le ciel gris pâle et rose du couchant, deux belles églises se détachaient, spirituelles et vigoureuses.
«Saint-Vulfran, Saint-Gilles, dit l'archéologue avec tendresse. Vous verrez dans vos tournées que le culte des saints locaux est très vivant dans ce pays et que leurs reliques y font encore des miracles, comme il convient en bon pays d'agriculteurs. Le monothéisme est une religion de bergers nomades qui veulent retrouver partout leur Dieu, mais chez nous le même arbre a porté successivement les fétiches et les images sacrées: nos Picards n'aiment pas changer leurs habitudes.»
Ils dépassèrent quelques constructions isolées et neuves qui jalonnaient un quartier nouveau, puis longèrent une vieille rue tortueuse aux maisons de bois ventrues. Sur le pas des portes les marchandes bavardes avaient le nez robuste et les grosses joues des bonnes femmes sculptées jadis sur les têtes de poutres de leurs maisons.
«Ici, dit Bertrand d'Ouville, les bourgeois sont plus nobles que les nobles. Certains commerces ont été exercés par la même famille depuis le douzième siècle. Vous serez certainement frappé par la dignité de nos boutiquiers. Ils sont polis, mais nullement obséquieux. Si vous désirez un objet qu'ils n'ont point, ne leur demandez pas de le faire venir de Paris, ils vous diront de l'aller chercher vous-même. S'ils le possèdent, c'est à vous de le découvrir dans le magasin.
«Leur commerce est un culte familial qu'ils se transmettent de père en fils; il est juste qu'ils s'étonnent lorsqu'un étranger prétend se mêler à ces jeux sacrés.»
La diligence tourna brusquement à droite et s'arrêta sur une place bordée de hautes demeures aux lignes simples et solennelles.
—Nous voici arrivés, dit le vieillard, vous trouverez ma maison dans la rue des Minimes. Je compte que vous viendrez me voir: je suis grand marcheur et toujours prêt à vous accompagner. Adieu.
Philippe Viniès murmura quelques mots polis et, resté seul, chercha des yeux le bureau des messageries pour s'enquérir d'un hôtel.
Devant une épicerie une vieille femme, appuyée sur une canne, regardait ce personnage nouveau et, le voyant hésiter, s'approcha, curieuse et empressée.
—Vous cherchez quelqu'un, dit-elle.
—Je cherche un hôtel.
—Ah! c'est vrai, dit-elle avec un sourire satisfait, vous êtes le nouvel ingénieur.
—Diable, pensa Philippe, quelle police.
—L'hôtel de la Tête de Bœuf est rue Saint-Gilles: c'est à deux pas, dit-elle, mais puisque vous êtes pour rester, il vaudrait mieux prendre une chambre en ville. Cela vous coûtera moins cher et vous serez mieux. Il y en a une chez le Général, libre d'hier... Là vous serez bien.
—Chez le Général? dit Philippe inquiet. Ah! non, certainement; j'aime mieux l'hôtel.
—À votre aise, dit l'épicière vexée: en ce cas, Jalabert va vous y conduire... Jalabert!
Philippe vit arriver au pas de course un vieil homme à cheveux gris qui debout au milieu de la place depuis l'arrivée de la diligence avait suivi la scène avec intérêt. En arrivant devant l'ingénieur, il fit claquer ses talons, salua militairement avec vigueur et s'empara de la valise.
—Jalabert, conduis monsieur à la Tête de Bœuf... Faites pas attention à ce qu'il dit, ajouta-t-elle, il est un peu fou. Mais il connaît bien la ville: c'est lui qui la montre aux Anglais.
Philippe Viniès suivit son guide au long des vieilles rues. Quelques passants s'en allaient d'un pas très lent, le nez au vent, les mains dans les poches.
—Belle place, Milord, dit le vieux soldat, belles maisons, bâties par les Anglais...
—Comment, par les Anglais? dit Philippe surpris.
—Yes milord..., à droite, l'Hôtel de Ville, belles tours, belles statues, sculptées par les Anglais... Ici belle fontaine, bonne eau pour l'estomac, et devant vous, milord, bel hôtel, belles chambres, construit pour les Anglais... Yes Milord.
Philippe, découvrant en effet l'enseigne de la Tête de Bœuf congédia généreusement son porteur qui recula de trois pas, fit le salut militaire et cria:
—Merci, Milord... Et vive le 106e! Vive le Colonel Achard! Vive la Duchesse de Berry!
—Ah! fit la patronne de l'hôtel qui, comme tout le monde, était devant sa porte, Jalabert vous a découvert. C'est un vieux malin. Il connaît bien les Anglais, allez.
—Mais je ne suis pas Anglais, dit Philippe.
—Ah! mais, c'est vrai, dit-elle, vous êtes le nouvel ingénieur. Et pourquoi voulez-vous descendre dans mon hôtel? Vous qui êtes pour rester, prenez une chambre en ville, cela vous coûtera moins cher et vous serez mieux... Tenez, allez donc chez le Général. Il en a une libre d'hier.
Et cette hôtelière vraiment Abbevilloise fit accompagner par son garçon d'écurie cet étranger qui avait prétendu occuper, pour de l'argent, une des chambres à l'entrée desquelles elle veillait avec un soin religieux et jaloux.
Philippe Viniès à Lucien Malessart
rédacteur au journal «La Réforme», à Paris.Abbeville, le 15 Octobre 1844.
Je te recommande bien vivement, mon bon vieux, le brave réfugié polonais qui te portera cette lettre. Réponds-moi chez le général Pitollet, rue du Pont-à-Plisson, et ne t'épouvante pas. Ce général est tout simplement un honnête cabaretier, qui a connu trois mois de gloire au temps de la Révolution.
Ses camarades qui le trouvaient bel homme l'avaient choisi pour colonel et comme il ne savait pas lire, il s'était adjoint son curé. Celui-ci fit preuve aussitôt d'un génie robuste et militaire, et Pitollet, dont les rapports étonnaient Carnot, venait d'être promu général, quand par malheur le curé mourut. Le général un peu plus tard demanda modestement une place de tambour-major; Bonaparte le fit sous-lieutenant.
C'est aujourd'hui un beau vieillard, droit comme une baïonnette et sourd comme un tambour. Sa petite-fille Clotilde tient la maison, et j'occupe chez eux une chambre assez coquette:
Où dans un coin obscur près de la cheminée,
Quatre épingles au mur fixent Napoléon.Ah! ce Bonaparte, mon cher... Nous imaginions mal ce qu'il est pour ces provinces. Le soir, autour de la table, où se dessèche une rose cueillie à Sainte-Hélène, des vieillards épiques évoquent leurs campagnes; Clotilde, sur un coussin brode le Retour des Cendres; j'écoute, je rêve, je compare le règne des bourgeois à l'empire des braves, et moi qui hais la guerre et les soldats, moi qui crois à la République universelle des peuples, je trouve quelque plaisir à entendre parler d'actions et d'affaires qui étaient des coups de sabre et non des coups de bourse.
Pour des républicains avoués, je ne crois pas, hélas, qu'il y en ait ici. Les jeunes gens qui mangent avec moi chez Pitollet sont des clercs de notaire, élevés à Paris, assez libéraux, mais fort occupés de gaudrioles et de calembours et vraiment trop gais pour être vertueux. Les professeurs du collège sont des commerçants comme les autres qui vendent trente ans leur rhétorique, puis se retirent des affaires et meurent en bourgeois. Quant aux ouvriers je fais ce que je puis pour me rapprocher d'eux, mais on ne sait où les trouver car ils n'ont ni société, ni chefs. Leur misère est affreuse.
Beaucoup d'entr'eux travaillent chez ce Bresson pour lequel tu m'avais donné une lettre d'introduction. Il se dit ami de Ledru-Rollin. Entre nous, je ne l'aime guère: c'est le type du mauvais bourgeois, gras et important. Deux passions se disputent son cœur médiocre: l'amour du calme que lui inspire son commerce et le désir du mouvement que nourrit sa vanité. Il ne pardonne pas au Gouvernement de ne pas lui avoir donné la croix.
Un seul homme ici m'a fait bon accueil, Bertrand d'Ouville, l'archéologue. C'est un petit vieillard assez fat, très intelligent, tout à fait dépourvu de foi, d'enthousiasme et de vertu. Il vendrait son âme pour une jolie phrase et, je crois bien, pour une jolie femme. Je le vois cependant assez souvent car il me recherche, je ne sais pourquoi, et je trouve chez lui une admirable bibliothèque. Demain dimanche il prétend m'emmener au château d'Epagne, chez une mystérieuse vieille fille qui, dit-il, a été fort belle et que tout Abbeville appelle Mademoiselle, avec un grand M. J'irai peut-être, car il faut tout voir: mais sois bien tranquille, ces châteaux-là ne me tourneront pas la tête.
Je deviens ici de plus en plus communiste et adversaire enragé de la civilisation mercantile: croirais-tu, mon vieux, qu'à Abbeville il y a huit notaires, trois huissiers, cinq ou six chapeliers, vingt papetiers et un nombre infini de cabaretiers, tout cela pour un peu moins de vingt mille habitants, qui presque tous passent leur vie à s'attendre les uns les autres au fond d'une boutique obscure. Cabet a raison: le commerce est un vice. Les sots et les méchants peuvent rire de son livre, mais si folle que soit son Icarie, elle l'est moins que ce système-ci.
Adieu, mon bon vieux, écris-moi: salut et fraternité.
Le salon de Mademoiselle était d'une simplicité voulue et délicate. Sur les murs tapissés d'un papier gris uni se détachaient nettement deux crayons de Clouet. Les fauteuils étaient confortables, la lumière faible et douce. On sentait la chambre accueillante: un peu trop, disait M. de Vence, son voisin, qui était malveillant.
Mademoiselle se leva: elle était vaste, dans une ample robe de taffetas noir, et grasse, avec autorité et courage. L'empâtement du visage laissait encore deviner des traits réguliers et puissants.
«Je vous amène, dit Bertrand d'Ouville, M. Philippe Viniès, notre nouvel ingénieur, qui est jacobin, et mon ami.»
Les beaux yeux vifs de Mademoiselle se fixèrent sur Philippe avec une expression d'intelligente sympathie.
—Vous savez, dit-elle, que la politique ne m'intéresse pas et que vos amis sont bienvenus ici.
La voix était précise et flûtée: Philippe rougit et murmura quelques mots.
—Ce vieillard est insupportable, pensa-t-il, il me fait faire figure de sot.
Deux jeunes filles entrèrent; vêtues comme Mademoiselle de robes unies et amples, elles s'efforçaient évidemment de lui ressembler.
—M. Philippe Viniès... Mes filles: la blonde est Geneviève, la brune Catherine.
Catherine, aux yeux ardents, aux narines mobiles s'assit dans un fauteuil sur le bras duquel se posa Geneviève, et toutes deux regardèrent Philippe avec une franche curiosité. Il trouva aussitôt des phrases heureuses pour décrire son arrivée et les vieux grognards de son auberge.
«Je suis loin d'avoir le culte de la force, mais il y a quelque chose d'admirable dans tout sentiment profond et cette religion populaire m'émeut, je l'avoue...
—Vous allez vous entendre avec Geneviève, dit Mademoiselle, elle adore l'Empereur.
—Non, mademoiselle, vous savez bien que non. Je n'aime pas Napoléon: j'aime le mince général en habit rouge de la gravure de votre chambre...
—Le Bonaparte auquel est dédié la Symphonie héroïque, dit Philippe.
Elle eut pour lui un regard étonné et assez approbateur.
—Mes enfants, dit Mademoiselle, puisque M. Viniès semble aimer la musique...
Geneviève, s'accompagnant elle-même, chanta de vieux airs français: elle avait très peu de voix, mais un style net et beaucoup d'esprit. Bertrand d'Ouville regardait ses traits fins avec un plaisir évident. Puis Catherine chanta une romance de Schubert.
Philippe se rapprocha du piano et feuilleta des cahiers: les deux jeunes filles l'accueillirent, maternelles et protectrices. La forte poitrine de Catherine se soulevait doucement; Geneviève étudiait cet être nouveau avec une méfiance un peu moqueuse.
—Cette romance est très belle, dit-il.
—Schubert, dit Geneviève, me fait l'effet de ces bonbons turcs que rapporte mon cousin; c'est sucré au point d'être écœurant.
—Vous n'aimez pas le sentiment?
—Je ne sais pas: je n'aime pas Schubert.
Cependant Bertrand d'Ouville était allé s'asseoir près du fauteuil de Mademoiselle.
—Laissons ces jeunes gens parler d'eux-mêmes à l'abri des grands hommes, dit-il: que pensez-vous de mon petit ingénieur?
—Il est joli, comme un jeune prêtre romantique: je le crois intelligent.
—Il n'est pas sot mais les formules lui masquent la vie; il se bâtit un univers de petits systèmes rigides et voudrait que la nature se soumît aux lois de M. Viniès. Il a une théorie sur la Pologne, une sur l'amour, une sur le mariage, une sur le suffrage, une sur la communauté des biens, et pour chacune d'elles, il se dit prêt à prendre un fusil.
—J'aime assez cela: les hommes tournent toujours au fade assez tôt, dit Mademoiselle de sa voix flûtée et tranchante.
—Certes, dit Bertrand d'Ouville, s'il y a quelque chose au monde de plus ridicule qu'un radical en cheveux blancs, c'est un conservateur au maillot. Il faut peut-être qu'un homme soit anarchiste à vingt ans pour qu'il lui reste dix ans plus tard assez d'énergie pour faire un pompier. «Ça va mal: on chante la Marseillaise» disait le vieux Rouget de Lisle aux journées de Juillet.
Mais Viniès est bien compliqué: il est romantique, et il méprise les arts; il est matérialiste et il est chrétien. Et surtout il est inexact. Son esprit transforme les faits comme certains miroirs les objets. En le traversant, tout devient terrible, énorme, monstrueux. Il me raconte qu'il a rencontré chez le cabaretier Pitollet des vieillards épiques. Quand je me renseigne il s'agit de mon chapelier Pillet qui a fait dix ans pendant les Cent jours, et d'un vieux matelot de péniche qui était bien à Trafalgar, mais comme cuisinier de l'Amiral et n'y a vu que les feux de son fourneau. Notez que le lendemain ce même Pillet sera pour lui un «odieux parasite» parce qu'il vend des casquettes.
—Savez-vous ce qu'est sa famille?
—On m'a dit que ses parents sont des commerçants de Besançon, mais il n'en parle pas volontiers. Je crois comprendre qu'il s'est trouvé choqué par l'humilité professionnelle des siens et s'est déclaré jacobin à ces braves gens consternés... Sous l'Empire, il eût fait un brave sous-lieutenant.
Mademoiselle regarda le groupe des trois jeunes gens autour du piano. Philippe parlait vivement. Catherine l'écoutait, palpitante. Geneviève, les yeux baissés, respirait une fleur.
«Les femmes aimeront ce jeune homme, prononça Mademoiselle avec une sagesse satisfaite.
—Croyez-vous? Il les comprend bien peu, et les respecte trop pour essayer de les conquérir.
—Mais nous n'aimons pas les conquérants.
Bertrand d'Ouville, levant la main, sourit modestement.
—Oh! je sais, mon cher, vous avez eu des femmes: le beau mérite. Elles étaient faciles.
—Cela vous plaît à dire.
—J'en suis certaine: vous êtes beaucoup trop heureux pour qu'une femme aille perdre son temps à s'occuper de vous. Les cyniques de votre espèce n'ont nul besoin de tendresse.
«Vous dites que cet enfant ne comprend pas les femmes. Et vous, mon cher? Et les autres? Vous nous croyez romanesques: nous ne le sommes que pour vous faire plaisir. Sensuelles? Il y en a, mais moins que vous ne pensez. Ou alors au troisième amant, s'il est diablement adroit...
M. de Vence entra: il venait chaque dimanche chercher là Bertrand d'Ouville pour l'emmener au cercle faire une partie de whist. On lui présenta Philippe: il fut assez froid.
—Toute cette jeunesse semble bien animée, dit-il de sa voix des lèvres, hautaine et gouailleuse.
—M. Viniès nous parlait de Victor Hugo, dit Geneviève avec une moue comique.
—Ce Hugo, dit M. de Vence, est le petit-fils d'un menuisier de Nancy: il se fait appeler vicomte Hugo par la grâce de M. Joseph Bonaparte. Il change d'opinions politiques chaque fois que la France change de gouvernement: ce n'est pas peu dire.
—Cela n'empêche pas ses vers d'être bons, dit Mademoiselle.
—Ses vers? Je ne les lis pas, dit M. de Vence, je n'aime pas ces littératures décadentes... Allons venez au cercle, mon bon, il y a un membre du comité qui veut nous soumettre une idée.
—Viniès, dit Bertrand d'Ouville, je crois que vous avez raison et que la Révolution approche. Si le Comité du cercle d'Abbeville se met à avoir des idées...
—La Révolution, dit M. de Vence, elle est plus près que vous ne pensez. J'ai beaucoup à me plaindre de mes paysans. Je leur ai donné un curé que je paie, et une salle de billard pour les empêcher d'aller au cabaret. Ah! bien, oui: ils escaladent mes murs et volent le poisson de ma rivière.
Les trois hommes prirent congé. Philippe fut chaleureusement invité à revenir quand il le voudrait.
Quand ils furent sortis, Mademoiselle s'assit au piano et s'accompagnant fredonna, d'une voix étonnamment jeune:
Ô mon maître, ô mon seigneur,
Que le Diable vous emporte;
Avec gens de votre sorte
C'est folie que la douceur...
—Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de M. Viniès?
—Mademoiselle, dans les dix dernières minutes, il a dit six fois admirable, trois fois vertueux et quatre fois horrible. J'ai compté.
—Vous êtes une petite sotte: il me plaît beaucoup.
—Bien, mademoiselle, dit Geneviève.
Elle vint tumultueusement embrasser Mademoiselle, plaqua un grand accord dans les notes aiguës du piano et disparut en dansant.
Mademoiselle regardait avec une autorité amusée Catherine qui, très affairée, rangeait des cahiers de musique.
Bertrand d'Ouville vint chercher Philippe Viniès à son bureau pour l'emmener voir des traces d'une voie romaine dont ils avaient parlé la veille. Le temps était gris, mais honnête, temps d'Abbeville, médiocre et sympathique.
Philippe marcha silencieusement pendant deux minutes, puis toussa pour éclaircir sa voix.
—Qui sont, dit-il, les deux jeunes filles que nous avons vues hier à Epagne?
—Catherine Bresson est la fille de Bresson, le fabricant de tapis, que vous connaissez...
—Et elle ne vit pas chez ses parents?
—Si, mais Mademoiselle qui l'a découverte, je ne sais comment, lui sert de mère spirituelle. Elle passe à Epagne des semaines entières: c'est une petite fille assez belle qui aura, si je ne me trompe, des passions exigeantes. Elle a la poitrine bien placée, mais un peu grasse.
Philippe regarda avec surprise le vieillard qui continua:
—Geneviève de Vaulges est orpheline. Son tuteur l'a retirée du couvent à seize ans et Mademoiselle qui est sa cousine à la mode de Picardie s'est chargée de terminer son éducation. Les Vaulges étaient une des bonnes familles de ce pays-ci, mais le père de Geneviève les a sottement ruinés.
—Elle est assez jolie, dit Philippe avec détachement.
—Les archives d'Abbeville contiennent une histoire assez curieuse sur ces Vaulges. Il y a trois cents ans environ, un enfant nouveau-né fut retiré vivant de l'abreuvoir du Pont aux Poissons. On s'empressa de lui donner le baptême, puis on décida qu'il serait procédé sans retard à la visite de toutes les filles de la ville afin de découvrir celle qui avait donné le jour à un enfant et tenté de s'en défaire par un crime.
Donc, par devant un magistrat, on leur fit à toutes mettre à nu leurs mamelles pour atteindre la vérité du cas. Isabelle de Vaulges, ainsi examinée, fut reconnue coupable. Et comme elle refusa de livrer le nom de son complice, elle fut condamnée à être brûlée vive et subit sa peine sur cette place du Pilori que nous allons traverser.
—Quelle horrible histoire, dit Philippe.
C'était alors un événement de bien peu d'importance, dit le vieillard, mais j'ai toujours pensé que cette vaillante Isabelle avait les traits précis, les yeux bleu clair et les cheveux pâles de sa petite nièce qui nous chantait hier si joliment du Couperin.
Philippe regarda longuement la place du Pilori que bordaient des boutiques inoffensives.
—Mlle de Vaulges est très intelligente, dit-il.
—Croyez-vous? Ce serait surprenant: une jeune fille... Mais elle a le nez et la bouche les mieux ciselés de la province.
Ils passaient devant l'usine de Bresson: dans les bâtiments anciens, la machine à vapeur étonnait, comme un bourgeois de Daumier dans un décor classique.
Philippe parla de la misère des ouvriers et de l'absurdité du régime de propriété qui faisait riche un Bresson.
—Mon Dieu, dit le vieillard, il est bien certain que la propriété devra se transformer. Ce n'est pas un droit sacré, mais ce n'est pas un crime.
Vous semblez considérer notre civilisation comme un ténébreux complot de riches et de tyrans pour dérober aux peuples je ne sais quelles richesses naturelles... Non, c'est une solution qui, avec tous ses défauts, a été adoptée par les hommes après des siècles de tâtonnement. On peut la retoucher? Eh! comment ne pas le faire? Ces industriels, ces ouvriers, ces usines, nos redingotes et nos blouses, disparaîtront aussi certainement que les armures et les arquebuses, que les barons et les serfs. Mais il y faut du temps. On ne peut pas jeter la civilisation comme un livre qui a cessé de plaire.
—Qui parle, monsieur, de rejeter la civilisation? Il s'agit seulement d'en éliminer les incohérences qui choquent douloureusement un esprit logique. Aux hommes qui devraient être associés pour lutter contre la misère, vous êtes arrivé à donner des intérêts contradictoires. La maladie, le froid, les guerres sont agréables et avantageuses à des classes entières de citoyens. La concurrence gaspille des forces immenses. Tout cela est fou. Et il n'y a qu'un remède, c'est l'égalité.
Ils suivaient la vallée du Scardon. Le ruisseau étroit et clair coulait entre les saules aux bras tronqués. Une compagnie de canetons, derrière une cane prudente et grave, croisaient allègrement d'un bord à l'autre. Dans la lumière atténuée et douce, les toits rouges d'une ferme, le brun gras de la terre, l'eau cendrée d'un étang brillaient d'un éclat solide et mesuré.
—L'égalité? dit Bertrand d'Ouville. Et pourquoi serait-ce un remède? Pour sauver les hommes de la misère de leur condition, il ne s'agit pas tant de savoir comment on partagera que d'avoir quelque chose à partager. Ce qui a fait le succès de la propriété privée, c'est son évidente puissance de production. Voyez-vous quelque avantage à faire une société de malheureux, tous égaux dans leur misère?
—Sans même discuter ce point, me permettrez-vous de vous dire, monsieur, que vous jugez la question d'un point de vue un peu médiocre? Vous ne pensez qu'au confort matériel...
—C'est beaucoup.
—Mais ce n'est pas tout. L'égalité est un bien en elle-même. Croyez-vous qu'il soit agréable de naître esclave. Pour moi j'aimerais mieux crever de faim libre que de souper après mon maître.
Ils étaient arrivés sur un petit pont rustique qui traverse le Scardon. Devant eux une île boisée divisait la rivière en deux bras. Un moulin vénérable barrait l'un d'eux.
Bertrand d'Ouville s'appuya à la rampe de sapin et regarda l'eau rapide et transparente. Un vieux tronc noir à demi immergé créait un remous en aval duquel une grosse truite immobile attendait les gibiers portés par le courant.
—Un maître..., dit le vieillard; croyez-vous que le régime communiste vous l'épargnerait? Vous confondez tous, mon cher, l'argent, qui n'est qu'un signe, et le pouvoir, qui est réel et désirable. Ce qui vous offusque chez le riche, ce n'est pas qu'il possède des rondelles de métal jaune, c'est qu'il est puissant. C'est qu'il a une voiture, des femmes, des serviteurs.
Mais quel que soit le régime, il vous faudra un chef. Il aura une voiture parce que les devoirs de sa charge exigeront qu'il se déplace rapidement, il aura des serviteurs parce qu'il sera trop occupé pour faire sa cuisine, il aura des femmes parce qu'il sera nouveau. Et il sera haï parce qu'il sera le maître.
Un petit claquement de l'eau l'interrompit: la truite, montrant pendant l'éclair d'un instant sa gueule noire, avait happé une mouche.
—Regardez. Cet emplacement de chasse est, pour un poisson, la fortune. Le moulin, le remous du saule y apportent mille proies faciles. La plus grosse truite de la rivière l'occupe par droit naturel. Attrapez la, mon cher, faites-la cuire et revenez demain: vous la retrouverez à la même place.
—C'est un apologue que les gros poissons racontent volontiers aux petits, dit Philippe Viniès. Mais nous ne sommes plus, heureusement, au temps où les fables d'un sénateur bourgeois arrachaient au Mont Sacré un peuple trop indulgent. Si les truites connaissaient la puissance de l'association...
Bertrand d'Ouville sourit:
«Ma foi, dit-il, il est bien vrai que toutes les discussions sont vaines. Ce sont les tempéraments, non les idées, qui s'affrontent; moi, je ne digère pas la fraternité. Votre estomac semble l'exiger... Mais voici la Voie Romaine.
Ils étaient maintenant dans la forêt épaisse et humide: devant eux une légère dépression se creusait nettement dans le sol couvert de feuilles mortes et, bordée de talus moussus, s'en allait en longue ligne droite, des deux côtés, à perte de vue.
—Tout le long de cette route, dit l'archéologue, j'ai trouvé de petits temples, des villas, des corps de garde. N'est-il pas curieux de penser qu'un ingénieur romain a dessiné ces choses, que des légionnaires ont défriché ce pays, et que la forêt a repris enfin pour les conserver ces terres que Rome avait délivrées.
Ah! quand on sait que la Légende dorée a été écrite plus de mille années après le journal scientifique de votre collègue César, cela permet en effet de beaux espoirs aux Wisigoths de votre sorte.
*
* *
Ils revinrent lentement vers la ville par un chemin à flanc de coteau d'où l'on percevait plaisamment l'ordre parfait de ce paysage si simple. Le ciel gris faisait plus vertes les prairies qui épousaient les croupes des collines picardes comme une robe bien ajustée. Comme ils arrivaient au faubourg Saint-Gilles, Bertrand d'Ouville, poussant une lourde porte, fit entrer Philippe dans la cour de l'hôtel de Vence où l'herbe poussait entre les pavés noirs.
—Regardez ceci, mon cher; est-ce beau? La grâce sobre des lignes, l'aisance noble du toit, cette fenêtre classique qu'orne à peine un feuillage léger... Et la couleur de tout ça: cette brique à peine rose, cette pierre à peine grise... Ah! votre romantisme, mon cher, je suis loin d'en mépriser les beautés; tout est bon et je ne blâme personne. Mais le goût qui s'était formé chez nous aux deux derniers siècles a été une chose charmante. Les artistes, travaillant pour une élite de deux ou trois mille délicats, s'imposaient une mesure et une solidité peut-être uniques au monde. Alors on était sensible sans être sentimental, passionné sans être violent, érudit sans être pédant. Votre Rousseau gâta tout cela. Cela nous valut bien des tourments. Le mauvais goût conduisit au désordre et le lyrisme à la guillotine.
—Vous allez me trouver bien sot, monsieur, dit l'ingénieur, mais je donnerais volontiers tous les produits de cet art si mesuré, vos Trianons, vos Watteau, et vos tragédies raisonnables, pour une page des Confessions.
Et qu'importe l'art s'il est stérile? Il y a plus de beauté dans la fête de la Fédération ou dans le Serment du Jeu de Paume que dans tous vos hôtels élégants et médiocres.
—Peut-être, dit le vieillard, quittant avec regret la vieille cour, mais la scène, si belle qu'elle soit, meurt si l'art ne la fixe. Votre Révolution n'a rien laissé de grand. Si d'ailleurs son histoire a quelque beauté romantique, c'est par le contraste entre sa sauvagerie et ce qui flottait encore dans l'air des grâces de Trianon. Les graveurs qui dessinèrent ces haches de licteurs menaçantes étaient les mêmes qui en d'autres temps avaient entrelacé des rubans, et les bonnets phrygiens prenaient sous leurs crayons je ne sais quel air noble et délicat.
Les belles choses, mon ami, sont le produit de ces époques que vous appelez j'imagine, odieuses et tyranniques et que j'appelle, moi, constructives. Quel est l'anniversaire favori de vos amis? celui d'une démolition, tandis que ceci...
Les corbeaux s'échappaient en croassant des tours massives et gracieuses de l'église de Saint-Vulfran.
«Voyez, milord, fit une voix derrière Philippe, belles tours, deux cent vingt pieds de haut, mesurées par les Anglais..., beau portail, belles portes...
—Laisse-nous tranquille, dit l'archéologue, tu vois bien que c'est moi.
—Yes, milord, dit le vieux soldat, et il salua.
—Il a d'ailleurs raison: ces portes sont très belles... Elles furent offertes à Saint-Vulfran au XVe siècle par le bourgeois Mourette, de cette ville, qui fit graver sur chacune d'elles: «Vierge aux humains la porte d'amour êtes.» Ainsi son nom demeure dans un pieux calembour.
J'ai chez moi le portrait de Mourette et de sa femme dans une «Vierge au donateur» d'un inconnu plein de talent. C'est un honnête marchand qui ressemble à mon cordonnier. Je lui envie la violence du sentiment qui le persuada de dépenser sa fortune de si jolie manière.
—Nous ferons aussi bien, dit Philippe, le jour où quelque grande passion nous inspirera à notre tour. Imaginez l'ardeur avec laquelle les artistes sculpteront les portes de ces phalanstères qui seront les cathédrales du travail et de la fraternité humaine.
Par de petites rues étroites, ils rejoignirent la grand'place: comme ils passaient devant le cabaret Pitollet, Clotilde leur sourit.
—J'aime bien Clotilde, dit le vieillard, elle a l'air honnête et réjoui de certains portraits de La Tour. Cela s'explique d'ailleurs: La Tour était de chez nous.
Philippe le dimanche suivant, se retrouva à Epagne avec un vif plaisir. Les jeunes filles demandèrent la permission d'aller avec lui faire une courte promenade au bord de la Somme. La rivière, très haute, lisse et rapide, coulait comme un canal de Versailles, entre deux nobles rangées de grands arbres.
—Cette rivière, dit Philippe, va me donner bien du tourment.
—Pourquoi? dit Catherine, complaisante.
—Mon devoir d'ingénieur est de l'empêcher de vous inonder: ce n'est pas facile.
—Comme ce doit être intéressant, dit Catherine.
Il leur expliqua assez longuement le fonctionnement des écluses et le régime de la Somme sur lequel il avait déjà trouvé le temps de former des idées originales et définitives.
—Je suis, dit Geneviève, ignorante comme une nonne. Au couvent on nous apprenait chaque année la géographie des Lieux Saints, mais jamais celle de la France. Depuis que j'en suis sortie, je lis des romans, je chante: je suis paresseuse.
Philippe demanda quelles impressions lui avait laissé le couvent.
—Nous étions très heureuses: toutes les élèves rivalisaient de pratiques et d'exaltation.
—Mais que vous enseignait-on?
—L'histoire religieuse, les papes, les schismes... Puis le dogme: le cours était fait par un jeune abbé timide qui n'aimait pas mes questions. Il n'était pourtant pas bête.
Elle sourit à un souvenir.
—Un jour, il avait donné en composition l'immortalité de l'âme. Je l'avais prouvée en montrant que les méchants doivent être punis quand ils ont échappé aux châtiments terrestres. «C'est une mauvaise raison, me dit l'abbé Hamon, elle prouve que l'âme survit au corps mais on ne voit pas pourquoi ce serait pour l'éternité. Les méchants seraient aisément punis en quelques années.» C'était juste, ne trouvez-vous pas?
—Oui, dit Philippe, qui marchait maintenant derrière elle sur le chemin de halage étroit, mais comment la prouvait-il, lui?
—Je ne sais plus: cela n'a pas grande importance... On nous apprenait aussi l'histoire romaine, à cause des martyrs. J'avais été vivement frappée par l'histoire des Carthaginoises coupant leurs cheveux pour en faire des câbles de vaisseaux; je me représentais mes cheveux tressés en câble pour quelque grande guerre. C'était un sacrifice agréable... J'aimais beaucoup Scipion et César.
—Il n'y a rien de plus beau au monde que l'histoire de Rome, dit Philippe avec exaltation. Toutes nos grandes idées viennent de là. M. d'Ouville collectionne des débris romains. À quoi bon? Nous sommes tous des débris romains. Mais je préfère, moi, Brutus à César.
Geneviève qui suivait sa pensée, continua:
—Nous avions un confesseur jésuite qui était bien l'homme le plus fin que j'aie encore rencontré. Il comprenait nos âmes de petites filles! C'était merveilleux. D'ailleurs il en voyait tant et nous étions toutes si pareilles. Nous avions toujours honte de n'avoir aucun péché à confesser et nous nous en empruntions pour avoir quelque chose à dire.
—L'idée du péché, dit-il, tout en admirant inconsciemment les mouvements des hanches de la jeune fille, est bien dangereuse pour des enfants: il faut se servir de leurs passions et non les combattre.
—La nourriture, dit Geneviève, était mauvaise et l'on ne pouvait y suppléer par les envois de nos familles, car la Supérieure, par esprit d'égalité, nous forçait à tout mettre en commun.
—Je sens naître en moi, mademoiselle, une vive estime pour votre supérieure. Ah! si, au lieu de fonder des couvents d'hommes et des couvents de femmes, les moines avaient fait des couvents mixtes, le monde entier vivrait aujourd'hui dans un communisme chrétien et l'idée de richesse privée paraîtrait si absurde...
—Peut-être, coupa Geneviève, mais c'était fort désagréable pour le chocolat du dimanche. On mélangeait là-dedans tous nos chocolats de marques différentes, et même la vanille de celles qui en avaient: c'était atroce.
—Il faut bien souffrir un peu pour fonder le royaume de Dieu, dit Philippe: vous apportiez votre pierre.
Et il décrivit la cuisine, les modes et les arts de l'état qu'il fonderait quelque jour avec ses amis. Il s'efforçait de mêler quelque gaieté à son enthousiasme, mais se prenait trop au sérieux pour se railler bien volontiers.
Ils retrouvèrent à l'entrée du jardin Mademoiselle et Bertrand d'Ouville qui étaient venus à leur rencontre.
—De quoi parliez-vous, mes enfants? dit Mademoiselle enrôlant par ce seul mot Philippe dans sa maternité d'adoption.
—M. Viniès, dit Geneviève, enlevant son chapeau et le faisant tourner par les brides autour de son poignet, nous expliquait que dans sa cité future, Catherine et moi devrons porter les mêmes robes bien que Catherine engraisse et que je maigrisse.
—C'est vrai, dit Mademoiselle souriante, M. Viniès est communiste, ou socialiste, je crois que c'est le nouveau mot.
—Vous êtes extraordinaires, vous autres, femmes, dit Bertrand d'Ouville avec un peu d'humeur: un jeune fou vous expose un système dangereux qui vous supprimerait toute liberté, où il faudra une loi pour obtenir un nouveau meuble, où le menu de votre déjeuner sera arrêté par une commission de savants nommés au suffrage universel, où les théâtres joueront des féeries patriotiques édifiantes auxquelles vous serez forcées d'assister une fois par semaine, et vous traitez toutes ces folies comme une manie inoffensive.
—Toutes les idées des hommes sont des manies inoffensives, dit Mademoiselle, mais quelques sottises que vous fassiez, tout s'arrange tôt ou tard parce que nous les femmes conservons toujours les trois sciences essentielles...
—C'est-à-dire? demanda Philippe surpris.
—La cuisine, la couture et l'élevage des enfants.
Bertrand d'Ouville soupira:
«Si les femmes et les Saint-Simoniens s'entendent pour nous civiliser, dit-il, les délicats comme moi n'ont plus qu'à chercher une île déserte où, de vivre en barbare, on ait la liberté.
La voiture de M. de Vence s'arrêta devant la porte: il venait chercher Bertrand d'Ouville pour faire au cercle son whist dominical.
—M. Viniès, dit Mademoiselle, je suis sûre que vous ne jouez pas au whist: voulez-vous rester et dîner avec nous?
—Vous aurez à rentrer à Abbeville à pied, Viniès, dit Bertrand d'Ouville, avec une nuance de menace.
—Mais j'aime beaucoup marcher: j'accepte avec plaisir.
—À votre aise, dit le vieillard.
«Qu'est-ce qu'il a? dit Philippe en remontant l'allée seul avec Mademoiselle. Il a l'air mécontent.
—Eh! mon petit il a quelque raison de l'être. Avant qu'il ne vous eût amené, Geneviève et Catherine chaque dimanche écoutaient ses histoires qui sont d'ailleurs souvent spirituelles. Vous venez, vous êtes jeune, on s'occupe de vous, mes enfants vous promènent. Lui souffre, c'est tout naturel.
—Mais, dit Philippe, il a plus de soixante ans.
—Et vous croyez que les passions s'apaisent lorsqu'on vieillit? Oh! que vous avez encore à apprendre!... Sachez que les hommes, jusqu'à leur mort, sont petits, petits, petits.
Sur quoi Mademoiselle, ayant prononcé cet arrêt de sa voix flutée, releva légèrement sa large jupe noire, et, montant les marches de pierre avec une vivacité inattendue disparut aux yeux de Philippe étonné et alla commander son dîner.
Le jeune ingénieur eut ce soir-là quelques-unes des meilleures heures de sa vie. Mademoiselle semblait le traiter en initié d'une sorte de mystérieuse franc-maçonnerie féminine; Catherine offrait ses narines palpitantes, sa lourde poitrine et son parfum léger de vierge ardente; Geneviève fut spirituelle, parodia fort agréablement la voix tortillée de M. de Vence, s'intéressa très poliment aux explications que Philippe lui prodigua sur toutes choses, et, pour une phrase banale qu'ils avaient prononcée ensemble lui envoya un beau regard d'intelligence fraternelle qui le fit frissonner de plaisir.
Il rentra à pied par une pleine lune qui mettait aux coins des villages des ombres romantiques et dures; il était parfaitement heureux et le chemin lui parut trop court.
Les sentiments vifs se transforment volontiers en actions: Philippe, au lendemain de ce dimanche heureux, alla visiter le canal de la Somme et le port de Saint-Valéry et revint de son voyage armé d'un projet de travaux qui devaient selon lui bouleverser utilement ce coin de la Picardie. Deux jours plus tard une visite de M. Lecardonnel, son ingénieur en chef, lui permit d'exposer ses idées.
Ce qui frappait tout de suite en Lecardonnel était son énorme tête, entourée de cheveux blancs assez longs et très fins: le visage glabre, aux traits puissants, faisait penser à un mufle de vieux lion. La tête était penchée sur l'épaule, et le nez toujours enfoui dans un grand mouchoir jaune, par précaution contre un rhume éternel. Au-dessus du mouchoir, deux yeux d'un bleu très clair charmaient dans ce visage de vieillard comme des bleuets dans une terre crevassée.
Il était vêtu hiver comme été d'un grand pardessus noir taché de craie, car il passait sa vie au tableau noir. C'était un mathématicien ingénieux, beaucoup plus occupé de ses travaux personnels que de ceux de son département qui se faisaient bien tout seuls.
«J'aurai aussi à vous soumettre bientôt, dit Philippe quand ils eurent terminé l'examen des affaires courantes, un projet d'amélioration de la Baie de la Somme. J'ai été stupéfait en arrivant ici de constater le faible trafic de la ligne d'eau Somme-Amiens-Paris, qui serait pourtant, pour les marchandises venues d'Angleterre, la voie d'accès la plus naturelle. Je ne comprends pas par quelle aberration on a pu laisser Saint-Valéry dépourvu d'un port convenable alors qu'on dépense des millions au Havre qui, d'après beaucoup de géographes, sera inutilisable dans cinquante ans...
—Hum... dit Lecardonnel dans son mouchoir... chenal de la baie très mauvais... sables mobiles... les bâtiments s'échouent... comprenez-vous?
Il parlait avec une extrême rapidité et supprimait la moitié des mots:
—C'est ce que m'ont dit les pilotes, monsieur, dit Viniès, mais il semble vraiment facile de fixer le chenal.
—Hum, hum... fit Lecardonnel... si la rivière coulait seule dans les sables... oui, alors... mais tout est bouleversé par la marée... Courant de la Somme pratiquement nul par rapport au courant du flot... comprenez-vous?
—Oui, monsieur, dit Philippe, déployant une carte, mais on pourrait aisément renforcer le courant de la rivière en rapportant l'écluse qui la ferme sous la tour de Harold. Dès lors, les eaux ne perdant plus leur vitesse sur un trajet trop long creuseraient un chenal profond. Avec deux jetées et quelques bassins, on ferait de Saint-Valéry...
—Mettez ça sur papier, faites-moi un projet... on verra... hum, hum... mais les sables... les sables... éléments non définis dans la donnée du problème... comprenez-vous?
Puis le vieux lion inclina la tête davantage et fixant sur Philippe ses yeux jeunes:
—Ah! j'oubliais... j'ai reçu du préfet un mot me priant de surveiller votre attitude politique... hum, hum... pour moi, la politique n'existe pas... éléments non définis, comprenez-vous?... Mais je voulais vous prévenir.
—Je ne serai pour vous, monsieur, la cause d'aucun ennui, je ne demande que la liberté de penser.
—Aucun ennui possible ici, prononça son chef; vallée fertile, hommes paisibles... carte politique de la France suit la carte géologique... comprenez-vous?... J'ai vu en Italie un village bâti sur deux versants d'une montagne. Côté du soleil, récoltes superbes, habitants conservateurs... côté de l'ombre, révolutionnaires... s'injurient les uns les autres avec beaucoup de conscience.
Puis il emmena Philippe chez Bertrand d'Ouville avec lequel il devait déjeuner. En route il admira Saint-Vulfran:
«Rien de plus beau que ça, Viniès... Cathédrale gothique... algèbre de pierre... édifice vraiment spirituel... Remarquez bien: pressions suivent les nervures et piliers... Armature soutient toute l'église... murs ne sont que des tentures... comprenez-vous? Êtes-vous croyant? Moi, oui... rien de plus beau que la théologie, si ce n'est peut-être l'arithmétique... Mais me suis toujours demandé ce qu'on pourra bien faire pendant l'éternité... ai commencé une étude des espaces à plus de trois dimensions en vue de m'occuper là-haut.
Bertrand d'Ouville fît bon accueil à Philippe et l'invita à déjeuner:
—Eh bien! lui dit-il, vous êtes-vous diverti aux mystères de la Bonne Déesse?... Lecardonnel, connaissez-vous mes amies d'Epagne: il faudra que je vous emmène, vous verrez deux jolies filles.
—Hum... hum..., fit le vieux lion... les femmes... éléments non définis. Êtes-vous marié, Viniès? Non? Tant mieux... La plus grande intelligence commune de deux êtres inégaux est nécessairement inférieure à l'intelligence du meilleur des deux.
On annonça le déjeuner: des cabinets italiens aux marquetteries bigarrées ornaient la salle à manger. La cuisinière de Bertrand d'Ouville était célèbre dans tout le Ponthieu et Lecardonnel durant la plus grande partie du repas savoura les plats en silence.
Philippe raconta à l'archéologue une violente discussion qu'il avait eue la veille avec le sous-préfet au sujet d'un réfugié polonais auquel sa demande de secours avait été retournée avec cette note: «Gagne déjà six francs par semaine comme violoniste au théâtre».
—J'avoue, dit Bertrand d'Ouville, que je ne comprends guère moi-même pourquoi nous devrions pensionner des étrangers.
—La Pologne, dit Philippe est, dans l'Est, le boulevard de la civilisation: elle y jouera, si nous savons l'y aider, le rôle que joue la France dans l'Ouest.
—C'est encore de la politique romantique, mon cher, mais l'électeur français ne se soucie guère d'en faire les frais. Un de mes fermiers, gros contribuable, se plaignait à moi l'autre jour de ces secours aux réfugiés: «Je vais, me dit-il, demander au sous-préfet une place de polonais.»
—Il est électeur? dit Philippe sarcastique. Il l'obtiendra.
Et il dénonça la corruption qui envahissait le pays légal: les députés disposaient du budget, de bureaux de poste, de débits de tabacs, de tronçons de chemin de fer.
—Tout cela est malheureusement vrai, dit Bertrand d'Ouville, mais le moyen de l'éviter?
—Il est fort simple, dit Philippe, c'est le suffrage universel... ce qui est possible avec un corps électoral réduit deviendra impossible quand la nation votera toute entière.
—Le suffrage universel! dit l'archéologue avec un peu d'irritation. Ce serait l'anarchie.
Philippe haussa les épaules: le vieux lion fit entendre des grognements préparatoires:
«Hum, hum... fit-il... une seule condition pour rendre le suffrage universel possible... la conscription... Garde nationale légitime le suffrage restreint.»
Et comme les deux autres le regardaient avec quelque surprise, il expliqua:
«Hum... Meilleur gouvernement est celui qui dure le plus longtemps... or pour qu'un gouvernement dure, il faut qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire que la force et le pouvoir coïncident... comprenez-vous?... Temps primitifs: force musculaire toute puissante... lutteur ou pugiliste doit régner... Achille, Ulysse... Barons féodaux: excellent système tant que les cavaliers font peur aux piétons... Mais poudre à canon fait armées de fantassins et du même coup pouvoir central... comprenez-vous?... Et si jamais les hommes apprennent à voler, ou perfectionnent la chimie au point que des individus puissent lutter contre des armées... hum... verrez lentement, mais sûrement se recréer une féodalité... Force et pouvoir... hors de là désordre... comprenez-vous?
—Oui, dit Philippe, c'est ingénieux: mais Napoléon renverse votre système. Avec lui, l'armée nationale ne sert qu'à soutenir un tyran.
Le vieux lion pencha son mufle plus bas encore sur son épaule et regarda Philippe avec malice.
—D'abord, dit-il, l'armée de Napoléon était une armée de métier... ensuite Napoléon n'était pas un tyran.
—Certes non, dit Bertrand d'Ouville: il croyait aussi peu à son droit divin qu'à celui des peuples. C'était sa force. Jamais homme n'a vu plus clairement les choses comme elles sont, sans les déformer pour satisfaire ses désirs ou ses préjugés. Après l'échec du camp de Boulogne, sans perdre une minute à se lamenter sur tant d'efforts perdus, il prépare Austerlitz... Et pendant la campagne d'Italie, dès la première neige: «Allons, dit-il, il faut faire la paix, le Directoire et les Avocats diront ce qu'ils voudront.» De même la religion, la noblesse, étaient pour lui des faits dont il n'avait garde de négliger l'importance. Non, cet homme-là n'était pas un tyran, c'était un chef.
—Hum... dit Lecardonnel, connaissez-vous l'histoire de Bonaparte discutant avec Portalis projet de constitution?... Il faut, dit-il, qu'elle soit courte et...—Courte et claire, dit Portalis.—Oui, dit Bonaparte, courte et obscure.
—Je trouve cela d'un réalisme admirable, dit l'archéologue, c'est fort comme du Machiavel.
—Oui, dit Philippe avec feu, mais ce grand réaliste a succombé comme tous ses pareils pour avoir oublié qu'il y a autre chose chez l'homme que ces passions et ces intérêts qu'il connaissait si bien. Il y a un appétit mystique de justice et d'égalité qu'il faut satisfaire; il y a la bonté, il y a l'amour... Et ces autres grands réalistes, ces empereurs romains qui ont donné au monde un bonheur peut-être unique dans son histoire, ont vu leur œuvre s'écrouler devant quelqu'un qui disait: «Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu...
Le vieux Lecardonnel, son large nez plongé dans un verre de remarquable fine champagne, regarda le jeune apôtre avec sympathie.
«Ah! là, dit-il... Bertrand... Là, il y a quelque chose... L'idéalisme fait partie de la donnée du problème... Si on le néglige... solution incomplète.
Il ajouta après réflexion: «Ou indéterminée.»
—Peut-être, dit Bertrand d'Ouville, mais il n'y a qu'un cynique qui puisse être idéaliste sans danger pour ses concitoyens.
Sur quoi le vieux lion, agitant vigoureusement sa crinière, répéta plusieurs fois avec une évidente satisfaction:
—Courte et obscure... Viniès... courte et obscure.
Philippe décida dans son cœur qu'il préférait les manières abruptes de son chef à l'ironie mesurée de Bertrand d'Ouville.
Les souvenirs de Philippe étaient si tendres qu'il prit à Epagne le dimanche suivant un air un peu conquérant. Geneviève, âme tendue et fière qui résonnait aux plus légères nuances de sentiment, fit aussitôt mille amitiés au vieil archéologue à côté duquel elle alla s'asseoir.
«Ô Abisaïg, vierge sunamite...» pensa Mademoiselle qui proposa innocemment aux jeunes gens d'aller tous trois faire une promenade.
—Je suis fatiguée, dit Geneviève, mais Catherine peut très bien sortir seule avec M. Viniès, n'est-ce pas, mademoiselle?
—Certainement, dit la voix flûtée, mais ils devront rester dans le parc, car les gens du pays jaseraient et M. Bresson ne me confierait plus sa fille.
Catherine, étonnée de sa bonne fortune, se leva avec empressement. Philippe dut suivre, d'assez méchante humeur.
Autour des pelouses attristées par les feuilles humides et rouges de l'automne, leur conversation morte tourna sans joie. Elle lui demanda ce qu'il pensait de Mademoiselle: il dit qu'il l'admirait beaucoup. Elle essaya de parler d'elle-même, de sa vie triste chez ses parents, de ce qu'elle eût aimé à faire pour les ouvriers de son père. Elle s'excusait inutilement de sa naissance riche et bourgeoise.
Puis elle voulut dire avec force qu'elle aimait Werther et Manfred. Philippe, injuste, écoutait impatiemment cette enfant maladroite avec une réelle bonté, un besoin de dévouement et d'adoration presque maladifs, elle avait le malheur de dire faux et ses phrases sans fraîcheur endormait l'esprit.
Ils revinrent s'asseoir d'un air accablé en deux coins opposés du salon.
Il y eut un assez long silence: par la fenêtre sans rideaux on voyait des haillons de brume s'effilocher dans le ciel livide.
—Que pourrions-nous faire? demanda Geneviève.
—Vous savez ma règle, dit Mademoiselle, si l'on est huit, il faut parler voyage; si l'on est six, philosophie; si l'on est quatre, sentiment; si l'on est deux, chacun parle de soi.
—Mais nous sommes cinq, mademoiselle.
—Alors, allez au diable.
—Connaissez-vous, dit Bertrand d'Ouville, les triangles de madame de Ludre?
—Non, dit Mademoiselle, d'abord qui est madame de Ludre?
—C'est une bonne dame fort dévote qui vient de publier un manuel de perfectionnement moral. L'une des méthodes qu'elle y recommande pour sauver son âme est de tracer sur une feuille de papier autant de triangles que l'on a de défauts graves. Puis à mesure que l'on se perfectionne, on noircit lentement chaque triangle en commençant par le sommet. Quand tous sont noirs, votre âme est blanche. Lors de mon dernier voyage à Paris, c'était un jeu fort à la mode chez mes cousins Genzé que de donner à ses amis des triangles à remplir.
—C'est un jeu bien dangereux, dit Mademoiselle, je pourrais vous en offrir une bonne douzaine... Catherine, ma chérie, cherchez-nous du papier et des crayons.
Un nouveau silence se prolongea; ils avaient beaucoup d'idées, mais hésitaient à les écrire. Mademoiselle réclamait à chacun ses défauts, mais personne n'avait l'audace de s'adresser à elle. Enfin Bertrand d'Ouville fit passer un papier à Philippe.
—Esprit de système, lut celui-ci surpris, ma foi, monsieur, je pourrais vous le rendre.
Geneviève dessinait minutieusement deux triangles pointus qu'elle alla porter avec une révérence à Bertrand d'Ouville et à Viniès.
—Coquetterie, lut le vieillard.
—Très Bien, Geneviève, dit Mademoiselle battant des mains.
—Que le diable m'emporte si je cherche à m'en guérir, dit-il. C'est un défaut de jeune homme. Et vous, Viniès, que vous a donné cette jeune folle?
—Exagération, déchiffra Philippe. Pourquoi? dit-il douloureusement.
—Tout ce qui est grand est exagéré, dit Catherine.
—Cela suffit, dit sèchement Mademoiselle, agacée: vous devenez trop subtils, mes enfants. Geneviève, chantez-nous Orphée, cela donnera de l'air.
On fît de la musique jusqu'au soir et Philippe ne fut pas retenu à dîner. Après le départ des hommes. Mademoiselle, trouvant Catherine seule dans le salon, la prit brusquement par les épaules et lui dit:
—Catherine, ma petite, souvenez-vous qu'il y a deux choses qu'un homme ne pardonne pas à une femme: c'est de l'aimer, et de ne pas l'aimer.
Philippe, en rentrant, écrivit à son ami Lucien Malessart, rédacteur à la Réforme, une lettre violente qui contenait sur les femmes et le monde quelques jugements satiriques et vigoureux.
Quand il avait ainsi habillé ses sentiments en idées générales, il ne les reconnaissait plus et se prenait à les respecter.
Lucien Malessart au Préfet de Police.
«J'ai l'honneur, M. le Préfet, de solliciter mon admission dans l'administration que vous dirigez. J'ai déjà fourni quelques renseignements à M. Brette, votre agent, qui pourra répondre de moi.
«Le service dans lequel je désire entrer est celui de la police politique et secrète. Ce service conviendrait à mon caractère: le préjugé qui s'y attache n'a aucune puissance sur moi, car je crois que toute profession a sa moralité et je ne pense pas que celle qui a pour objet d'assurer le repos du pays puisse être méprisée des hommes raisonnables qui savent voir la fin à travers les moyens.
«J'ai été victime, comme bien des jeunes gens, de l'exaltation politique de ce siècle troublé, mais le contact journalier du monde m'a depuis enlevé bien des illusions, et j'en suis arrivé à considérer sans les préventions du vulgaire l'emploi que je sollicite aujourd'hui.
«Affilié à la Société des Saisons, j'y ai acquis une influence assez solide en affectant de n'en chercher aucune, et en me montrant prudent et méticuleux dès qu'une affaire pouvait mettre en danger la sécurité du parti. C'est en continuant à jouer ce rôle parmi les adhérents des sociétés secrètes que je crois pouvoir, monsieur le Préfet, être pour le gouvernement un auxiliaire utile.
«Certes, il vous serait facile de faire arrêter les principaux chefs de ces groupes en somme peu nombreux, mais je suis d'avis qu'il vaut mieux pour assurer le maintien de l'ordre les tolérer et les surveiller, et mon expérience de ce monde d'ambitieux désappointés donne, je crois, quelque valeur à cette opinion.
«Dans un pays ardent comme le nôtre, il me paraît nécessaire de faire croire à la paix des esprits, car il suffit d'y montrer un complot pour que dix autres se forment à son image. La prison et l'exil posent en héros de pauvres diables égarés et cette apparence de gloire donne à d'autres malheureux le courage de les imiter.
«Dès lors, au lieu d'organisations connues qu'il vous est facile de contrôler par l'intermédiaire d'hommes de bonne volonté comme moi-même, vous vous trouvez, monsieur le Préfet, en présence de foyers nouveaux qui peuvent couver fort longtemps avant que la police ne les découvre.
«Or, je prétends que de telles sociétés se formeront toujours à Paris, car elles y trouveront toujours à recruter leurs adhérents dans les milieux que je vais avoir l'honneur de vous énumérer.
«a) la jeunesse des Écoles—elle aime le bruit et les événements, et son extrême inexpérience de la vie la dispose à accueillir les théories les plus dangereuses. Les Anglais, qui ont le génie de la tranquillité publique, maintiennent sagement leurs grandes Universités hors de Londres.
«b) les impuissants—avocats sans causes, médecins sans patients, écrivains sans lecteurs, marchands sans clients. Là est le champ de recrutement éternel de toutes les causes révolutionnaires, et à ce propos je me permettrai de faire remarquer l'importance qu'il y a pour tout gouvernement à bien payer ses intellectuels. J'irai même jusqu'à soutenir que c'est une des fonctions de la police politique que de rechercher les intelligences inutilisées et de les arracher aux dangereux conseils du désespoir en leur procurant les moyens de gagner honorablement leur vie.
«c) les ouvriers des faubourgs—bien intentionnés, braves gens par nature, mais batailleurs par habitude et prêts à tout parce qu'ils n'ont rien à perdre.
«d) les réfugiés politiques, exilés de pays étrangers et qu'on a le plus grand tort d'accueillir dans le nôtre.
«C'est parmi ces hommes que s'est recruté le personnel de la Société des Saisons: il s'y recruterait encore si la société actuelle était dissoute. Si au contraire celle-ci subsiste, je me fais fort, monsieur le Préfet, de vous tenir au courant chaque semaine de ses projets et de ses moyens d'action. En particulier, la seule imprimerie clandestine de la Société a été placée dans mon appartement qui est considéré comme un endroit sûr, ce qui vous donne toute garantie sur la nature des écrits qui seront ainsi répandus.
«J'ai également quelques accointances en province, surtout dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. À titre d'exemple, je vous signalerai l'ingénieur des Ponts et Chaussées Viniès, communiste et républicain, qui fait une propagande purement théorique, mais active dans les milieux ouvriers d'Abbeville. On ne peut dire que ce fonctionnaire soit dangereux, mais c'est un esprit confus et utopiste qu'il y a lieu de surveiller et en cas de troubles d'éliminer.»
La lettre se terminait par quelques détails intéressants sur plusieurs jeunes hommes d'Amiens et d'Arras qui informaient volontiers Lucien Malessart de leurs idées et projets politiques.
La route royale n° 32, le projet d'amélioration de la Baie de la Somme et les querelles ardentes du maire d'Ault avec l'Océan occupèrent l'ingénieur Viniès pendant le mois de novembre. Le maire d'Ault surtout, fermier énergique el sanguin, le força à passer plus d'une journée en diligence. Viniès le persuada enfin d'ouvrir parmi les propriétaires une souscription qui permettrait d'élever un mur de défense: il en établit la courbe ingénieuse qui devait défier et rejeter les vagues.
Il continuait à habiter le cabaret Pitollet où Clotilde l'entourait de soins délicats qu'il ne remarquait pas, et à se rendre chaque dimanche au château d'Epagne.
Il se donnait beaucoup de mal pour y plaire et avait l'impression d'y avoir assez bien réussi. Son sourire était sans grâce et ses plaisanteries douloureuses, mais il apportait des idées à ces jeunes filles fort ignorantes: elles l'écoutaient d'autant plus volontiers qu'il était joli et, quoique petit, bien fait.
La nuit tombait maintenant très tôt: Catherine et Geneviève mettaient des manteaux épais et, dans le parc, où la lune à son premier croissant allongeait les ombres des sapins, Philippe leur parlait des étoiles et leur disait les noms qu'inventèrent jadis pour elles des bergers chaldéens et des pasteurs arabes. Pour mieux voir, Catherine s'appuyait contre lui et parfois il devait prendre la main de Geneviève pour la pointer vers un coin de ciel.
Il leur prêtait des livres qu'il aimait et auxquels Geneviève reprochait souvent de manquer de naturel. Ils les discutaient en de longues promenades sur les bords majestueux de la Somme: les jeunes filles se tenaient par la taille et prenaient un plaisir, peut-être ingénûment adroit, à s'embrasser devant Philippe. Il écoutait avec une joie toujours fraîche la voix claire de Geneviève, tandis qu'il associait à des désirs plus confus les formes violentes de Catherine et les parfums légers de sa peau de brune.
Le dernier dimanche de décembre, comme il arrivait sans Bertrand d'Ouville que la neige avait effrayé, Mademoiselle lui apprit brusquement de sa voix flûtée que Geneviève faisait ses malles pour aller passer trois mois à Paris. Elle y avait une tante, qui l'invitait depuis longtemps et se promettait bien de la marier.
Philippe fut étourdi de surprise: mademoiselle lui parla avec une douce ténacité des plaisirs que Paris peut offrir aux jeunes filles.
—La danse à la mode est la polka: elle nous vient des paysans de Bohème. Cellarius l'a introduite à Paris. Elle y fait fureur, bien que certains salons du faubourg Saint-Germain la jugent peu décente...
Philippe répondait par de courtes phrases assez incohérentes et écoutait au-dessus de sa tête les pas des jeunes filles. Elles descendirent enfin.
—Je viens d'apprendre que vous partez, dit-il, tragique, à Geneviève.
—Oui, dit-elle avec un petit air de défi: cela m'ennuie de quitter Mademoiselle, mais je suis contente de voir enfin le monde.
—Le monde n'est pas Paris, dit Philippe amèrement.
La journée se traîna, interminable et lourde. Les femmes parlaient de diligences, de bagages, de robes et déploraient que le chemin de fer ne fût pas terminé. Philippe, silencieux, méditait.
Vers le soir, Catherine et Mademoiselle étant sorties un instant pour recevoir une paysanne, il s'approcha brusquement de Geneviève qui, debout près de la fenêtre, regardait le jardin endormi sous la neige.
«Avant que vous ne partiez, dit-il très vite, il y a quelque chose que je voudrais vous demander: ne croyez-vous pas que nous pourrions être heureux ensemble?
—Non, monsieur, répondit-elle sèchement, et elle sortit en courant.
Philippe étant allé sans le savoir jusqu'au perron, respira profondément l'air glacial, et regarda longtemps les masses blanches des sapins. Dans la blancheur uniforme des choses, les troncs d'arbres mettaient de larges bandes noires qui supportaient les traits fins et nets des branches et des rameaux.
«J'ai joué mon bonheur sur une phrase, pensait-il. Quel sot je fais: il fallait attendre. Je ne suis à ses yeux qu'un petit pédant de province. Allons, il faut accepter ceci stoïquement: me voici libre de me sacrifier pour quelque grande cause.»
Mais il revenait malgré lui aux reproches inutiles:
«Si je n'avais rien dit, je restais son ami. Elle reviendra de Paris dans trois mois: je l'aurais retrouvée. Maintenant, elle ne me parlera de sa vie.»
Et, convaincu que Geneviève le méprisait et le haïssait, il venait de décider de rentrer à Abbeville sans lui dire adieu quand il entendit par la porte ouverte sa voix claire.
—Mademoiselle, criait-elle, si vous avez besoin de moi, je suis au salon, je trie ma musique.
Comme Philippe était fort jeune, il ne comprit pas que la phrase s'adressait à lui, mais comme il était fort amoureux, il se trouva tout de suite dans le salon.
À sa grande surprise, elle le regarda d'un air assez doux.
—Ah! vous êtes ici, dit-elle, je venais chercher la musique que je dois emporter.
Mais elle s'assit dans un fauteuil et attendit qu'il parlât.
—J'espère, dit-il, que vous ne m'en voulez pas et que je resterai votre ami...
—Pourquoi vous en voudrais-je? dit-elle, intéressée et animée. Mais je ne comprends pas ce qui a pu vous plaire en moi. Vous êtes passionné, violent, intelligent...
Il fit un geste.
—Oui, vous êtes très intelligent: vous le savez... Moi je suis sotte, ignorante et petite fille.
—Vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas faite pour devenir une de ces poupées mondaines. Si vous acceptiez d'être ma femme, je ferais peut-être de grandes choses: je sens en moi près de vous l'ardeur qui les inspire...
Elle remarqua assez justement que dans cc grand amour, il était surtout question de lui.
—Vous êtes très spirituelle, dit-il amèrement.
—Et comment savez-vous, reprit-elle, que je ne suis pas faite pour être une femme du monde? Que connaissez-vous de mes sentiments vrais? La danse, les toilettes, les théâtres, l'esprit et le mouvement de Paris, tout cela me tente plus que vous ne pensez. Il se peut que cela me retienne.
—Le monde, dit Philippe, intéressera votre esprit, mais ne contentera pas votre cœur. Si vous épousez un des papillons de parfumerie et d'ironie facile que l'on y rencontre, je sais que vous ne serez pas heureuse. Ce que je vous offre est certes plus dangereux. Dans quelques années, l'an prochain peut-être, ce régime disparaîtra par la mort du Roi. Alors mes amis et moi, nous essaierons de préparer la France pour la mission d'affranchissement des peuples qui l'attend. Nous allons vivre de grandes années.
—Votre idéal est très beau, mais j'en suis indigne. La vie me semble tellement plus simple que tout cela. L'idée de me sacrifier à des théories, peut-être fausses, me paraît étrange, presque ridicule.
—Le ridicule ne m'inquiète pas, dit-il, je suis né sérieux et tendre... Et pourquoi sacrifier? Si le bonheur...
Mademoiselle entra et vit leurs visages animés.
—Geneviève, dit-elle, je vois que vous classez très proprement la musique. M. Viniès, je regrette de ne pouvoir vous retenir à dîner; ce départ nous donne trop de travail.
—Adieu, dit-il à Geneviève, et j'espère que vous reviendrez.
—Je reviendrai le premier mars mil huit cent quarante-cinq, répondit Geneviève, légère et souriante. Déjà mil huit cent quarante-cinq. Comme cela nous vieillit...
—N'oubliez pas de venir me voir quand cette vieille femme sera partie, dit Mademoiselle, et elle le conduisit avec fermeté vers la porte.
Le roi Louis-Philippe étant venu passer un mois au château d'Eu, le sous-préfet d'Abbeville reçut l'ordre d'amener dans sa chaise de poste au premier concert de la Cour M. d'Ouville et M. de Vence. Le Roi aimait Bertrand d'Ouville qui jugeait comme lui sans romantisme la politique de son temps; la Reine Marie-Amélie respectait M. de Vence qu'elle savait fidèle à la branche aînée. Car elle était légitimiste.
Comme l'archéologue suivait à travers les salons du château le petit sous-préfet solennel, un vieux général l'appela: ses broderies d'or rouillées et sombres, sa plaque de la Légion d'honneur ébréchée disaient la gloire de l'Empire. Entassé sur un divan, il suivait des yeux avec horreur un jeune officier qui évoluait, la taille sanglée d'une ceinture lie de vin.
«Qu'est-ce que c'est encore que cela, Bertrand? On a des inventions à présent... des inventions inconcevables...»
Il s'arrêta pour souffler bruyamment, puis grogna contre la campagne d'Algérie.
«Belle conquête ma foi! Une armée d'occupation qui n'occupe rien... la soumission des tribus? Cela consiste quand elles ont cinq cents chevaux à offrir une rosse à Bugeaud... Sur quoi nous pensionnons le chef... Au premier coup de fusil en Europe, ces pensionnés nous tireront dessus... Que diable allons-nous faire là-bas?... Tout cela ne durera pas dix ans.»
Un aide de camp s'approcha, sémillant, couvert de rubans, et fit signe à Bertrand d'Ouville qui voulut se lever. La lourde main du général l'arrêta:
«Attendez donc, mon cher, on ne se lève pas pour ces gens-là.»
Cependant le Roi congédiait aimablement M. le Maire, M. le juge de paix et M. le notaire de Gamaches: ils venaient de lui présenter un honorable industriel anglais qui fondait une usine dans le pays.
«Nous désirons vous avoir à dîner au château, conclut-il: à demain.»
Il répéta l'invitation en anglais, et à Bertrand d'Ouville, introduit après la députation, il expliqua que pour faire de bonne politique, il faut des Français qui sachent l'anglais et des Anglais qui sachent le français. Puis il blâma l'Empereur de Russie qui s'était sottement rendu à Londres la veille du bal des Polonais:
«À quoi bon aller chercher une avanie? Monsieur d'Ouville, Monsieur d'Ouville, les princes intelligents sont rares. Écoutez ceci et retenez-le: le secret de maintenir la paix est de prendre toutes choses par le bon côté, aucune par le mauvais...»
Il parlait avec une verve robuste et saine, sans jamais attendre les réponses. Ayant remercié l'archéologue pour une collection d'armes antiques offerte au Musée d'Artillerie, il l'interrogea sur l'esprit des populations que le Préfet de la Somme prétendait mauvais.
—Que veulent-ils encore? Je déteste la guerre; je n'aime ni le jeu, ni la chasse... M. Guizot me compromet; il a le courage de l'impopularité parmi ses adversaires; il ne l'a pas parmi ses amis.
L'aide de camp vint dire que le concert allait commencer.
L'orchestre attaqua l'Aria de Stradella. Bertrand d'Ouville, apercevant au fond d'un salon M. de Vence et le sous-préfet se dirigea vers eux.
—Le père de cet Ouville, dit M. de Vence en le voyant venir, était marchand de cuirs et se nommait Bertrand tout court, mais ayant fait fortune sous l'Empire en vendant des gibernes à Bonaparte, il a jugé bon à la Restauration de se faire noble, comme tout le monde... Quelle cour! ajouta-t-il. On n'y connaît personne. Des bourgeois vaniteux qui font les rodomonts. Si ce n'était pour mon fils qui voudra bientôt une ambassade, du diable si l'on m'y verrait.
—Monsieur de Vence, dit le sous-préfet, faites attention, on pourrait vous entendre.
—Je m'en moque bien, dit M. de Vence, je n'aime pas ces gens-là.
Et il murmura de sa voix de gavroche de bonne maison:
—Il y avait une fois un roi et une reine...
—Vous êtes injuste, dit Bertrand d'Ouville, le Roi est l'esprit le plus précis du royaume et a cette nuance de machiavélisme sans laquelle il n'est pas d'homme d'État.
—Sa Majesté est très bienveillante, dit le Sous-Préfet; l'an dernier, ici même, un domestique qui servait le souper, fut tenté par un perdreau froid et le mit dans la poche de son habit. Le Roi, qui seul l'avait vu, s'approcha et lui dit à voix basse: «Faites attention; les pattes passent.»
—C'est un brave homme, reprit Bertrand d'Ouville, qui a le malheur d'être prudent dans un pays exalté. Entre la Banque et la Garde nationale il manque de poésie. C'est une faute. La France peut vivre sans pain et sans liberté: sans gloire et sans émotions, elle souffre comme une femme ardente qu'exaspère un mari trop sage.
—M. d'Ouville, dit le sous-préfet, parlez plus bas: on pourrait vous entendre. Il est certain malheureusement que l'esprit est mauvais. On m'avertit ce matin que l'ingénieur des ponts et chaussées, M. Philippe Viniès, est à surveiller: un fonctionnaire! C'est déplorable.
L'orchestre joua le Désert de Félicien David.
—Quelle symphonie brillante et colorée, dit le sous-préfet; l'auteur est un saint simonien, mais il a du talent: les journaux l'appellent le Beethoven français.
—Vous aimez la musique? dit M. de Vence surpris.
—M. de Vence, dit le sous-préfet, j'ai divisé ma vie en trois parts. J'ai consacré la première au Roi, la seconde à l'amour et la troisième à l'art.
—Ce sous-préfet est bête comme une grenouille, dit M. de Vence à Bertrand d'Ouville quand les deux hommes se retrouvèrent seuls sur les pavés pointus de la Ville d'Eu, mais sa femme est une caillette assez grasse. Elle a divisé sa vie en trois parts; elle en consacre une au sous-préfet, la seconde au préfet et la troisième au maire: ce n'est pas maladroit.
Mme Bresson invita Philippe Viniès à dîner: il en fut très surpris et s'y ennuya bien. L'industriel discuta la politique du gouvernement; c'était surtout, semblait-il, un prétexte pour raconter ses débuts obscurs et sa brillante réussite. Catherine chanta, par ordre; elle semblait souffrir. Mme Bresson, petite vieille aux bras croisés, au regard aigu, fit subir à Philippe un interrogatoire serré sur sa famille, sa vie et ses projets d'avenir. Il ne conserva de cette soirée que le souvenir d'un frère de Mme Bresson qui, ferblantier de son métier, voyait dans la ferblanterie le secret du bonheur universel.
Il ne pensa nullement à rendre visite à Mme Bresson et ne remarqua pas une courte lueur de méchanceté dans ses yeux gris quand elle le rencontrait dans les rues d'Abbeville. Il avait d'autres soucis.
Geneviève à laquelle il avait pensé avec plaisir, mais avec beaucoup de calme, au temps où il la voyait chaque dimanche, était soudain devenue pour lui l'objet d'un sentiment exalté et violent.
—Il est complètement fou, disait Mademoiselle à Bertrand d'Ouville. Vraiment, mon cher, la plus grande force des femmes, c'est d'être absentes. Elles ne le savent pas assez.
Philippe vint lui conter son histoire qu'elle connaissait aussi bien que lui: il voulait l'adresse de Geneviève pour essayer de la voir à Paris et avait apporté une lettre qu'il désirait que Mademoiselle transmît avec une des siennes.
—Vous pouvez la lire: vous n'y trouverez rien qui ne soit l'expression d'un sentiment respectueux et tendre.
—Voilà qui m'est fort égal, lui dit la voix flûtée, je n'enverrai rien du tout. Écoutez moi bien, mon petit: je ne sais pas si Geneviève vous épousera ou non, mais ce que je sais, c'est que votre seule chance, c'est de ne pas écrire et de ne pas vous montrer. Si vous étiez un autre homme, je vous dirais aussi de courtiser Catherine Bresson et de céder à cette petite cabaretière assez jolie qui vous fait, me dit-on, les doux yeux. Mais vous êtes un saint, restez dans votre niche et n'en bougez point.
Il céda de mauvais gré, mais fit pourtant un voyage à Paris sous prétexte de voir son ami Lucien, qui l'emmena à une réunion de la Société secrète des Saisons.
Cela se passait dans l'arrière-boutique d'un marchand de vins: une vingtaine de conspirateurs, arrivés par petits groupes et feignant de ne pas se connaître, jouaient aux cartes et buvaient du vin bleu. Puis, un homme de garde ayant fait signe que la rue était tranquille, l'Agent Révolutionnaire, qui était Lucien, lisait l'ordre du jour, en s'abritant derrière un journal doctrinaire. C'était un programme très négatif.
«Il ne faut pas que l'association se compromette par des initiatives désastreuses. Le comité a décidé qu'elle attendrait quelque grande émotion populaire pour manifester sa puissance: alors elle apparaîtra, jettera son épée dans la balance et remportera un triomphe éclatant. Jusque-là sachons attendre et renfermons-nous dans une discrétion impénétrable, dans une prudence inflexible.
—Quelle résignation, dit Philippe à Lucien comme ils sortaient.
—C'est à ce prix qu'est la victoire, dit l'autre, et il lui présenta l'un des chefs du parti, monsieur Dourille, petit vieillard à barbe rouge et faunesque qui parlait comme le père Duchesne. «L'un des deux hommes qui connaissent le mieux les révolutionnaires de Paris», dit Lucien, qui goûtait un plaisir assez vif à penser que l'autre était le préfet de police.
Philippe crut partout voir Geneviève: il la reconnaissait dans toute silhouette un peu gracieuse et passa des heures, au théâtre, à regarder fixement au fond d'une loge un visage qu'il croyait être le sien.
Cependant les lettres que Mademoiselle recevait d'elle, heureuses et vives au début, étaient devenues désenchantées. Elle avait décrit avec tendresse ces soirées du Faubourg, modestes et fermées; l'orchestre composé simplement d'un piano, d'un violon et d'une flûte; le souper où l'on pouvait choisir entre un bouillon et un lait d'amandes, et les jeunes filles en robe de mousseline blanche, à ceinture bleue, rose ou lilas.
Puis, après un mois environ, le ton avait brusquement changé. C'était maintenant l'horreur de ces visites où l'on s'entretenait des goûts et des ridicules de gens qu'elle ne connaissait pas, de ces vieilles femmes sourdes et criardes, auxquelles il fallait aller se montrer et qui prononçaient haut et dru:
—Elle est fort bien, mais un peu maigre.
Une d'elle avait ajouté:
—Et point de gorge.
Et surtout elle protestait contre les mariages arrangés par ces douairières qui semblaient considérer un vieillard titré et riche comme un excellent mari pour une fille pauvre.
—Le mariage, lui avait dit sa tante, n'est point une question de sentiments, c'est un sacrement destiné à donner des enfants à l'Église.
«En vérité, mademoiselle, écrivait-elle, j'aurais autant l'idée d'épouser un Patagon que la plupart des hommes que je vois ici.
Je me suis fait de ma vie une idée plus belle. Sera-ce jamais plus qu'une idée? Un cher foyer dans la paix d'un vallon de chez nous, des livres, des fleurs, de belles choses. Et quelqu'un au cœur ardent, à l'âme haute... »
Il est honnête d'ajouter que Mademoiselle, bonne personne, se mit alors à parler dans ses lettres de Catherine Bresson, et de Clotilde, petite fille sensible d'un héros.
Je vous en conjure, soyez
bons pour la vie et ne l'assommez
point à coups d'a
priori. C'est une pauvre
femme, vieille et sale, qu'il
faut traiter avec sympathie:
elle y répond. Quand tout est
bien fini, la seule maxime qui
demeure est celle de l'héroïne
de Strindberg: «La race des
hommes est grandement à
plaindre.»
Rupert Brooke (Lettres).
Sur la place Saint-Sépulcre, les charrettes dételées, dressant vers le ciel leurs brancards parallèles, formaient de longues lignes jaunes, vertes et brunes. Les fermiers, les bonnes femmes et les enfants grouillaient dans les vieilles rues. Le parler picard, savoureux et lent, amusait les oreilles de son perpétuel chuintement.
Bertrand d'Ouville s'arrêta au coin de la place et suivit les mouvements des taches bleu vif des blouses.
Dans un coin, des gamins faisaient cercle autour d'un vieux mendiant vêtu d'une longue redingote verte et d'une casquette surprenante qu'eût enviée Frédérick Lemaître.
L'archéologue s'approcha. Cabotin, dit la Ressource, achevait de jouer la Dame blanche. Des cercles tracés à la craie sur les pavés représentaient les personnages, et il passait de l'un à l'autre suivant les mouvements du dialogue.
La pièce terminée, le vieux cabot, faisant deux pas en avant, salua, toussa et chanta, d'une voix étonnamment fausse, sur un air de vaudeville à la mode:
Que le Beefsteak s'allume sous la treille;
Que chaque fille possède un amoureux;
Buvons, chantons, cette liqueur vermeille;
Faisons des vœux pour qu'ils soient tous heureux.
—Ce petit couplet est charmant, pensa Bertrand d'Ouville en lançant quelques sous au bonhomme. Le sens littéral n'est pas fort clair, mais l'ensemble suggère une impression de paix et de bonheur: que peut-on demander de plus à un poète?
Puis, comme il avait bien déjeuné, il se prit à admirer le bel ordre de la nature:
—Tous ces hommes en blouse, en redingote, qui se croisent, s'agitent et se mêlent sur ces pavés antiques, pensait-il, ont une place dans la société telle que six mille ans de civilisation l'ont faite. Ils ne sont pas tous satisfaits de cette place, ils ne sont pas très bien payés, ils ne sont pas très bien nourris, mais quelqu'un les paie, quelqu'un les nourrit et c'est un fait qu'on meurt assez rarement de faim en France. Cela est remarquable et eût fort étonné ces grands inconnus de l'époque quaternaire qui inventèrent la hache de pierre, et pour lesquels la famine était sans doute une habitude. Dans cette belle machine tout se tient et les métiers ont entre eux des rapports compliqués qui se sont établis par des siècles de lente friction. Cette vieille est venue pour vendre ses lapins, ce fermier pour voir le notaire, dont la femme achètera les lapins, ce voiturier a fait le voyage pour amener la bonne femme et le fermier, ce marchand ambulant pour vendre de la toile au voiturier. Le fermier, le notaire et le voiturier iront se faire tailler la barbe chez Pingard: le cabaretier Pitollet les nourrira et Cabotin, dit la Ressource, vient de gagner les six sous de son repas parce que mon père, monsieur Bertrand, en vendant des cuirs à l'Empereur, m'a légué le loisir injuste de regarder vivre les autres.
Tout cela est admirable.»
Toutefois, en s'en allant au long des rues encombrées et en souriant aux jolies filles de son tailleur, il n'était pas sans admettre qu'il eût trouvé ce monde médiocre s'il avait dû lui-même déjeuner pour six sous. Cela le fit penser à Viniès qui n'eût pas manqué de le lui faire remarquer, et ayant ainsi évoqué le nom de l'ingénieur, il s'avisa qu'il n'avait pas vu les Viniès depuis bien longtemps. Ils s'étaient mariés au mois de janvier 1846 et pendant deux mois ne s'étaient pas montrés. Il décida que cet isolement avait assez duré et les invita à dîner.
Il les jugea heureux: chacun d'eux approuvait des yeux ce que disait l'autre. Geneviève se serrait contre son mari et répétait ses phrases familières. Philippe, retrouvant ses discours dans cette bouche charmante, admirait l'esprit de Geneviève et sa sagesse politique.
Ils le prièrent de venir les voir: il eut soin de s'y rendre un jour où il savait Philippe absent. Ils occupaient une petite maison de briques, assez laide, dans un faubourg. Geneviève lui montra son domaine, un petit jardin de presbytère, plates-bandes de légumes et de fleurs chétives entourant trois pieds carrés de gazon chauve.
Ils vivaient d'eau claire, de fruits, de lait, de crème et de salade, la viande étant un préjugé. Une petite bonne qui les jugeait fous les servait avec une terreur respectueuse et poussait des cris quand elle trouvait, en apportant le plat suivant, Philippe déclamant à tue-tête un article de la Réforme et Geneviève au piano chantant les Deux Grenadiers.
Cette bohème rustique était d'ailleurs aimable; le goût de Geneviève la sauvait du désordre. Philippe eût été heureux dans une chambre aux murs blanchis à la chaux et aux meubles de bois blanc. Elle était plus exigeante et avait su trouver pour fort peu d'argent des meubles anciens et sobres dont elle avait fait une chambre vivante qui servait de salon et de salle à manger.
—Et vous ne vous ennuyez jamais?
—Jamais. Le matin, j'ai ma maison; Philippe m'emmène souvent dans ses tournées. Le soir, je fais de la musique ou bien nous lisons à haute voix. Philippe m'apprend aussi les mathématiques.
—Pourquoi faire, mon Dieu?
—Mais cela m'amuse.
—Voyez-vous souvent Mademoiselle?
—Un peu, oui: mais il est assez difficile d'aller à Epagne... Philippe travaille toute la semaine, le dimanche il aime rester ici. Et puis très franchement, le monde nous ennuie.
—Ne le dites pas trop: le monde est sévère pour ceux qui le méprisent.
—On ne peut pourtant lui sacrifier son bonheur, dit-elle, s'il fallait obéir à des règles absurdes et à des conventions inutiles, la vie deviendrait odieuse.
«Absurde... odieuse... » pensa-t-il. Ah! que mon rhéteur a vite gâté mon amazone.
Et le lendemain il alla à Epagne, pour la première fois depuis le mariage de Geneviève. Il trouva Mademoiselle assez souffrante; elle vieillissait.
—Je crois, lui dit-elle, qu'il me faudra passer désormais l'hiver dans le sud: je ne supporte plus les brouillards de la Somme... D'ailleurs je suis très seule: Catherine n'est plus jamais ici: sa mère le lui défend, je ne sais pourquoi. Vous-même devenez bien rare. Geneviève...
—Je l'ai vue deux fois, elle me paraît avoir subi l'influence de son mari plus que je ne l'aurais imaginé. Elle m'a parlé de Guizot, de la Pologne, du fouriérisme et du monde dans le meilleur style Viniès.
Mademoiselle retrouva pour répondre sa voix flûtée et nette.
—Eh, mon cher! Que les femmes dépendent pour leurs idées de ceux qu'elles aiment, ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas de moi... Ce qui m'étonne toujours, c'est que les hommes s'y laissent prendre et recherchent ce qu'ils appellent «les femmes intelligentes». C'est une dépravation.
—Un vieil Anglais que j'aime, dit à peu près: Il en est d'une femme qui parle politique comme d'un chien qui marche sur ses pattes de derrière: c'est mal fait, mais surprenant.»
—Je ne crois pas, continua-t-elle, que Geneviève souffre longtemps de cette maladie: elle est trop femme. Mais elle joue un jeu dangereux: je lui avais conseillé de conserver quelque mystère. «Je dis tout à Philippe», m'a-t-elle répondu fièrement. Elle lui a sans doute dit mes conseils: depuis il me tient à l'écart. Je ne me plains pas: j'ai voulu les joies de la maternité, je les ai.
Mais ces enfants sont des sots. Viniès croit qu'il a épousé une sorte de nymphe immortelle qui se nourrira d'ambroisie, l'escortera dans ses voyages et trouvera toujours son bonheur à l'entendre discourir sur la réforme et la vertu. Ah! bien oui! Sa nymphe est avant tout un corps, et un corps de femme, fragile, exigeant, obsédant. Elle aura des enfants, et ça n'est pas drôle, mon cher, quoique nous autres vieux garçons puissions en penser. Bientôt les promenades la fatigueront, la politique l'ennuiera et elle commencera à se demander à qui elle a consacré ce besoin éperdu de dévouement qui la tourmentera toute sa vie. Alors leur mariage commencera, mon cher, et il peut très bien tourner, mais encore faut-il que tous deux se donnent la peine d'y aider...
Les erreurs des adolescents sont agréables au cœur des vieillards et Bertrand d'Ouville amusé par la véhémence de la vieille dame, pensait sans trop de tristesse aux jours difficiles qui attendaient peut-être ses jeunes amis.
—Je n'ai jamais très bien compris, dit-il, pourquoi vous sembliez tenir à ce que ce mariage se fît. Si vous n'aviez encouragé Geneviève, elle n'aurait pas trouvé la force nécessaire pour vaincre l'opposition des Vaulges de Paris, qu'elle aimait assez. Certes Viniès est un honnête homme, mais elle le vaut cent fois. Et ils sont pauvres. Qu'avait-elle? Deux mille livres de rente, lui son traitement. Dans son jardin d'ouvrière, elle m'a fait l'effet d'une reine en exil.
—Je ne regrette rien, dit-elle. Viniès est un des très rares hommes qui peuvent faire de bons maris: mieux vaut une vie difficile avec l'un d'eux...
—Viniès? un bon mari? mais pourquoi?
—Cherchez, mon cher, si je vous disais tout... Et il ne faut pas trahir son sexe.
Le long de la route qui le ramenait à Abbeville, il admira les collines arrondies comme de belles épaules et les creux d'ombre de leurs aisselles. Quand il entra en ville, les cloches infatigables de Saint-Vulfran sonnaient quelque office mystérieux et les corbeaux, heureux, tournoyaient autour du clocher sonore.
Geneviève, assise un dimanche matin sur l'unique banc de son jardin de curé, regardait Philippe qui lisait ses journaux et ses lettres; elle l'examinait avec tendresse et avec un peu d'anxiété.
«Si proche... pensait-elle... si proche... et pourtant si lointain.»
Philippe, sentant qu'elle le regardait, leva les yeux un instant et lui sourit: elle lui renvoya son sourire, et rassuré, il retourna à ses lettres.
«Quand, toute petite, je désirais jouer avec mon père, il me souriait de cette façon pour me faire prendre patience... Mais ce n'est pas ça, Philippe: ...Tu aimes une Geneviève de ta création, je veux que tu aimes la véritable.»
Elle réfléchit tout en suivant des yeux deux papillons qui se poursuivaient.
«La véritable? Je ne la connais peut-être pas bien moi-même... Mais si, car j'en ai dit assez, j'en ai dit mille fois davantage à Mademoiselle et même à Catherine... mais c'étaient des femmes...
À ce moment Philippe, agitant brusquement une lettre qu'il venait d'ouvrir cria:
—Geneviève, Lucien accepte de venir passer ici quinze jours.
—Tu es content? dit-elle.
Elle avait quelque peine à partager son enthousiasme: la solitude est une habitude dangereuse et douce, et le souci de son étroit budget lui faisait mesurer le prix de l'hospitalité.
Mais elle se reprocha tout de suite cet égoïsme. Pour Philippe l'idée qu'un homme allait venir, avec lequel il pourrait échanger, des pensées d'homme en style d'homme, semblait le ravir comme un jeune chien qui en voit arriver un autre dans une maison jusque-là morose. Et quant aux soucis d'argent, il les méprisait assez pour les laisser à sa femme.
*
* *
Il expliqua longuement Lucien à Geneviève: il semblait craindre qu'il ne lui plût pas.
—Il est assez froid et tranchant et se divertit souvent à jouer le vieux politique prudent et grave. Mais, au fond, ses sentiments sont les nôtres. Nos amis de Paris l'estiment beaucoup: M. Dourille lui-même me l'a dit...
Ainsi préparée, elle le trouva plus agréable qu'elle ne l'avait imaginé: une calvitie commençante, un visage extrêmement maigre mais fin, un teint d'ivoire chinois et de longues mains. Il s'habillait presque en dandy, et disait d'une voix lente des anecdotes souvent amusantes sur les grands hommes du parti.
La beauté de Geneviève et son esprit l'étonnèrent:
—Ta femme est délicieuse, dit-il à Philippe dès qu'ils furent seuls, éclatante de fraîcheur et d'intelligence.
Des jours heureux commencèrent. Lucien occupait sous le toit une petite chambre d'une simplicité antique mais il y avait au mur un Debucourt aux tons charmants que Bertrand d'Ouville avait donné à Geneviève, et des fleurs étaient toujours fraîches dans un vase rustique et républicain à souhait.
Le matin tous trois déjeunaient ensemble. Puis Philippe allait à son bureau et Lucien remontait travailler ou lire dans sa chambre tandis que Geneviève et la petite bonne faisaient le ménage. Les repas demeuraient de fruits et de fromage, selon le cœur de Philippe. L'après-midi, Lucien devait, d'après le programme, accompagner Philippe dans ses tournées, mais au bout de deux jours il offrit de se promener avec Geneviève que Philippe fit accepter.
Après le dîner elle lisait à haute voix, le plus souvent des vers: puis les deux hommes parlaient de réformes et de complots; Philippe faisait une consommation terrible des mots vertu, désintéressement, liberté, et l'on se couchait très tard.
*
* *
Geneviève s'étonnait de trouver un plaisir assez vif à la compagnie de Lucien. Il avait de l'élégance et de la clarté dans l'esprit, et par contraste avec la véhémence romantique de son mari, elle goûtait cette sécheresse un peu glacée.
Avant de devenir un coquin, il avait lui-même vécu une jeunesse ardente. Chassé de l'armée pour ses opinions républicaines, il était entré dans la lutte avec conviction. Mais d'un orgueil insensé, et se voyant subordonné à des bavards qu'il méprisait, il avait tourné à l'aigre, et s'était fait policier par dépit de ne pouvoir être chef de parti. Il apportait dans la trahison un dilettantisme d'une nature singulière.
Il se divertissait à scandaliser Philippe en lui lisant de petits écrits cyniques. Un soir il composa pour lui la «lettre d'apprentissage du fonctionnaire»:
«Écris beaucoup: agis peu. Concevoir est facile, réaliser est difficile: pour un fonctionnaire intelligent le rapport est une fin et non pas un moyen.
Souviens-toi que les relations l'emporteront toujours sur les talents.
Si tu veux être un bon fonctionnaire, commence par être un bon vivant. Toute vraie camaraderie est fondée sur des vices communs. C'est devant la bouteille, la viande et la courtisane que ton chef sera ton égal...
—Assez protesta Geneviève.
—C'est précisément ce que dit l'abbé de Goethe, madame. «En voilà assez pour aujourd'hui: il ne faut pas effrayer les jeunes gens...»
Seul avec elle, il se sentait assez libre, et dans son désir d'étonner cette femme qui lui plaisait, il en disait parfois un peu plus que sa politique ne l'eût approuvé.
Elle lui savait gré de comprendre la beauté de sa petite ville et d'avoir pour l'indifférence héroïque de ses bourgeois plus d'indulgence amusée que Philippe.
Sur la place du Saint-Sépulcre où, huit cents ans auparavant, le comte Guy de Ponthieu avait passé la revue de son armée d'Orient, Lucien écoutait avec complaisance Cabotin, dit La Ressource, jouer, solitaire et magnifique, le Bâtard de Duguesclin.
—À la vérité fort bien, disait Duguesclin à ses hommes d'armes, représentés par de petits cercles blancs sur les pavés, à la vérité fort bien, nous autres, hommes du moyen âge, ne devons pas oublier que nous partons demain pour la guerre de Cent Ans.
«Nous autres hommes du moyen âge» est charmant, disait Lucien; est-ce plus comique d'ailleurs que le « nous autres hommes de progrès» de ce vieux Philippe? Il part volontiers, lui aussi, non pour la guerre de Cent Ans, mais pour la Paix Éternelle. C'est bien la même chose.
—Mais, dit-elle, avec un loyalisme conjugal un peu hésitant, est-ce bien à vous de railler Philippe? Vos opinions sont les siennes...
—Les hasards de la vie, dit-il, font que nous appartenons au même parti: mais les partis sont des groupes artificiels. Il y a en réalité deux sortes d'esprits: des esprits aristocratiques et des esprits sentimentaux... La condition dans laquelle les Dieux les ont fait naître importe peu: un mendiant peut avoir l'esprit aristocratique et je sais plus d'un banquier qui pense en esclave sentimental. Mais rien ne peut réconcilier ces deux types. Et quand un esprit maître s'avise de jouer à l'esclave, il lui en cuit, comme il advint à ce grand Chamfort que ses amis politiques torturèrent si bien. Il en tira trop tard cette leçon: que les sots ont dans le monde un grand avantage, c'est qu'ils s'y trouvent partout parmi leurs pairs.
Il la regarda hardiment.
—Vous, par exemple, continua-t-il, vous êtes une aristocrate, que vous le vouliez ou non...
Elle ne répondit pas. Le mendiant achevait son mélodrame. Duguesclin et le Roi d'Angleterre, mystérieusement réconciliés, chantaient avec leurs hommes d'armes le vaudeville final:
Que le beefsteak s'allume sous la treille
Que chaque fille possède un amoureux,
Buvons, chantons, cette liqueur vermeille
Faisons des vœux pour qu'ils soient tous heureux!
*
* *
—Qu'allons nous faire maintenant, dit-elle? Voulez-vous aller voir le cloître de l'Hôtel-Dieu? C'est le seul coin, que vous ne connaissiez pas encore.
—Très volontiers, je suis d'humeur à tout trouver charmant.
Elle était à la fois un peu effrayée et très heureuse.
Les arcades grêles et gracieuses du petit cloître encadraient une pelouse maigre: ils tournèrent lentement sur ces dalles si anciennes qui étaient les pierres tombales de moines et de seigneurs oubliés.
—J'aime cette promenade mesurée, dit-elle avec animation: on y sent ses pensées limitées comme ses pas. Est-ce parce que j'ai été élevée au couvent? Mais la vie monastique m'attire, comme une sorte de suicide inoffensif et doux.
—Je me ferais volontiers moine, dit-il, cela n'a rien de médiocre et l'on doit pouvoir goûter dans cet état, qui vous soustrait aux soucis du monde, des jouissances intellectuelles effrénées... Mais aussi on ne vit qu'une fois et je suis certain que les âmes qui dorment sous ces dalles de pierre regrettent éternellement les occasions de plaisir qu'elles ont laissé échapper sur terre...
*
* *
Le soir, Philippe remarqua que Geneviève était sombre et traitait avec sécheresse et ironie Lucien qui demeurait très gai et conservait son ton sarcastique.
Comme il avait risqué sur la petite bonne et ses terreurs une plaisanterie qui amusa Philippe:
—Je ne trouve pas cela drôle, dit Geneviève, glaciale.
Quand ils furent seuls dans leur chambre, Philippe s'assit sur le lit et conserva un silence lourd.
—Qu'est-ce que tu as, dit enfin Geneviève qui se déshabillait lentement.
—Je trouve, dit-il, que tu as été ce soir hautaine et dure.
Elle secoua les épaules avec impatience.
—Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Son corps nu et charmant se montra un court instant sans qu'il y prît garde; elle se mit au lit. Philippe restait assis dans une attitude accablée.
—Qu'as-tu? dit-elle encore avec douceur et lassitude.
—Je ne veux pas que tu traites mes amis avec ce mépris. Et ceci surtout quand il s'agit d'hommes comme Lucien qui est non seulement un camarade d'école, mais un camarade de lutte... Je ne prétends t'imposer aucune contrainte, continua-t-il avec plus de bonne grâce, mais vois toi-même: comment pouvons-nous espérer fonder un état de choses fraternel si nous ne sommes pas capables de vivre en paix les uns avec les autres.
—Allons dit-elle, avec un sourire un peu triste: c'est toi qui le veux... Tu tiens à savoir pourquoi je méprise ton Lucien: c'est parce qu'il est méprisable.
Il eut un geste d'impatience.
—Écoute: depuis que j'ai accepté, sur tes instances, de me promener avec lui, il n'a cessé de m'accabler de compliments sur ma beauté, mon charme, mon esprit... Puis il a insinué que ton intelligence et la mienne étaient de qualités bien différentes, que tes enthousiasmes politiques étaient bien puérils...
—Lucien? fît-il, atterré.
—Attends... Ayant, je pense, jugé qu'il avait ainsi fort bien préparé son terrain, il a fini par m'expliquer ce matin, au milieu du cloître de l'Hôtel-Dieu que l'on ne vit qu'une fois, qu'il ne faut pas négliger aucun plaisir, que d'ailleurs il m'aimait...
—Lucien, répétait-il, Lucien!...
—J'ai fait appel à son honneur: il m'a dit que c'était un mot... je l'ai quitté brusquement: je voulais courir à ton bureau et te prévenir. En route j'ai réfléchi: il devait partir dans peu de jours, j'ai pensé qu'il valait mieux te laisser l'esprit en repos.
—Tu as eu tort.
—Peu importe, puisque je n'ai pu dissimuler mon mépris.
Ils parlèrent toute la nuit de cette grande trahison et les sentiments de Philippe surprirent étrangement Geneviève. Ce n'était pas l'amour inquiet et la fureur du mâle, mais surtout l'orgueil blessé et l'atteinte à son idéal politique.
—Enthousiasmes puérils, répétait-il; es-tu certaine qu'il a dit cela? Quels étaient ses mots exacts?
Parce que Lucien avait agi bassement il désespérait soudain de l'humanité.
Le lendemain matin, après un déjeuner pesamment silencieux, Philippe pria Lucien de l'accompagner. À son ton solennel, Lucien prévit le pire. Il chercha une attitude. Ironique? Dramatique? Dramatique valait mieux: Philippe était un sot.
Il pleuvait: les cloches de Saint-Vulfran sonnaient à petits coups un glas funèbre, les corbeaux tournoyaient dans le ciel gris. Les deux hommes marchaient en silence: Lucien, très calme se demandait avec curiosité sous quelle forme allait commencer la querelle. Son esprit, souple, ramassé sur lui-même, se tenait prêt à la parade.
—Geneviève m'a raconté votre conversation d'hier, dit enfin Philippe... C'est pour moi un coup terrible qui anéantit tout mon être. Je ne comprends pas; je t'avais placé si haut, je t'aurais tout confié. Si tu m'as trahi, je désespère des hommes, mais je ne veux pas te condamner sans t'entendre.
—Ce que ta femme t'a dit est certainement exact, Philippe. Et cela est aussi affreux pour moi que pour toi. Je ne puis rien t'expliquer parce que tu ne peux comprendre. Tu es un esprit, tu n'as pas de corps. Tu vis de lait et de miel, tu bâtis des Icaries et tu prétends réformer les hommes: tu ne les connais pas. Ta femme est jolie à tenter un saint; tu me la fais promener par un printemps divin.
Moi, mon cher, j'ai un corps... Oui, je sais, je te dégoûte: crois-tu que je ne me dégoûte pas moi-même? Je sais: j'ai abusé de ta confiance, je suis un misérable. Mais tout de même ne me méprise pas trop. Après cette minute de tentation, de folie, je reste l'homme que tu as connu. Je reste capable de dévouement à une cause et à une idée. Un être humain est complexe, Philippe. La violence de la passion est une chose terrible quoique tu sembles l'ignorer. Et je souffre certes plus que toi...
Ils étaient arrivés à la porte du bureau de Philippe, mais ils la dépassèrent et continuèrent sous la pluie méthodique et tenace leur dialogue un peu théâtral.
Philippe à sa grande surprise se sentait assez agréablement ému: des phrases généreuses et des pensées élevées s'ordonnaient dans son esprit en périodes élégantes. Il avait l'impression d'être l'un des personnages d'un drame puissant qui le dépassait. Toute la matinée, ils errèrent par les routes détrempées.
Quand ils revinrent à midi, Lucien annonça d'un ton parfaitement naturel qu'il quitterait Abbeville le jour même.
Pendant tout le repas Philippe et lui parlèrent avec animation de projets politiques. Philippe devait poursuivre auprès des ouvriers de la région une propagande active dont Lucien lui fournirait les éléments.
Quand il monta faire ses malles:
—Eh bien? dit Geneviève ardente.
—Eh bien, il m'a tout expliqué et je crois qu'il était sincère.
—Expliqué? Et comment?
—Il reconnaît qu'il a une nature vicieuse, corrompue par la facilité de la vie de Paris. Il voudrait se vaincre; il n'y réussit pas toujours, il souffre... Enfin je lui ai pardonné; complètement, pleinement, pardonné... Il ne viendra plus ici, mais je resterai son ami et j'essaierai de le ramener à la vertu. Nous continuerons à travailler ensemble à une besogne plus grande que nos ressentiments humains... Tu avais d'ailleurs mal compris sa phrase sur mes enthousiasmes; il n'a jamais prononcé le mot «puérils»... Enfin il était pâle, abattu et repentant.
Geneviève, le menton dans les mains, réfléchissait et s'étonnait de penser avec un sentiment étrange, mêlé de haine et de regret, à la voix subtile de Lucien et à son visage d'ivoire jauni.
Le rapport de l'ingénieur Viniès sur l'amélioration de l'entrée de la Baie de la Somme, publié à ses frais vers la fin de 1845, souleva aussitôt des passions qui surprirent vivement l'auteur. Il n'avait pensé remuer que du sable et des pierres; il découvrit qu'il mettait en mouvement des égoïsmes vivants et féroces.
D'Abbeville, du Crotoy, du Hourdel, les chambres de commerce et les conseils municipaux protestaient à l'envie: chaque jour on lui communiquait des extraits de délibérations qui disposaient avec ironie des conjectures de M. l'Ingénieur.
Tous citaient des témoignages des capitaines qui fréquentaient la baie, des pilotes, qui, comme le disait vigoureusement M. le maire du Crotoy «étaient nés dans son sein».
Selon les uns, le chenal se redresserait sans s'approfondir, selon les autres il devait s'approfondir sans se redresser; une troisième école soutenait que la baie s'ensablerait complètement après l'exécution des travaux.
Abbeville surtout déclamait sur un ton tragique: «Considérant que, si les travaux étaient exécutés, le commerce maritime d'Abbeville serait complètement anéanti au profit de Saint-Valéry.
Considérant que le gouvernement ne peut vouloir la ruine d'une ville populeuse et industrielle qui a fait de si grands sacrifices pour le percement du canal alors que la nature lui avait assuré une prompte communication avec la mer...»
Les accidents les plus terribles étaient prédits si le contre-fossé du canal était mis en communication avec un bassin à flot comme le proposait M. Viniès. Toutes les propriétés de la basse vallée de la Somme seraient inondées, les récoltes noyées sous trois mètres d'eau. Dans cette terre spongieuse les maisons s'écrouleraient.
—Mais comment peuvent-ils contester des chiffres? dit Philippe à l'ingénieur en chef.
—Comment, en effet? grogna le vieux lion.
—Le grand malheur de la France, lui dit Bertrand d'Ouville, en réponse à ses plaintes, c'est que les intérêts de clocher ou de parti l'emportent dans l'esprit de chacun sur l'intérêt général.
Voyez, au contraire, cette Angleterre que vous n'aimez pas: sir Robert Peel vient d'y émanciper, contre le programme de son propre parti, les catholiques d'Irlande. Et c'est lui, conservateur représentant des fermiers protectionnistes, qui propose d'abaisser les tarifs à l'importation. Quel exemple pour M. Guizot!...
Geneviève à laquelle Philippe exposa longuement ces difficultés, était compatissante, mais un peu lointaine. Elle comprenait mal les détails techniques et traitait le débat tout entier avec assez de détachement: «C'est des affaires d'homme» disait-elle, retrouvant une vieille phrase de Mademoiselle.
Elle était enceinte et semblait acquérir rapidement un réalisme étroit et vigoureux. Elle taillait de petites robes, lisait des livres de médecine et s'inquiétait parfois de voir Philippe dissiper si rapidement leurs revenus en souscriptions pour la Pologne libre ou l'émancipation des nègres.
D'ailleurs elle-même avait des ennuis: elle remarquait depuis quelque temps que les dames d'Abbeville qu'elle avait connues autrefois et qu'elle rencontrait à l'Église la traitaient avec une extrême froideur. Dans les magasins elle surprenait des regards moqueurs quand elle entrait. Catherine Bresson qu'elle voyait parfois et qui devenait une grosse fille indolente lui avoua «qu'on disait beaucoup de mal d'elle en ville».
—Mais quoi?
—Je ne sais pas: je n'ai jamais rien entendu, mais ma mère me l'a raconté.
—Que t'importe ce qu'on dit? objecta Philippe. «On» est un monstre mythique, rien de plus.
—Je sais, mais cela m'agace et me rend nerveuse.
Elle résolut d'aller voir Mme Bresson.
—Quelle est cette histoire, mon Dieu? dit celle-ci, croisant ses bras maigres et levant les yeux au Ciel. Catherine est folle d'être allée vous parler de ces sottises. Je n'ai rien entendu... Elle aura de mes nouvelles.
—Il est possible qu'elle se soit trompée... Voulez-vous la faire appeler?
—Mais non, c'est inutile, dit la petite vieille très agitée; vous savez comme moi qu'on exagère toujours.
—Madame, dit Geneviève, avançant son petit menton fin, je ne sortirai pas d'ici avant que vous ne m'ayez répété les propos qui se tiennent sur mon compte. On ne peut exagérer quand il n'y a rien.
Elle dut lutter encore assez longtemps, mais à la fin sa volonté précise triompha de la résistance rageuse de Mme Bresson.
—Ma pauvre petite, cela m'ennuie bien de vous répéter ces horreurs dont je ne crois pas un mot, mais vous le voulez... D'abord tout le monde dit que votre mari est un communiste.
—Ceci, dit Geneviève est affaire entre lui et ses chefs; ce n'est d'ailleurs pas de cela que parlait Catherine.
—Eh bien! On dit surtout que, si vous avez accepté à votre retour de Paris d'épouser un homme qui n'était pas en somme de votre monde... c'est que vous ne pouviez faire autrement.
—Que je ne pouvais faire autrement? Mais pourquoi? dit Geneviève stupéfaite.
—Parce que vous vous étiez compromise à Paris, parbleu! dit triomphalement la vieille dame.
—Mais qui a inventé ces sottises?
—On dit aussi, continua Mme Bresson, qui maintenant semblait prendre un certain plaisir à voir la colère étonnée de Geneviève, que vous avez été la maîtresse d'un ami de votre mari qui est venu chez vous il y a six mois... Là, il faut avouer, ma pauvre petite que vous avez été bien imprudente... Comment? Vous, une jeune femme, vous laissez un homme s'installer chez vous pendant quinze jours, vous vous montrez seule en ville avec lui?... Vraiment, que voulez-vous qu'on pense?
—Évidemment, dit Geneviève, et qui vous a dit tout cela, madame?
Il lui fallut de nouveau lutter pour obtenir une réponse. À la fin la petite vieille jeta mystérieusement.
—Mme Grandin.
Geneviève demeura stupide, Mme Grandin? Une vieille dame, assez hautaine, qui passait à Paris tout l'hiver et ne voyait guère les Abbevillois que dans les comités de bienfaisance.
—Mais elle ne me connaît pas... Je ne lui ai jamais parlé. Elle m'était plutôt sympathique: elle a l'air grave et bon. Pourquoi me calomnierait-elle?
—Quelque domestique lui aura...
—Mais elle ne sait même pas mon nom; elle s'occupe si peu des gens d'ici... C'est bien simple, je vais aller la voir.
Cette fois, Mme Bresson parut vraiment émue.
—Surtout ne faites pas cela: elle refusera de vous recevoir.
—Tout cela est bien étrange, dit Geneviève.
Et elle alla demander conseil à Philippe: elle s'était d'abord promis de lui épargner ces ignominies, mais après son effort pour rester calme chez la mère Bresson, ses nerfs l'abandonnèrent. Elle pleura; Bertrand d'Ouville, qui survint, trouva Philippe la consolant et quand l'histoire lui fut contée, offrit d'aller voir Mme Grandin.
—Je la connais très bien, dit-il, elle est charmante et a beaucoup de goût. Cela m'étonne d'elle plus que de toute autre... Mais sait-on jamais? La méchanceté est une maladie si fréquente chez les vieilles femmes.
—Mais la méchanceté sans motifs? dit Geneviève.
—C'est une chose terrible d'avoir été jolie et de ne plus l'être: vous verrez cela... Mais attendons avant de juger.
Il revint deux heures plus tard, enchanté: à son sourire Philippe et Geneviève qui étaient restés à disserter assez tristement de la méchanceté humaine se sentirent plus gais.
—J'ai fait de bonne besogne, dit-il, ouvrant sa redingote au col de velours noir et croisant d'un air satisfait ses jambes maigres.
—Racontez vite, dit Geneviève animée.
—J'ai d'abord vu Mme Grandin. Jamais femme ne fut plus surprise. Elle n'a jamais dit un mot de ces sottises. Un jour, en sortant de la messe, vous trouvant jolie, elle a demandé votre nom à Mme Bresson qui était à côté d'elle. L'autre commença aussitôt à vous dénigrer.
Sur quoi, Mme Grandin m'ayant offert de répéter tout ceci devant la Bresson, je me précipitai chez celle-ci.
—Cela devient très amusant, dit Geneviève, excitée et joyeuse.
—Là, j'ai d'abord fait la bête: j'ai dit qu'il courait des bruits, que j'étais votre ami, que je voulais savoir. Elle m'a défilé son chapelet, ses petits yeux sournois brillants de joie, et, en vous citant, je suis parvenu à lui faire nommer Mme Grandin. Alors, comme vous dites, ce devint très amusant...
À mon récit de ma visite à cette dernière, l'estimable vieille femme pâlit, m'injuria et me mit à la porte... Nous voilà brouillés: j'en suis charmé.
—L'horrible femme, dit Geneviève (avec une intonation si vive et si sincère que le vieillard, grand amateur de sentiments vrais, la nota avec joie), l'horrible femme... Mais pourquoi? Je ne lui ai jamais rien fait.
—Comment? dit-il. Rien fait? Mais vous paraissiez heureuse: n'est-ce pas assez?
Deux événements marquèrent pour les Viniès le début de l'année 1847: Geneviève eut un fils dont Bertrand d'Ouville fut le parrain et Philippe découvrit l'Histoire des Girondins que Lamartine venait de publier.
Il en avait les cinq volumes à son bureau et en apportait toujours un à l'heure des repas pour ne pas interrompre sa lecture: Geneviève elle-même, jeune mère encore pâle, devait écouter le nouvel évangile.
—Enfin, disait Philippe; enfin un homme politique capable d'entraîner des masses, ose écrire l'éloge de ces temps admirables et tu vas voir comme il suffira de l'écho de ces voix puissantes pour réveiller la France. Écoute, Geneviève: «Dès les premières impulsions de la Révolution, il n'y a qu'un rôle pour le chef d'un pays, c'est de se mettre à la tête de l'idée nouvelle, de livrer le combat au passé et de cumuler ainsi dans sa personne la double puissance de chef de la nation et de chef de parti. Le rôle de la modération n'est possible qu'à la condition d'avoir la confiance entière du parti qu'on veut modérer.»
—Comprends-tu la valeur d'une telle phrase écrite par un tel homme? Cela permet tous les espoirs.
—Oui, dit Geneviève, mais viens déjeuner.
—... Et ceci: «Il n'est pas donné à l'irréligion de détruire une religion sur terre. Il faut une foi pour remplacer une foi. La terre ne peut pas rester sans autels et Dieu seul est assez fort contre Dieu.
—Oui, cela est beau, dit Geneviève, avançant le menton et abaissant la tête d'un air satisfait.
—«Les hommes de l'Assemblée Constituante, déclamait Philippe, n'étaient pas des Français: c'étaient des hommes universels, des ouvriers de Dieu appelés par lui à restaurer la raison sociale de l'humanité et à ramener le droit et la justice par tout l'univers.»
Ah! cela fait du bien d'entendre enfin ces choses: il faut que je fasse lire tout cela à parrain...»
Mais le parrain, comme ils l'appelaient maintenant, demeura rebelle à l'enthousiasme: il se borna à leur citer les mots à la mode: «Lamartine a doré la guillotine»; «élevé l'histoire à la hauteur du roman». Sa réputation d'incurable frivolité devint de plus en plus un des lieux communs des Viniès.
—Si j'écrivais à Lamartine, dit Philippe.
—Il ne répondra jamais.
—Sans doute, mais il doit être précieux pour lui, j'imagine, de sentir que des jeunes gens sont prêts à le suivre au combat.
*
* *
Vers la fin d'avril une lettre arriva, d'une petite écriture fine et penchée. Geneviève, devinant tout de suite, déchira vivement l'enveloppe et lut avec une émotion délicieuse.
Saint Point
«Je vous réponds, monsieur, du fond de cette solitude où je suis venu me recueillir quatre ou cinq jours...»
C'était une courte lettre: de très simples remerciements, puis des conseils de modération. On sentait que le communisme de Philippe avait un peu effrayé le poète.
«Ne soyez d'aucun parti: il est impossible de conserver bonté ou vertu si l'on y trempe. Les partis blancs, bleus ou rouges, ne sont' que des passions honteuses et féroces qui exploitent en riant des sentiments généreux et nobles. Pour moi, j'attends des événements qui en vaillent la peine. Quant à user ses beaux jours pour la petite préférence à inventer ingénieusement entre Messieurs Molé, Thiers et Guizot, je laisse cela à ceux que cela amuse...»
Une courte invitation à venir le voir à Paris, rue de l'Université terminait la page.
Geneviève fut enthousiaste: Philippe moins...
—Des phrases, dit-il.
Elle sourit...
*
* *
Ce ne fut que trois mois plus tard qu'elle osa confier le bébé pour deux jours aux soins affolés de la petite bonne.
Elle retrouva avec plaisir la vie ardente de Paris: dès le matin de leur arrivée, aux Champs-Élysées, elle s'amusa des petites calèches rapides, des étrangers vêtus de longues polonaises de couleurs vives et des mantelets des femmes, couverts de rubans et de galons...
—Mais mon grand chapeau est ridicule, dit-elle à Philippe: on ne voit que ces minuscules capotes de crêpe... Nous allons rentrer à l'hôtel et je le transformerai avant de faire cette visite.
Philippe n'aimait pas qu'elle attachât de l'importance à des détails si mesquins. Il lui expliqua longuement que la mode est un préjugé, dicté aux classes riches par l'ingénieuse perversité des couturières et des modistes; il aurait voulu au contraire qu'elle prît plaisir à braver ces sentiments médiocres.
Elle l'écouta docilement et l'approuva, mais elle coupa les larges bords de son chapeau, fit un point pour changer légèrement la forme de la coiffe, et Philippe, étonné, dut reconnaître qu'elle avait réussi en un quart d'heure à se faire semblable aux belles personnes du Bois. Il ne lui savait pas tant d'adresse.
Madame de Lamartine recevait dans son atelier, devant la fameuse pendule d'albâtre qu'elle avait elle-même sculptée. Son maigre visage encadré de bandeaux épais avait une dignité mélancolique. Ses nièces Anglaises l'entouraient. Lamartine, debout près de la fenêtre, parlait à une femme élégante et vive, qui était Delphine de Girardin.
Tant d'admirateurs obscurs défilaient dans ce salon, que si Philippe avait été seul il est probable que sa visite se fut passée en banalités médiocres; mais la beauté de Geneviève intéressa Madame de Lamartine qui lui parla de la vie de province, d'Abbeville et de Mâcon, avec une sympathie un peu compassée.
Geneviève regardait Lamartine dont le profil doux, calme, et grave se détachait sur la fenêtre claire. Grand et svelte, il avait, dès qu'il faisait un geste, l'air de s'élancer.
On apporta du thé et des gâteaux, à la mode anglaise: Mme de Girardin et Lamartine se rapprochèrent. Le poète lui-même servit Geneviève: elle parla timidement des Méditations et de Jocelyn.
—J'ai renoncé à faire des vers, dit-il; tout homme qui en écrit à mon âge devrait être privé de ses droits politiques. On croit que j'ai passé trente ans de ma vie à aligner des rimes et à contempler les étoiles; je n'y ai pas employé trente mois.
Geneviève regardait avec un plaisir infini ces traits fins et mobiles, ces yeux alternativement bleus et gris comme un ciel d'automne. C'était le temps où il s'efforçait de donner à ses visiteurs une impression de maîtrise de soi et de bon sens vigoureux. Sa nature ondoyante et diverse était fatiguée de la gloire littéraire; aux aspirations bucoliques avaient succédé de très nobles ambitions politiques. Il s'ennuyait.
Philippe qui s'était rapproché, dit que ses amis attendaient du poète de grandes choses, surtout s'il acceptait le principe de réformes sociales.
«La politique, répondit-il assez dédaigneusement, est une science expérimentale où les principes ne se jugent bien qu'aux conséquences, mais ce pays-ci veut des idoles et non des hommes d'État. La foule s'attache à mes pas; je ne puis pas faire de miracles.»
Puis il interrogea Philippe sur l'état des esprits en Picardie.
—Oh! dit celui-ci, c'est le calme, le calme du sommeil et de la mort: un peuple de momies enveloppées des bandelettes de leurs préjugés provinciaux. Je m'efforce d'y répandre la Réforme de M. Flocon, mais sans grand succès.
—Laissez donc cela, dit le poète: l'avenir n'a pas d'abonnés.
Mais ce calme l'étonnait; partout ailleurs expliqua-t-il, régnait un malaise sourd, une attente anxieuse, un repos inquiet.
«... le silence qui se fait dans la salle avant la cinquième symphonie», dit Geneviève à mi-voix, et les yeux de Lamartine approuvèrent.
—Ma femme même commence a être ébranlée et animée de notre foi, ajouta-t-il.
Et la froide Anglaise sourit.
—Allons, encore des révolutions, intervint Madame de Girardin. Que c'est ennuyeux! Sommes-nous en 1830 ou en 1790? Mon mari essaie de prêcher des réformes, mais qu'espérer sous ce régime? On veut dessécher le marais et on ne fait voter que les grenouilles.
Mme de Lamartine complimenta Geneviève sur son chapeau, puis demanda à Delphine de Girardin d'où venait le sien, qui était aimable.
—D'où il vient? De Raphaël: c'est la coiffure de la Vierge aux Raisins, exactement copiée par mademoiselle Baudrand. Sur quoi elle disparut en beauté.
—Elle est charmante, dit quelqu'un.
—Oui, dit Lamartine, mais elle est trop gaie... la gaieté est amusante, mais c'est une jolie grimace. Qu'y a-t-il de gai dans le ciel et sur la terre?
Philippe depuis quelques instants faisait des signes à Geneviève: elle se leva. On les invita à revenir.
—Votre petite femme est délicieuse, dit Mme de Lamartine à Philippe.
Quand ils furent dans la rue, Geneviève, joyeuse et excitée, sourit aux choses, respira l'air frais et prit vivement le bras de Philippe. Elle s'aperçut alors qu'il était sombre.
—Quelle déception! dit-il.
—Vraiment? J'allais te dire au contraire...
—Petite femme! reprit-il. Délicieuse! Te prend-elle pour une de ces poupées mondaines? Quel jargon!
—Mais elle est étrangère, Philippe: les mots n'ont pas pour elle le même sens. Et, d'ailleurs, je ne puis rien voir d'offensant...
Mais Philippe voulut écraser Lamartine de commentaires violents et durs. Ce n'est pas toujours une bonne fortune que d'être le héros d'une jeunesse ardente. Elle aussi cherche des idoles, et des idoles respectueuses.
Le poète avait raison: un sentiment d'inquiétude et de tristesse angoissait alors la France. Des affaires bruyantes et scandaleuses irritaient chaque jour les nerfs trop sensibles du pays. Un aide de camp du Roi trichait au jeu; un ministre et un général étaient pris en flagrant délit de vol; un pair de France tuait sa femme; notre ambassadeur à Naples se suicidait. La bourgeoisie doctrinaire s'étonnait douloureusement d'avoir à donner au monde le spectacle de tant de hontes: le peuple regardait et faisait école de mépris.
De plus ce peuple avait faim: le pain était cher et rare. Abbeville même, métropole campagnarde, en manquait quelquefois et ses habitants pacifiques regrettaient d'avoir à murmurer. Le sous-préfet recevait de la Gendarmerie des rapports inquiétants et anormaux.
GENDARMERIE de la SOMME
LIEUTENANCE D'ABBEVILLEAbbeville, le 3 août 1847.
n° 179
MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,
«J'ai l'honneur de vous informer que dans la matinée du 26 de ce mois deux placards séditieux ont été découverts à Abbeville, affichés l'un sur le mur du Pont-au-Poiré, l'autre au jardin de l'Hôtel de Ville, rue des Carmes. Ces placards ont environ vingt centimètres de hauteur sur dix centimètres de largeur. Ils sont ainsi conçus:
«Français,
«L'on vous amuse en vous disant qu'il arrive des navires de blé et en faisant des quêtes pour les pauvres: ces quêtes ne sont que pour les mendiants qui n'en ont souvent pas besoin, mais l'ouvrier qui a de la peine à vivre, il n'aura rien, lui.
«Montrons que nous sommes braves et crions: à bas Louis-Philippe!
«Le Maire garde la moitié de l'argent pour lui.»
GENDARMERIE de la SOMME
LIEUTENANCE D'ABBEVILLEAbbeville, le 4 août 1847.
n° 180
«J'ai l'honneur de vous informer que hier, vers trois heures du matin, le sieur Châtelain sergent de ville, à découvert sur la muraille de façade de la maison de M. Pillet, chapelier, écrite en caractères noirs de douze centimètres de hauteur environ et avec un corps dur, l'inscription séditieuse suivante:
«Du pain à vingt sous, ou la République!»
«La République! Et sur les murs d'Abbeville! Quel scandale, dit le sous-préfet à son secrétaire. C'est ce maudit petit ingénieur qui leur monte la tête. Il me fera rater ma préfecture!
Et il adressa aux Ponts et Chaussées une note rageuse sur le mur de défense du Bourg d'Ault dont se plaignait le maire de cette localité. Il en fît parvenir une copie au Préfet en ajoutant qu'il serait désirable que Monsieur Viniès se consacrât exclusivement à ses travaux.
Il était d'ailleurs exact que les maires de l'arrondissement, agressivement conservateurs, accusaient de tous les méfaits des flots et des pluies les murs communistes et républicains de l'ingénieur Viniès.
*
* *
Philippe, seul dans son bureau, répondait tristement à des plaintes absurdes et véhémentes quand deux coups de poing formidables ébranlèrent sa porte.
—Entrez.
Une sorte de géant à visage tartare, au cou de taureau, aux épaules énormes, s'avança pesamment, un chapeau tyrolien sur l'oreille. Il était vêtu d'une redingote brune et d'un pantalon de nankin trop large. La face était d'une peau épaisse et profondément sillonnée que perçaient deux petits yeux intelligents et rusés.
—Vous êtes l'ingénieur Philippe Viniès? J'ai pour vous une lettre de recommandation de l'un des meilleurs républicains de France, le citoyen Malessart qui est, je crois, de vos amis.
Il avait la voix facile et cajoleuse du voyageur de commerce, condamné à plaire ou à jeûner.
Philippe parcourut la lettre; elle le priait de se mettre à la disposition du citoyen Caussidière qui lui expliquerait le but important de sa mission.
—Vous êtes Caussidière? dit-il avec une nuance de respect; une légende de patriotisme romanesque et révolutionnaire lui rendait soudain ce gros homme sympathique.
Carbonaro, franc-maçon, militant, agent retentissant et indiscret des sociétés les plus secrètes, il avait débuté dans la vie publique par une expédition au secours des Grecs qui s'était terminée à Marseille. Compromis dans les émeutes de Lyon, il avait fini par échouer à Paris où il était devenu l'homme à tout faire de Ledru-Rollin.
—Il est midi, venez déjeuner avec moi, dit Philippe.
Caussidière qui avait patiemment attendu toute la matinée l'heure du déjeuner pour se présenter, accepta sans façon; il étonna Geneviève qui regardait avec inquiétude sa masse énorme écraser les sièges et leur déjeuner d'oiseau disparaître en deux bouchées dans cet animal gigantesque. Mais elle lui pardonna beaucoup parce qu'il plut à son fils qui avait maintenant quelques mois et qui mettait dans la maison la joie de son sourire.
Caussidière loua le vin gris.
—Madame Viniès... votre vin est bon et vous pouvez m'en croire... Viniès, mon cher ami, votre vin est bon... maintenant, passons aux affaires. Vous savez, mon cher ami, l'importance du rôle que joue dans la politique d'opposition le journal La Réforme. Avant la fondation de La Réforme, la presse républicaine se composait du seul «National», journal bourgeois et presque doctrinaire que dirige ce Marrast. Vous connaissez Marrast, Viniès?... Plus dédaigneux, plus petit maître, plus main blanche que le comte Molé. Au contraire, le citoyen Flocon qui dirige La Réforme est vraiment l'homme de nos idées, de vos idées, mon cher ami... Oui, vraiment, votre vin est bon, madame Viniès... Or, je viens vous annoncer que le salut du parti républicain est menacé dans l'existence de La Réforme; nous avons deux mille abonnés, c'est tout à fait insuffisant pour vivre. M. Ledru-Rollin nous a beaucoup aidés, il nous aide encore. M. Schœlcher, le négrophile, est des nôtres, parce que nous parlons de ses nègres. M. Lemasson, banquier à Rouen, un pur démocrate celui-là, nous a puissamment soutenus. En un mot, tous les bons citoyens sans exception nous ont déjà fait leur offrande, il ne reste plus que les souscriptions de la Somme et du Nord à recueillir, Malessart m'a dit que vous étiez bien placé pour m'indiquer les souscripteurs possibles; je vous demanderai même de m'accompagner chez eux si vous ne craignez pas de vous compromettre... tel est le but de ma visite.
—Je vous aiderai de mon mieux, bien que je connaisse mal le pays, mais acceptez d'abord ma souscription personnelle, dit Philippe vivement.
—Non, non, protesta Caussidière très noble, je ne suis pas venu demander un sacrifice à un jeune ménage de fonctionnaire qui...
—Inscrivez-moi pour deux mille francs, dit Philippe, et plus un mot là-dessus.
Caussidière tira son carnet sans trop se défendre. Geneviève conseilla à Philippe de l'envoyer chez Bresson. Ce fut, en effet, un grand succès. L'industriel était plus vaniteux qu'avare et fût très flatté qu'un journaliste de Paris eut pensé à se déranger pour lui demander de l'argent.
—Tous les vrais citoyens sans exception m'ont déjà fait leur offrande, il ne reste plus absolument que votre souscription à recueillir. Certes, vous ne voudriez pas, faute d'une malheureuse somme, empêcher le bonheur du peuple, la grandeur du Pays, le triomphe de la vertu, en un mot le salut du brave et patriotique organe.
Bresson lui donna trois mille francs si facilement que Caussidière, surpris, se mit, en devoir de lui expliquer une grande affaire à laquelle il voulait l'intéresser. Il s'agissait d'éclairer de nuit les numéros des maisons de Paris.
C'était, selon lui, un progrès indispensable, on pouvait l'en croire, car il rentrait toujours des cabarets des Halles à 2 heures du matin et ne trouvait jamais sa porte qu'à grand'peine.
Mais cette fois, Bresson resta de glace; il voulait bien payer pour être un grand politique, non pour être un naïf.
Il accompagna Caussidière jusqu'à la porte de son usine et prit son bras.
—Et puis, mon cher, dit-il, un conseil, modérez donc un peu vos gens... la réforme électorale, les allusions à la République, fort bien... Mais qu'ils laissent le suffrage universel tranquille. Nous savons tous que c'est une utopie qui, sans les garanties nécessaires de lumière et d'indépendance, ne peut produire que l'anarchie.
Caussidière qui n'était pas une bête et qui avait les trois mille francs en poche ne s'ennuyait pas.
*
* *
Le même soir Philippe trouva sur son bureau cette lettre de Geneviève:
Monsieur,
L'intérêt que vous portez aux souffrances des malheureux m'encourage à vous exposer une situation difficile.
Mon mari, l'ingénieur Philippe Viniès, a établi savamment pour l'administration de notre ménage un budget que, depuis deux ans, je me suis efforcée de respecter.
Je me vois aujourd'hui si gravement endettée que j'en suis malade. Je n'ose plus entrer chez Mme Urbain, mon épicière, et je dois plus de cent francs à ma couturière qui est pauvre et m'aime trop pour se plaindre.
J'évite de mon mieux les dépenses inutiles et je fais moi-même la plupart de mes robes, mais mon mari, dans ses calculs, par ailleurs admirables, avait négligé la naissance d'un fils, la casse de la vaisselle et la hausse des prix: j'en ai souffert. L'appétit robuste de ses amis politiques et les besoins de la presse négrophile m'ont achevée.
Il me suffirait, direz-vous, de lui expliquer ces choses? Comme dit ma couturière: «On a sa fierté», et d'ailleurs je n'ai point la chance d'être née noire, ou polonaise. Mon mari remarquerait aussitôt que ce budget insuffisant ferait le bonheur de dix misérables.
Mais si ma raison doit admettre que cette objection est véritable, son cœur devrait lui dire qu'elle est futile...
M. Bresson, arrêta, au coin de la place Saint-Pierre, M. Bertrand d'Ouville qui se promenait avec le sous-préfet.
—Voulez-vous, lui dit-il, prendre part à notre banquet d'Amiens pour la réforme électorale? Nous aurons Ledru-Rollin et Odilon Barrot, nous serons plus de cinq cents... je compte sur vous.
—Ma foi, je suis assez curieux d'entendre Odilon Barrot, j'irai peut-être.
—M. d'Ouville, dit le sous-préfet désolé, vous êtes, je le sais, un homme d'ordre, vous n'allez pas aller vous compromettre dans ces manifestations scandaleuses.
—J'aime beaucoup le Roi, dit le vieillard, mais je considère que je fais mon devoir envers lui en réclamant la réforme; elle n'a rien de dangereux et je ne vois pas pourquoi deux cent mille hommes qui n'ont de remarquable que la forme de leur cravate, gouvernent ce Pays. Quand on a la chance d'avoir une opposition qui ne demande que des mesures raisonnables, il est généreux et prudent de céder. Les révolutions sont toujours l'œuvre des conservateurs extrêmes. D'ailleurs, les hommes sont paresseux; quand ils prennent la peine de crier contre un régime, ce n'est jamais sans raison et il est temps de le changer.
Le banquet était préparé dans une salle de bal; il y faisait un froid tragique; des bourgeois et des ouvriers endimanchés erraient le long des longues tables, cherchant leur nom.
Bertrand d'Ouville se trouva entre Bresson et un gros monsieur inconnu; celui-ci l'informa, d'ailleurs, assez vite qu'il avait fait fortune dans le commerce des balais. Il lui apprit aussi qu'Odilon Barrot n'était pas venu.
Le Comité avait proposé un toast à la réforme électorale.
Odilon Barrot avait demandé qu'on y ajoutât: «Comme moyen d'assurer la sincérité des institutions parlementaires»: le comité avait refusé.
—Mais pourquoi? dit l'archéologue, ahuri. Cela ne veut rien dire.
—Justement, dit l'autre.
À sa gauche, Bresson disait de sa voix grasse et autoritaire des vérités prudhommesques et sentimentales.
À la table d'honneur, on lui montra Ledru-Rollin, un gros homme à belles dents qui caressait son collier de barbe de ses mains blanches, Flocon, et Étienne Arago. M. Duclos, directeur de l'Impartial de Picardie, porta le toast. L'auditoire resta assez froid, il n'était pas venu pour entendre les célébrités locales, mais Ledru-Rollin se leva, gras et tondu.
«À l'amélioration des classes laborieuses... aux travailleurs» cria-t-il. Puis, il parla de la nécessité d'organiser le suffrage universel pour que les intérêts des ouvriers fussent défendus à l'assemblée. «Qui donc à la Chambre, s'écria-t-il, connaît les intérêts du peuple?»
—Vous, vous, répondirent cinq cents voix.
—Je vous remercie de cet honneur et de ce souvenir. Sans doute, j'ai défendu le peuple, sans doute je l'ai fait, le cœur saignant de toutes ses misères, les larmes aux yeux; mais si mon cœur me rapproche de lui, plusieurs générations déjà m'en séparent: l'éducation, les habitudes, le bien-être. Est-ce que jamais j'ai éprouvé, moi, les quarante-huit heures de la faim? Est-ce que j'ai jamais vu autour de moi l'hiver, entre quatre murs humides, les miens sans pain, sans espoir d'en avoir, sans feu, sans argent pour payer le loyer, prêts à être jetés à la porte pour de là tomber dans la prison?... Ah! que ceux qui ont passé par tous ces vertiges en parleraient autrement que moi!... Ô peuple, à qui je voudrais sacrifier tout ce que j'ai de dévouement et de force, espère et crois. Entre cette époque où ta foi antique s'est éteinte et où la lumière nouvelle ne t'est point encore donnée, chaque soir, dans ta demeure désolée, répète religieusement l'immortel symbole: Liberté, égalité, fraternité! Oui, salut! ô grand et immortel symbole! Salut! ton avènement est proche! Peuple! puissent ces applaudissements adressés à ton indigne interprète arriver jusqu'à toi, et être à la fois une consolation et une espérance!
Cette fois, on applaudit vigoureusement; la musique de la phrase exigeait l'accord parfait des acclamations.
Puis, M. Flocon se leva.
—Dans un temps et dans un pays où chacun parle concessions, je viens vous parler principes... Les hommes de la Convention, les Montagnards sont morts, emportés par la tempête, mais ils ont légué au peuple leur testament. Lisons-le, mes amis, reprenons ensemble, un moment, cette immortelle déclaration des Droits de l'homme dans laquelle ils ont gravé en traits impérissables, les titres de la loi du genre humain.»
Il lut la Déclaration, interrompu par des applaudissements mystiques et véhéments; puis, méprisant, et cinglant, il opposa à cette charte sublime le parlementarisme anglais à l'eau de rose offert par les libéraux à la France.
—Est-ce là, mes amis, ce que vous voulez? Non, n'est-ce pas? Eh bien donc, à vos tentes, Israël! Chacun sous son drapeau. Chacun pour sa foi! La démocratie avec ses vingt-cinq millions de prolétaires qu'elle veut affranchir, qu'elle salue, du nom de citoyens, frères égaux et libres! L'opposition bâtarde avec ses monopoles et son aristocratie du capital. Ils parlent de réforme! Ils parlent de vote au chef-lieu, de cent à cent francs! Nous voulons, nous, les Droits de l'homme et du citoyen.
La moitié ouvrière de la salle poussa des hurlements frénétiques et acclama Flocon... Les organisateurs bourgeois, autour de lui, applaudissaient également, mais du bout des doigts.
—Eh bien! Bresson, mon ami, dit Bertrand d'Ouville, il me semble que vous devenez socialiste, Dieu me pardonne. L'aristocratie du capital? Mais c'est vous, si je ne me trompe... et vous applaudissez à votre condamnation: j'admire votre grandeur d'âme.
L'industriel était très jaune et son sourire contraint.
—Vous comprenez bien, mon cher, dit-il à mi-voix, que tout cela, ce sont des mots et rien de plus... Personne ne songe réellement à renverser le système parlementaire, mais il est nécessaire de se servir de ces gens-là pour obtenir une réforme limitée. En réalité, il n'y a pas cinq mille républicains en France, Ledru-Rollin lui-même me l'a avoué.
—Bresson, dit le vieillard sérieusement, le Gouvernement et la société humaine reposent sur des bases si faibles qu'un enfant pourrait les renverser. Douze hommes résolus peuvent toujours faire une révolution; il suffit d'occuper quelques immeubles consacrés et de faire graver quelques cachets. La masse des citoyens paisibles obéit à tout ordre qui vient de l'Hôtel-de-Ville ou qui porte le timbre du Préfet de police.
—Il n'y a aucun danger, dit l'industriel, tout cela est prévu de longue main; le sous-préfet le tient de Guizot lui-même. En cas d'émeute sérieuse à Paris, il y a un plan d'occupation. La troupe et la Garde Nationale prennent la ville comme dans un étau...
Le 24 février 1848, Geneviève s'éveilla joyeuse. Un beau soleil d'hiver émergeait au ras des toits. L'air quand elle ouvrit la fenêtre la caressa d'une bouffée tendre et vivace. Les arbres, couverts de gelée blanche, brillaient gaiement. Son fils, lui aussi, souriait et chantait des choses confuses. Elle le fit manger en lui disant mille folies et s'habilla pour sortir.
Les petites crêtes de terre glacée qui craquaient sous le pied la ravirent. Elle se surprit esquissant une glissade, sur un petit coin de glace bleue.
—Quelle folle je fais, pensa-t-elle: si la mère Bresson me voit, elle m'attribuera trois amants... Mais qu'il fait beau!
En arrivant rue Saint-Gilles elle remarqua des groupes assez nombreux autour des boutiques. Elle entra pour acheter des oranges chez Mme Urbain son épicière.
—Eh bien! madame, dit la commerçante, il paraît qu'il y a du nouveau.
—Je ne sais pas, dit Geneviève, quoi?
—Eh! mais à Paris, madame... Paraît qu'on dit à Amiens que le Gouvernement devra s'en aller.
—Mais pourquoi?
—Moi, n'est-ce pas, madame, ce que j'en dis, fit l'épicière, tout de suite inquiète, je l'ai entendu de la cuisinière de M. de Vence qui le tenait de son maître. Mais pour moi, c'est tout des histoires.
Geneviève se décida à aller jusqu'au bureau pour apprendre ce que savait Philippe. Devant les cafés, les rassemblements grossissaient. Des mots flottaient dans l'air: «Régence... Thiers... Garde Nationale... Guizot.»
Les gens buvaient ferme pour s'occuper.
Philippe avait lu dans le journal local les émeutes au sujet du Banquet réformiste, mais il les croyait réprimées.
—Je voudrais que cette démission du ministère fût vraie: mais je n'y crois pas.
Il quitta cependant ses scribes pour aller aux nouvelles avec elle. Ils rencontrèrent Bresson: il avait des renseignements officiels et en était si fier qu'il oublia la querelle de sa femme avec les Viniès et s'arrêta.
—Le courrier n'est pas arrivé, dit-il, et les journaux manquent, mais le sous-préfet a eu des nouvelles par Amiens. Tout va bien: la Réforme électorale est accordée. La Reine a demandé le départ de Guizot: Thiers et Molé sont ministres... C'est parfait, parfait...
Il se frotta les mains.
—Mais non, dit Philippe, c'est absurde: si nous sommes vainqueurs, nous voulons la république...
—Mon cher, dit Bresson très grave, il faut être raisonnable. Prenons ce que nous obtenons: si le peuple s'obstine, il sera vaincu... Tout est prévu: le roi dispose de forces considérables. La troupe et la Garde Nationale prennent Paris comme dans un étau... Ici même on prépare un train pour emmener la garnison.
Geneviève battait la semelle à quelques pas de distance. Philippe la rejoignit.
—Celui-là me rendrait violente, dit-elle: c'est un mauvais homme.
Quand ils revinrent à la place du Bourdois, le Maire, sur les marches de la justice de paix, haranguait un groupe.
«Soyons calmes et résolus... Quelles que soient les institutions que la France décide de se donner, nous maintiendrons l'ordre à Abbeville...»
La foule, composée de fermiers et de commerçants approuvait cette vigoureuse fermeté dans l'indifférence.
—J'ai bien envie de dire quelques mots, dit Philippe.
—Rentrons, dit Geneviève, et prenant son bras d'un geste caressant elle l'entraîna.
Il était silencieux et sombre.
—Quel beau temps, dit-elle; si tu t'accordes un après-midi de liberté en l'honneur de Paris, nous irons glisser sur l'étang.
Il ne répondit pas. Après le déjeuner Bertrand d'Ouville vint les voir: il était inquiet. On disait maintenant que le Roi était à Fontainebleau et que la garde nationale révoltée se battait contre la troupe de ligne. Une dame qui avait pu arriver de Paris avec un train militaire prétendait que le prince de Joinville était régent. Elle avait traversé quatorze barricades pour parvenir à l'embarcadère. En arrivant à Enghien elle avait vu de grandes flammes sur Paris.
—Geneviève, dit brusquement Philippe, il faut que j'aille à Paris ce soir.
—Toi, Philippe? et pourquoi?
—Mais ne vois-tu pas ce qui se passe? dit-il. La révolution est triomphante et on essaie de l'escamoter. C'est le devoir de ceux qui voient clair de s'y opposer. Il faut que chacun soit à son poste: le mien est près de mes amis.
—Philippe, tu ne voudrais pas me laisser seule... S'il t'arrive quelque chose, je suis seule au monde...
—Geneviève, je t'en prie, dit-il avec tristesse... Vois plus grand, plus large que cela... L'avenir de la France, du monde peut-être, dépend de quelques jours de lutte et tu ne penses qu'à nous.
—L'avenir du monde, dit Bertrand d'Ouville... Vous voilà parti pour la guerre de Cent Ans.
Mais Geneviève ne lutta plus.
*
* *
Quand elle revint de la gare, le soleil déjà très bas allongeait sur le sol brillant de froid les ombres pointues des maisons. La rivière coulait rapide entre les masures bâties à pic sur ses bords. Le vent devenait aigre et vif. Devant Saint-Vulfran sa pensée confuse s'accrocha aux portes de bois où des figures aux visages grotesques prenaient sur les colonnettes des poses pénibles et touchantes.
—Vierge aux humains la porte d'amour êtes.. Vierge aux humains... Ô ma belle journée, pensa-t-elle.
Les corbeaux s'échappaient avec de grands mouvements d'ailes des hautes tours carrées aux fenêtres géminées et leurs croassements bruyants couvraient la musique éternelle des cloches.
—Ils sentent le sang, dit à Geneviève une vieille qui sortait de l'église.
Pour moi, plus je repasse
dans mon esprit des faits anciens
et modernes, plus un pouvoir
inconnu me semble se jouer des
mortels.
TACITE.
Philippe n'arriva à Paris que le 25 à neuf heures du matin; la ligne était coupée en deux endroits et il avait fallu transborder les voyageurs. Les employés du chemin de fer lui dirent que la République était faite: ils en paraissaient surpris et heureux. Philippe décida d'aller à la «Réforme», rue Jean-Jacques-Rousseau.
Malgré l'heure matinale, les boulevards avaient un air de fête. Le temps était couvert et gris: devant les magasins fermés des familles se promenaient admirant les pavés déchaussés et les pierres d'angle éraflées par la fusillade de la nuit. Il y avait des barricades un peu partout et les véhicules ne circulaient pas. Cela mettait dans les rues un silence sur lequel les cris et les chants se détachaient avec une netteté qui étonnait.
Des bandes de gamins passaient avec des drapeaux tricolores, chantant la Marseillaise et «Mourir pour la Patrie». Philippe vit aussi un drapeau rouge, suivi d'ouvriers des faubourgs.
La foule était calme et satisfaite: elle avait si souvent crié «À bas Louis-Philippe» qu'elle attendait vaguement de sa chute un bonheur idyllique et confus. La plupart de ces passants étaient des spectateurs, prêts à accepter les événements quels qu'ils fussent sans jamais revendiquer leur droit égal de les faire.
Devant le magasin du confiseur Boissier, une troupe se formait en colonne par quatre. En tête, un tambour de la Garde Nationale battait la charge. Philippe prit le pas de ces hommes: ils défilèrent militairement le long de la rue de la Paix. Sur la place Vendôme quelqu'un commanda: «Halte». Les tambours battirent aux champs, quelques voix crièrent: «Vive l'Empereur!» Les hommes agitèrent leurs casquettes.
«Ah! ça, pensa Philippe, avons-nous fait une révolution bonapartiste?... Ils sont fous, dit-il à un vieillard en redingote qui regardait comme lui ce spectacle étrange.»
L'autre fit un geste évasif qui voulait dire: «Messieurs, ami de tout le monde». C'était un bourgeois, très effrayé d'avoir renversé M. Guizot.
Philippe, par la rue des Petits-Champs gagna les bureaux de la Réforme. On y était affairé et heureux. Le patron, Flocon, faisait partie du Gouvernement Provisoire: on apprit à l'ingénieur que Caussidière était Préfet de police et qu'il trouverait Lucien à la Préfecture. Il y courut à travers une foule qui devenait serrée et bruyante.
Tous les groupes marchaient maintenant dans le même sens, d'un pas pressé, car Philippe était arrivé dans la zone d'attraction de l'Hôtel de Ville, centre mystique des émeutes parisiennes.
Devant la préfecture des hommes à mine assez sauvage montaient la garde: leurs blouses, leurs képis rouges à coiffe retombant sur l'oreille, leurs barbes à faire peur aux petits enfants, leurs grands sabres formaient un ensemble décoratif de la meilleure tradition révolutionnaire.
Comme Philippe arrivait, Caussidière sortait; une casquette, une redingote noire, un sabre attaché autour du corps par une ficelle rouge et deux énormes pistolets lui donnaient un aspect prudhommesque et militaire. Il était rouge, radieux, bruyant. Philippe l'aborda bravement.
—Ah! mon ami, dit-il, Salut! Fraternité! Quelles journées. Venez avec moi. Nous avons besoin ici de bons bougres... Je vais à l'Hôtel de Ville, il faut que je voie le Gouvernement Provisoire. Si la Préfecture ne se montre pas, nous sommes foutus! »
Philippe, empruntant un revolver à un des montagnards de l'escorte, suivit le préfet: il fallait fendre une foule armée et turbulente qui s'ouvrait de mauvais gré. Quelqu'un lui tapa sur l'épaule: c'était Lucien Malessart.
—Quelle chance, dit Philippe, radieux, vive la République, mon bon vieux.
—Oui, dit l'autre, que fiches-tu ici?
—Je suis venu en apprenant les nouvelles: Caussidière m'a enrôlé... Il est préfet de police.
—C'est lui qui le dit, fit Lucien, nous allons voir ce qu'en pensera le Gouvernement provisoire?
—Qui est le Gouvernement provisoire?
—C'est fort amusant, mon cher, il y en a deux. Nous à la Réforme, nous avions nommé Louis Blanc, Flocon, Marrast, Albert...
—Qui est-ce Albert?
—Provincial! Tu ne connais pas Albert? Albert, ouvrier: la grande pensée du règne... C'est un mécanicien, plein de bon sens ma foi: il m'aidait à maintenir l'ordre aux Saisons... Bref, quand notre gouvernement est arrivé à l'Hôtel de Ville pour prendre le pouvoir il a trouvé là dans le cabinet du préfet de la Seine, messieurs Lamartine, Ledru-Rollin, Garnier Pagès et compagnie qui s'étaient nommés par ailleurs. Cela s'est gâté: Louis Blanc et Arago se sont invectivés... Nous allons, je pense, retrouver les morceaux épars de ces héros... Avançons plus vite, mon cher, Caussidière a vingt mètres d'avance et nous n'entrerons à l'Hôtel de Ville que derrière lui.»
Le ton de Lucien, en un pareil jour, déplut à Philippe, mais la place de l'Hôtel-de-Ville, couverte de canons et de groupes armés avait un aspect de bivouac révolutionnaire qui évoqua pour lui les grands ancêtres. Un général en tenue donnait des ordres.
«Que diable est celui-ci, dit Lucien... Eh! mais, c'est Chateaurenaud, l'acteur, découvrit-il en s'approchant... Chateaurenaud! Quelle comédie jouez-vous?
—Mon cher, c'est en effet la chose la plus comique du monde... Hier soir il y a eu du bruit sur le boulevard pendant l'entr'acte: je suis sorti dans le costume de mon rôle... La foule a crié: «Un général!» et m'a entraîné en m'acclamant. J'ai passé la nuit dans un café et, ce matin, comme on a l'air de m'écouter, je fais de l'ordre.
Mais derrière Caussidière, les deux jeunes gens gravissaient le perron de l'Hôtel de Ville: des élèves de l'École Polytechnique, fusil en main, en gardaient l'entrée.
—Quel est votre chef? demanda l'un deux à Philippe.
—Le préfet de police.
—Quelle allure! fit l'autre.
Une foule épaisse encombrait les escaliers et les couloirs; dans les embrasures des fenêtres, des typographes, en manche de chemise composaient des décrets. Les mots «Préfet de Police» ouvrirent un passage. Deux grenadiers de la Garde Nationale vérifièrent l'identité de Caussidière. Puis, l'un d'eux ouvrit une porte de cuir et une violente poussée projeta Philippe dans une salle qui, par contraste, lui sembla étonnamment vide.
Autour d'une grande table couverte d'un tapis vert, le Gouvernement provisoire siégeait; une litière de papiers déchirés couvrait le sol jusqu'à près d'un mètre de hauteur; l'air était lourd de fumée et d'odeurs: dans un coin, deux polytechniciens parlaient à voix basse comme dans une chambre de malade.
Philippe ne vit d'abord que Lamartine, les vêtements déchirés, le cou presque nu, les cheveux luisant de sueur; il éclairait vraiment cette assemblée confuse de la beauté de son visage grave et fin. Il critiquait un projet de décret sur la formation d'une Garde Nationale Mobile; suivant une vieille formule, on s'occupait déjà de transformer les mécontents en soldats.
L'entrée de Caussidière interrompit la discussion. Albert vint à lui, Flocon lui fit fête, Lamartine et Marrast qui ne l'aimaient pas et qui le craignaient se levèrent et l'emmenèrent vers la fenêtre pour essayer de le convaincre d'abandonner la Préfecture. Le gros Tartare regardait ces aristocrates de ses petits yeux malins, bien décidé à ne pas se laisser faire.
Sur la place, une fusillade crépita, puis s'apaisa.
—Allez voir ce que c'est, demanda Lamartine à Garnier Pagès et, comme il se retournait, il aperçut Philippe. Il avait oublié son nom mais se souvint d'avoir vu ce visage chez lui; ses yeux s'éclairèrent, il griffonna quelques mots sur une feuille de papier et vint vers l'ingénieur.
—Vous savez où je demeure, monsieur, lui dit-il. Voulez-vous me rendre un grand service? Donnez ceci à ma femme, dites-lui que tout va bien et rapportez-moi ce qu'elle vous donnera... je n'ai rien mangé depuis ce matin, ajouta-t-il en manière d'excuse.
Philippe sortit rapidement. Devant la porte, Garnier Pagès haranguait une députation: «Travailleurs... disait-il... nous sommes tous des travailleurs; mon fils, mon propre fils, est garçon épicier. Mon fils est travailleur en épicerie, moi je suis travailleur en...»
Philippe, que le remous entraînait vers la porte n'entendit pas en quoi Garnier Pagès était travailleur.
Quand il fut sur la place, il jeta les yeux sur le papier remis par Lamartine; il portait simplement: À Madame de Lamartine, 82, rue de l'Université: Envoie-moi du chocolat.
*
* *
Les rues étaient si encombrées, les incidents si nombreux qu'il mit fort longtemps à remplir sa mission.
Comme il revenait le long des quais, il vit avec surprise une horloge qui marquait trois heures; lui non plus, il n'avait pas mangé depuis le matin. Il s'arrêta dans une boulangerie et, tout en dévorant un morceau de pain, regarda le fleuve d'hommes et de femmes qui coulait toujours vers l'Hôtel de Ville.
Ce n'était plus la même foule que le matin, les visages étaient plus sombres, les chants plus sourds.
Une étonnante floraison de rouge le surprit; les brassards, les cravates, les cocardes, tout était rouge. Dans le lointain, à travers les arbres ouatés de brume du terre-plein du Pont Neuf, on devinait un immense drapeau rouge flottant aux bras de Henri IV.
Philippe se mêla à une colonne et arriva sur la place: un immense cri la remplissait: «le drapeau rouge, le drapeau rouge».
Aux fenêtres de l'Hôtel de Ville apparaissaient des silhouettes que la distance l'empêcha de reconnaître. Quelqu'un parla, dans le vent, dans le bruit, interrompu par des cris plus forts: «Le drapeau rouge.»
Puis, derrière Philippe, un murmure courut et, tournant la tête, il vit, à côté de lui, deux hommes, aux yeux hagards, portant sur une civière un cadavre de femme: les cheveux dénoués couvraient à demi le visage tuméfié et, dans cette foule rouge, le sang coagulé mettait un rouge plus sombre.
Un immense silence effleura la place.
Penché hors du balcon de l'Hôtel-de-Ville, planant sur cette masse mouvante, Lamartine parlait.
Philippe n'entendit pas ses phrases, mais vit les drapeaux rouges s'abaisser lentement dans une longue vague qui s'en alla mourir sur les quais noirs.
Un peu plus tard, comme tout redevenait calme, un polytechnicien consentit à se charger de transmettre son paquet; on refusait de le laisser pénétrer lui-même dans l'Hôtel de Ville. Il était si fatigué qu'il renonça à retourner à la Préfecture avant le lendemain.
La marée descendait maintenant vers les faubourgs; le long de la Seine, dans la lumière légère et cendrée, parmi le décor lourd d'histoire, il gagna les Champs-Élysées.
Là, c'était le silence et la solitude; on devinait très loin, vers la ville, une rumeur paisible et musicale; parfois dans un bosquet retentissait l'«Aux armes, citoyens» d'une Marseillaise égarée: le soleil couchant de février frangeait d'or très pâle l'Arc de Triomphe.
Le soir, comme il avait trouvé une chambre dans un hôtel misérable de la rue Coquillière et qu'il s'était jeté tout habillé sur un lit fermé, il vit un ciel rouge et une place bordée d'arbres dans lesquels des oiseaux chantaient. Des hommes à visage farouche poussaient devant eux à coups de crosse des femmes épouvantées. Ils les lièrent aux arbres et Philippe vit alors qu'elles avaient la poitrine nue. Elles étaient jeunes et belles. La dernière était Geneviève: ses cheveux pâles retombaient sur ses seins petits et parfaits.
Philippe terrifié vit les hommes de l'escorte pointer soigneusement un canon sur la première des femmes: elle disparut dans un nuage rouge. Philippe voulut courir pour délier Geneviève, mais Lucien qui était à côté de lui le retint par le bras. Le canon tonna de nouveau.—Ce canon ne s'arrêtera donc jamais, dit-il.—Mais non, répondit Lucien en ricanant, c'est un canon automatique.
Alors Philippe se réveilla, couvert de sueur, sur un lit bouleversé: le vent faisait claquer bruyamment les volets mal accrochés.
Huit jours plus tard, cette République avait trop d'amis. Les légitimistes l'aimaient parce qu'elle avait chassé le roi bourgeois; les bourgeois, parce qu'elle semblait garantir la propriété; les ouvriers parce qu'ils en attendaient le bonheur.
L'Église, se rappelant que son royaume n'est pas de ce monde, bénissait les arbres de la Liberté. L'Armée se déclarait prête à assurer l'ordre à l'intérieur et la défense nationale.
Le 20 février, il y avait en France cinq mille républicains; le Ier mars il y en avait vingt-cinq millions.
Ainsi dépourvu d'opposition, le Gouvernement était désuni; c'est sur des haines communes que se fondent les sociétés humaines. Ces gouvernants auxquels se ralliaient tous les partis eurent vite fait de devenir eux-mêmes des partisans.
Dupont de l'Eure, Garnier-Pagès, Marrast, voulaient des élections rapides et honnêtes qu'ils espéraient conservatrices; Ledru-Rollin et ses amis faisaient de la politique et espéraient bien aussi faire les élections; Blanqui et les Clubs vaguement soutenus par Louis Blanc, désiraient une dictature forte et populaire et préparaient la guerre civile; Lamartine, une fois de plus, siégeait au plafond et faisait voter des réformes nobles et vagues.
Cependant, Caussidière, à la Préfecture de Police, s'installait solidement; les aristocrates du Gouvernement Provisoire ne l'aimaient pas et il le savait; mais avec un bataillon de braves montagnards, il prétendait bien s'imposer à eux, et quelque jour les remplacer.
Il installa Lucien dans le bureau du Secrétaire général et lui dit «Vous connaissez tous les vrais patriotes, faites leur savoir que le rendez-vous pour eux est la Préfecture; il nous faut ici tous ceux qui savent manier un fusil. Alors, nous tiendrons la queue de la poêle.
Ledru Rollin, Flocon, Albert et moi, nous nous entendons; le principal est de culbuter les gens du National; cela fait, nous républicaniserons ce pays, de gré ou de force.»
Lucien l'encouragea vivement.
Philippe, lui aussi, avait été enrôlé et travaillait ardemment à mettre de l'ordre dans les archives de la Police. Il n'aimait guère les allures de Caussidière; on mangeait trop bien à la Préfecture, l'on y buvait trop sec les vins de l'ex-préfet et l'on y voyait trop de filles dans le Corps de garde des Montagnards.
Viniès qui était, par tempérament, un ascète, souffrait de ces choses et se reprochait sa pruderie. «Pauvres diables, pensait-il, ils se réjouissent à leur manière d'être libres.» Mais il eut préféré les kermesses idylliques de Cabet.
Il avait été très étonné de trouver, parmi les dossiers politiques, des fiches sur lui-même, fort bien faites, assez élogieuses pour son caractère et tout à fait méprisantes pour son intelligence.
On y dénonçait, avec une exactitude surprenante, la faible propagande républicaine qu'il avait essayé de faire à Abbeville. Caussidière, à qui il en parla, lui demanda son propre dossier. Philippe le trouva: le nouveau Préfet y était décrit comme un industriel suspect, un charlatan éhonté et un conspirateur maladroit; il entra dans une fureur terrible.
—«Quel est le traître? répétait-il... quel est le traître?»
Un vieux petit employé de la Préfecture était resté aux archives; il le fît venir et l'effraya tellement que l'autre lui livra le secret de la cachette où l'ex-préfet Delessert avait, avant de partir, fait mettre en sûreté les documents secrets.
On y trouva quelques liasses de lettres que Philippe fut chargé de dépouiller.
Comme il ouvrait le troisième paquet, l'écriture le frappa, elle lui était familière.
«Monsieur le Préfet, lut-il, j'ai l'honneur de solliciter mon admission dans l'Administration que vous dirigez.
Il alla à la signature et trouva celle de Lucien. Il demeura stupide.
Indigné, mais aussi passionnément intéressé, il dévora tout le paquet de ces lettres cyniques, bien écrites, souvent amusantes, toujours méthodiques et exactes.
Toute la vie des sociétés secrètes, depuis quatre ans, était là dedans, racontée par un esprit froid et moqueur.
—«Et que vais-je faire? Aller confondre Lucien? Il s'échappera et je n'ai pas le droit de l'y aider. Prévenir Caussidière? Mais il le fera fusiller...»
Il passa la nuit dans son bureau à relire les lettres et à chercher son devoir, répétant sans fin quatre ou cinq phrases autour desquelles sa raison tournait en vain.
Quand il pensait aux grands conventionnels et aux héros de la République il se sentait capable d'aller lui-même tuer son ami.
Puis il revoyait cette physionomie assez douce et cet air vif qu'il avait aimé, et tout son courage tombait.
Le matin était venu; il dépouilla machinalement les autres liasses. Puis, brusquement, Caussidière entra et lui demanda où il en était. Toutes les lettres étaient sur la table; Philippe, pris au dépourvu, dut les montrer.
Caussidière les lut avec attention et, contrairement à ce qu'attendait Philippe, ne cria pas; au contraire, il se frotta les mains et lui frappa sur l'épaule avec bonhomie.
«Allons, lui dit-il, allons, voilà qui est drôle; mais où diable avez-vous passé la nuit? Vous avez une mine de déterré.»
—«Il était mon ami, dit Philippe.
—Et quel ami! dit Caussidière. Il vous traitait bien.
—Qu'allez-vous faire de lui, demanda Philippe anxieux?
L'autre le regarda avec méfiance.
—Ça, dit-il, je n'en sais rien, et cela ne concerne pas que moi. En tout cas, je vous interdis de lui parler de ceci.
Puis, passant dans le bureau de Lucien, il lui dit nonchalamment; «Venez donc ce soir au Luxembourg, nous avons à régler plusieurs questions pour lesquelles vous pourrez m'être utile. N'oubliez pas.
Le soir, à huit heures, une douzaine de patriotes étaient réunis dans le bureau d'Albert. Caussidière, solennel et goguenard, les pria de nommer un Président. Il fut naturellement élu. Puis, violemment, rageusement, il accusa Lucien d'être un traître, mais sans citer aucune preuve.
Ce dernier, qui croyait ses lettres bien cachées ou détruites, se leva sans aucun embarras et se défendit ingénieusement. Il parlait bien et autour de lui on commençait à l'approuver.
Caussidière le regardait avec une ironie satisfaite.
Quand il eut fini:
—Citoyens, dit Caussidière, puisque Malessart est si sûr de son fait, qu'il ait la bonté de nous expliquer ceci.
Et il tira de sa poche la liasse des lettres.
Lucien accablé se tut.
Des cris de colère, des menaces de mort, lui apprirent ce qui l'attendait.
Caussidière ne voulait pas d'un procès qui aurait fait connaître les renseignements exacts et sévères que donnaient les lettres sur son existence ingénieuse et libre; il se déclara partisan de le fusiller sur l'heure dans le jardin.
—C'est impossible, dit Albert nettement, nous venons de supprimer la peine de mort, ce serait un meurtre qui soulèverait une affaire terrible.
—Alors qu'il se tue lui-même, dit Caussidière, j'ai ici un revolver, il ne peut vivre, il en sait trop.
Plusieurs voix approuvèrent. La solution leur paraissait honorable' et prudente.
—C'est inutile, dit soudain Lucien qui écoutait, je ne me tuerai pas.
—Alors il faut le laisser, dit Albert, c'est un lâche.
—Impossible, dit Caussidière, je le tuerai plutôt de mes mains.
Après une longue discussion, on décida enfin de le mettre en lieu sûr, en prison préventive, et d'attendre des temps plus calmes pour commencer l'instruction.
Certain maintenant de n'être pas tué, il avait retrouvé son calme, écoutait d'un air railleur et s'efforçait de se persuader à lui-même qu'il était non un traître, mais un soldat malheureux d'une autre cause.
Il était trop intelligent pour y parvenir toujours.
Bertrand d'Ouville, que la petite bonne avait fait entrer sans l'annoncer, trouva Geneviève seule, les yeux pleins de larmes. Elle sursauta au bruit de ses pas.
—Vous! que je suis contente... J'ai été surprise; je vis si seule que tout me bouleverse.
—Que devient Philippe, dit-il? Avez-vous de ses nouvelles?
—Ce matin même: il ne parle pas encore de son retour. Il est avec ce Caussidière à la Préfecture de Police: il paraît assez heureux. Il aime ce mouvement autour de lui... Mais vous allez m'expliquer ce qui se passe à Paris; je ne comprends rien à vos histoires d'hommes.
Et sa jolie tête en avant, le menton appuyé sur la main, elle attendit.
—Expliquer? C'est fort difficile. Il y a trois groupes, ou à peu près. Au centre Lamartine et ses amis, gens honnêtes qui veulent obéir au suffrage universel quoiqu'il décide; à droite, les légitimistes, les doctrinaires, les bourgeois, acceptent la République parce qu'ils espèrent la confisquer; à gauche, Blanqui et les extrémistes veulent empêcher les élections parce qu'ils sentent la province contre eux... Et voilà: c'est assez confus.
—Et qu'est-ce qu'il va se passer?
Bertrand d'Ouville sourit.
—Que vous restez bien femme avec toute votre sagesse... Ceci est un livre divin et l'on ne peut courir au dénouement.
—On peut essayer de le deviner... Que croyez-vous?
—Que sais-je? L'histoire ne connaît pas de lois. Lorsque les Dieux arrangent sur l'échiquier du monde deux coups qui nous paraissent semblables, ils se divertissent presque toujours à les jouer de façon différente.
Nous méditons, nous prévoyons, nous préparons et dans quelque village obscur grandit l'enfant inconnu qui détruira notre maison... Une légère brume du sud, un amiral moins sot, et Bonaparte était maître du monde. Le sort de la Révolution a été suspendu à ces canons du 13 Vendémiaire qui furent enlevés cinq minutes avant le moment fatal, et à Valmy qui aurait dû être une bataille perdue.
Les faits galopent plus vite que la pensée sur les routes du temps; nous les trouvons à chaque étape, narquois et déjà reposés, et cette expérience tant vantée n'est plus que la carte inutile de régions déjà traversées...
Geneviève avait pris une rose et l'effeuillait doucement; la grâce précise de son profil se découpait dans l'ombre du soir.
—Non, continua le vieillard, je ne crois pas aux prophètes... Trop de petites causes agissent sur l'histoire des hommes pour que nous puissions en raisonner. Tout ce que l'on peut affirmer c'est que cette histoire, comme le reste de la nature, ne fait point de sauts. Elle s'en va d'un mouvement continu vers le progrès, dirait votre mari; vers l'apogée, puis le déclin de la race selon moi. Et tout ce qui semble interrompre cette continuité n'est pas viable; mais ce provisoire peut durer deux mois, deux ans ou vingt ans.
—Oui, dit Geneviève rêveuse, mais je voudrais savoir ce qui va se passer demain.
—Voyons, que pourrais-je vous dire? Si les élections sont vraiment libérales, nous pouvons avoir une République tranquille; si elles sont trop conservatrices, nous aurons sans doute une émeute qui dispersera l'assemblée. Alors ce sera la guerre civile. M. de Vence croit à Henri V, d'autres à Louis-Bonaparte, mais ce dernier s'est discrédité par son équipée de Strasbourg et personne ne le prend au sérieux.
—Moi, je mets ma confiance en Lamartine, dit Geneviève, j'en ai conservé un souvenir très beau; c'est un homme si noble.
—Heu... ou-i, dit Bertrand d'Ouville, vous savez qu'il y a deux types de politiciens redoutables: les coquins et les saints. Moi je me méfie des révolutions des anges: nous en avons déjà eu une. Elle a produit l'Enfer: c'est un fâcheux précédent, comme dit votre amie Delphine.
«Lamartine est intelligent? À coup sûr. Est-ce un mal? Est-ce un bien? J'en fais juge un Barbès et n'en décide den. Ah! l'intelligence est agréable, elle est divine, mais elle ne peut servir à diriger les hommes puisqu'elle vous en sépare tout de suite. Montaigne, Stendhal, Mérimée sont des hommes intelligents: ce ne sont pas des chefs.»
Ils se turent. Le vieillard admirait la beauté de la jeune femme: elle regardait le jardin médiocre et la pluie fine dans le soir gris. Elle secoua brusquement la tête.
—Quelquefois, dit-elle, toute cette agitation, toutes ces luttes m'apparaissent brusquement comme des jeux d'enfants méchants et sots. Pourquoi faire, parrain? pourquoi faire? Qu'est-ce que nous demandons? Le calme, une chaumière, la santé, de belles choses. Pourquoi se battre?
—N'oubliez pas, dit-il, que pour vous donner cette chaumière, il a fallu à l'humanité quelques milliers d'années de travaux douloureux. Et puis on se lasse de tout, et surtout du bonheur: les crises de prospérité produisent des crises de mysticisme.
—On se lasse de tout, répéta-t-elle avec une intonation d'une force étrange.
Bertrand d'Ouville la regarda: elle détourna les yeux et avec une vigueur qui détonna très légèrement:
—Et vous, parrain, dit-elle, que feriez-vous si vous deviez arranger tout cela? Car il faut bien faire quelque chose.
—Oh! moi, vous savez que je vois petit et que je tiens une politique à longue vue pour bien plus dangereuse encore qu'une politique à courte vue. Les faits, vous dis-je, les faits. Il faut les observer, les surveiller, essayer de s'en servir pour construire et non pour détruire, et s'efforcer de faire accepter aux foules la bonté sous le masque de la violence... Tout cela est bien vague: allons, faites-moi voir mon filleul.
«Bertrand d'Ouville à Philippe Viniès.
«Abbeville, 10 mars 1848.
«Liberté, Égalité, Fraternité! Vous voyez que je me conforme aux usages du temps: ce fut toujours ma politique. D'ailleurs, mon cher communiste, vos doctrines gagnent: j'ai dû hier, rue Saint-Gilles, protéger un gamin de cinq ans qui venait d'annexer un pain d'épices. À cela près la ville est paisible, et le peuple ne paraît pas se douter qu'il a fait une révolution. J'ai dû ce matin expliquer aux ouvriers qui travaillent pour moi qu'ils sont souverains pour le quart d'heure. Cela n'a d'ailleurs point changé leur belle politesse picarde. Les gens d'ici restent serviables; c'est qu'ils n'ont jamais été serviles.
«Cependant M. Ledru-Rollin nous a envoyé un commissaire pour la Somme. Il est venu chez nous proclamer la République «au nom du peuple français, à la face du Ciel qui m'entend et qui me répond». Puis il s'est occupé, à la face du Ciel, de destituer les fonctionnaires. Vous même, mon cher, avez failli l'être. Vôtre femme vous a sauvé. Seul le sous-préfet n'a pas été inquiété: le voici républicain de la veille. Il avait sans doute, à notre insu, divisé sa vie en quatre parts.
«Il s'occupe, pour montrer son zèle, de nous gouverner à la mode du temps. Car nous nous tenions aussi mal qu'en 93. Nous n'avions ni clubs, ni cortèges, ni lampions. C'était scandaleux, et le commissaire nous a envoyé un professionnel pour y mettre bon ordre, et nous agiter pacifiquement. Ce délégué est professeur de belles-lettres. Il est honnête et doux, mais exalté et naïf. Comme personne ne lui parlait, je lui ai montré mes fossiles. Il m'a fait voir en échange son télégramme à Ledru-Rollin:
«—Envoyez des Déclarations des Droits de l'Homme: elles sont nécessaires ici.»
«En effet, on n'y connaît, je crois, que les droits du locataire et du propriétaire.
«Il a réussi à planter un arbre de la liberté et à organiser un cortège. Il y avait en tête un sapeur du génie, représentant le travail et l'intelligence, un élève du collège portant le Contrat Social couronné d'immortelles, et un ouvrier dont la pioche était couronnée des mêmes fleurs. Ils sont allés travailler symboliquement à mes fouilles des fortifications (une attention de mon ami le délégué), puis se sont embrassés. Le travail symbolique remue peu de terre: mais quelques âmes sensibles pleuraient de joie.
«Le délégué et le sous-préfet ont persuadé aussi non sans peine les ouvriers de Bresson de se répandre le soir dans les rues pour forcer les bourgeois à illuminer. Il y eut donc hier dans ma rue une procession patriotique qui s'arrêta devant ma maison en criant: «Les lampions!» Au bout de cinq minutes, je suis venu au balcon et leur ai dit: «Mes chers concitoyens, si je n'ai pas illuminé, c'est pour deux raisons: cela fume et cela pue. Cependant, pour vous être agréable, je vais faire apporter des chandelles. Je vous prie seulement de vouloir bien désigner fraternellement une douzaine de bons patriotes pour les tenir et les moucher.» Ce petit discours a eu un succès inattendu et me voici fort populaire.
«Ces scènes d'émeute ont affolé votre ami Bresson. Il a fait voter par la Garde Nationale une motion refusant aux ouvriers des fusils que demandait pour eux le délégué, et il organise avec le maire des cortèges de protestataires. Mais tout cela est sans danger, car les deux partis s'entendent pour ne pas manifester le même soir. D'ailleurs vous connaissez Abbeville et s'il se trouvait ici deux hommes pour se battre, il s'en trouverait vingt pour les en empêcher.
«À Amiens cependant les choses se sont gâtées par la faute des commissaires. M. Ledru-Rollin, par erreur sans doute, en avait envoyé trois qui tous refusaient de s'en aller. Le premier venu, Leclanché, a trouvé le moyen d'exaspérer nos gens par sa tenue: chapeau à boucle d'acier, gilet blanc à grands revers, pantalon collant et bottes molles. Ce spectre de conventionnel a été ramené à la gare un peu vivement. Les Amiennois acceptent la République, ils l'acceptent même avec joie, mais ils exigent qu'elle s'habille comme tout le monde. Je ne les blâme point.
«J'ai vu votre femme qui est bien seule: nos excellentes commères trouvent naturellement pour votre absence d'effroyables explications. Seule la sous-préfète lui rend visite assez souvent, n'étant pas très sûre que vous ne serez point ministre. Je me permets un conseil de vieil ami: faites-la venir si vous avez un poste. Revenez, si vous n'en avez pas.
«Je serai, moi aussi, heureux de vous revoir; nous ne penserons de même sur aucun sujet et discuterons sans fin, mais je vous sais désintéressé, et je vous aime bien.
De tristes lettres de Geneviève et une note pressante de M. Lecardonnel rappelèrent à Philippe qu'il n'avait pas toujours été le secrétaire indépendant d'un préfet de police révolutionnaire. Il évoqua sa femme, le menton appuyé sur la main trop blanche, les yeux clairs regardant tristement la maison vide et il se décida à rentrer. Il avait assez d'imagination pour n'être pas méchant quand son orgueil n'était pas en jeu.
D'ailleurs, depuis la découverte de la trahison de son ami, Caussidière le traitait mal et il était sensible à cette injustice. Vingt républicains du lendemain demandaient sa place: il partit sans regrets.
Geneviève vint le chercher à la gare: il fut heureux de revoir sa jolie tête, elle contente de pouvoir se suspendre à son bras. Ils rentrèrent à pied, bavardant avec animation. Il lui raconta tout de suite l'histoire de Lucien qu'il n'avait pas voulu écrire.
—Quel être odieux, dit-elle; je l'ai toujours détesté.
C'était un mensonge, mais inconscient.
Elle s'inquiéta de Lamartine.
—Je l'ai vu plusieurs fois et n'ai pas changé d'avis sur son compte. Il est courageux quand il s'agit de sa vie, timoré quand il s'agit de ses idées. Ce n'est pas l'homme qu'il faudrait au pouvoir.
Elle défendit son héros au masque grave, mais Philippe s'arrêta pour regarder les corbeaux de Saint-Vulfran. Il retrouvait avec plus de plaisir qu'il n'eût pensé le vieux et noble décor, et, sur la Grand'Place, les frontons pointus des hautes maisons de brique rouge ornées de cordons de pierre.
La maison et le jardin lui semblèrent plus petits que jamais: Geneviève lui fît voir les changements dont elle était fière, un rideau qu'elle avait brodé, des fleurs qu'elle avait semées et qui montraient des pointes vertes, et le bébé qui marchait bravement et savait quelques mots nouveaux.
Le scribe des Ponts et Chaussées prévenu par elle avait apporté le matin les lettres officielles: Philippe ouvrit la première et la tendit à Geneviève, amusé. Elle était du sous-préfet.
Celui-là, dit-il, est comme ces plantes qui restent vertes en toutes saisons: il se chauffe au soleil de tous les régimes. Vois son entête:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté—Égalité—Fraternité
—Il m'appelle: Citoyen Ingénieur... et termine sans honte par salut et fraternité... Et naturellement c'est une réclamation du maire d'Ault contre les flottes et la marée.
—La sous-préfète était devenue charmante pour moi, dit Geneviève, elle te croyait ministre.
—Celle-ci est du maire de Gamaches, je reconnais son écriture d'enfant appliqué. Je parie qu'il est question de la Route Royale n° 32... Tu peux l'ouvrir.
—Tu as perdu, dit Geneviève, elle s'appelle maintenant Route Nationale. Mais elle reste n° 32: cette république est décidément conservatrice.
—J'espère qu'elle ne le sera pas longtemps dit Philippe; le peuple n'a pas encore parlé... Ah! le peuple, le premier jour, devant l'Hôtel de Ville, Geneviève, c'était beau! Cette masse, cette force, ces chants et en même temps ce calme majestueux.
Avec ces trois semaines de recul, la journée du 25 février était devenue pour lui un fragment d'épopée qu'il récitait, en toute bonne foi.
—Et ici? demanda-t-il. Que seront les élections?
—Je ne sais pas du tout, dit Geneviève, moi, je vis dans mon petit coin et je ne me suis aperçue d'aucun changement... Parrain pourra t'en dire davantage: j'espère qu'il viendra.
—Oh! il m'ennuie, dit-il avec impatience: il triomphe, je suppose, comme toujours, et nos difficultés ont dû le divertir.
—Ne sois pas injuste: il a été très précieux pour moi. Il est venu me voir souvent et m'a comblée de livres. Je crois que sans lui je serais morte d'ennui.
—Ma pauvre chérie, dit-il embarrassé, je t'avais laissé bien seule!
—Cela ne fait rien puisque tu es là. M. Lecardonnel est venu me voir aussi; il m'a dit: «Hum... hum... Madame Viniès, ils ont voulu me faire crier «Vive le Gouvernement provisoire» ...Je leur ai répondu: impossible, car ayant défini ce gouvernement comme provisoire, il serait contraire à l'hypothèse de lui souhaiter la durée... comprenez-vous?
Philippe sourit faiblement.
Vers le soir, Bertrand d'Ouville vint en effet; il se fit raconter les aventures de Philippe, puis dit à son tour comment il avait aidé une des princesses à s'enfuir; il regrettait vivement le Roi et ses fils.
—C'est dommage, dit-il, c'était de braves gens, mais on les a mal conseillés; on a voulu les faire gouverner pour une classe, rien de plus dangereux. On n'a réussi qu'à soulever les uns contre les autres, ces bourgeois et ce peuple français qui ont pourtant si profondément les mêmes vertus et les mêmes travers... enfin, cette révolution paraît honnête.
—Elle n'est pas commencée, dit Philippe; si l'Assemblée nationale ne fait pas triompher la vérité, il reste une ressource, les barricades; vous ne connaissiez pas ici la situation véritable; le véritable maître de Paris, ce n'est pas Lamartine, c'est Blanqui avec ses clubs, c'est peut-être Caussidière avec ses montagnards.
—Croyez-vous, mon cher? Les élections faites, la force de la masse conservatrice prouvée, il sera bien difficile de lui arracher le pouvoir auquel il sera prouvé qu'elle a droit.
—C'est pourquoi je reproche à ce gouvernement d'avoir fait les élections trop tôt. Il fallait instruire le peuple avant de le consulter. Mais que voulez-vous, il n'y a pas, dans toute cette bande, un seul homme d'action. Veuillot a raison: nous avons pris le chef de musique pour colonel. Lamartine fait des phrases: il ferait mieux d'organiser les ateliers nationaux. Et autour de lui, en qui espérer? Garnier Pagès? Un Bresson parisien. Marrast? Un aristocrate prétentieux. Louis Blanc? Un pion timide. Pas un homme qui sache vouloir.
—Ma foi, dit Bertrand d'Ouville, moi, je leur suis très reconnaissant de faire si peu de mal, ils ne tuent personne, c'est beaucoup. La guillotine a désuni la France pour plus de cent ans.
—Je ne suis pas de votre avis, monsieur: Il y a des cas où une courte violence peut mettre fin à un long esclavage.
—Quelle idée! La violence ne met fin à rien du tout; si elle est nécessaire pour détruire un régime, c'est que ce régime était encore vivant, et dès lors il renaîtra. Pour qu'une révolution soit utile, il faut qu'elle se borne à sanctionner une évolution déjà accomplie et dans ce cas elle n'a pas besoin de la violence. On ne peut détruire que ce qui est détruit.
Vous me faites penser, mon cher, à Machiavel, maudissant le pauvre Pier Soderini, âme timide auquel son mépris refusait l'entrée de l'Enfer. «Va dans les limbes avec les petits enfants» dites-vous à Lamartine et à ses amis. Ma foi, je vous demanderai la permission de les y rejoindre. Plus je vieillis, et plus je me persuade qu'il ne faut faire souffrir personne inutilement.
—J'attendais le «quand vous aurez mon âge» dit Philippe à Geneviève quand il fut parti: il n'y a pas d'argument qui m'exaspère davantage. Je pourrais répondre «si vous aviez mon âge» et nous ne discuterions pas plus avant.
—Oui, dit Geneviève, je suis contente que tu sois revenu: cela me fait du bien d'entendre de nouveau tes petits discours.
*
* *
Dès le lendemain, il se mit avec ardeur à travailler aux élections. La situation était fort obscure, tous les candidats étant républicains. Les nobles l'étaient plus que les bourgeois, les bourgeois plus que les ouvriers. D'ailleurs ces derniers refusaient d'être candidats.
«—Ch'est des tours ed' gobelets, répondaient-ils aux exhortations de l'ingénieur.
Les commerçants dont Bertrand d'Ouville aurait voulu former une liste étaient également réfractaires: «Moi je reste dans m'boutique» disaient-ils.
Ils décidèrent l'archéologue à se présenter lui-même. Il publia une profession de foi honnête et modérée: il y admettait, tout en regrettant la personne de Louis-Philippe, que la République était devenue le seul gouvernement possible en France, prêchait le respect de la propriété, la liberté du commerce, l'amélioration du sort des classes ouvrières, et concluait: «Plus de factions, une France paisible et forte, un seul cri: la Patrie!»
Sa candidature eut au début un certain succès, mais il dut reconnaître avec humilité que cette popularité n'était due ni à ses mérites, ni à son style. Il était célèbre, dans le pays, lui expliquèrent ses partisans, parce qu'il était assez fou pour déterrer des cailloux à grands frais, et surtout parce qu'il se baignait dans la Somme en plein hiver. Ce dernier trait étonnait les paysans que l'eau froide effrayait et leur inspirait une vive estime pour son courage.
Mais le comité départemental Ordre-Famille-Propriété qui présentait une liste compacte de propriétaires bien pensants en tête de laquelle figurait le comte de Vence, républicain, eut vite fait d'éliminer cet esprit dont la fantaisie les inquiétait.
Le bruit fut répandu qu'il tenait des propos anarchistes, qu'il était lié d'amitié avec le communiste Viniès, et que le commissaire perturbateur de Ledru-Rollin avait pris un repas chez lui.
D'autre part le comité démocratique fut informé qu'il avait en 1825 écrit les paroles d'une cantate adressée à la Duchesse de Berry lors de son passage à Abbeville.
—Ma foi, dit-il, c'est parfaitement vrai: je l'ai fait pour obliger mon, cousin Genzé qui en avait composé la musique. D'ailleurs j'estimais fort cette princesse à cause de son caractère tout français, et je l'estime encore, ne vous en déplaise.
Cela lui aliéna les anciens orléanistes. On l'acheva en racontant aux femmes qu'il voulait les faire passer pour des fossiles contemporains des mastodontes.
Cependant Philippe poursuivait une campagne socialiste et se heurtait à des forces obscures et puissantes. C'était parfois de la sottise, de la crainte souvent, mais surtout une méfiance têtue et une indifférence hautaine. Il ne pouvait s'empêcher de penser sans cesse à des expériences faites jadis à l'École sur la résistance des milieux visqueux. Une masse de poix, molle et presque liquide, sous des coups de marteau formidables, se déformait à peine. Ces paysans, ces marchands, ces ouvriers picards, paternes et bonasses, venaient aux assemblées électorales, mais les discours les plus vibrants ne les ébranlaient pas. Ils semblaient considérer la séance comme un spectacle et les candidats comme des comédiens. Les idées ne pénétraient pas.
L'éloquence de Bertrand d'Ouville, grave et parfois un peu pédante, plaisait assez: «J'aime cet homme-là, il est didactique» disait le père Pillet, chapelier. Mais quand on connut les résultats, la liste Ordre-Famille-Propriété passait tout entière. L'archéologue arrivait quinzième derrière les quatorze élus.
—Je regrette que vous ne soyez pas des nôtres, mon cher, lui dit M. de Vence, représentant républicain de la Somme, mais qui eût dit cela du Suffrage universel? Les voies de la Providence sont impénétrables.
—Ces élections sont en effet excellentes, répondit-il avec un peu d'amertume. Vous représentez tous fort bien l'opinion moyenne de cette province qui désire avant tout qu'on la laisse en paix et qui craint les idées comme le choléra.
Philippe Viniès était tragique et découragé:
—Voyez-vous, lui dit l'archéologue, c'est peut-être la bonne ville qui a raison contre nous. Métropole campagnarde, elle maintient avec les villages, ses vassaux, les liens qu'ont créés au cours des siècles la pente des vallées et le tracé des routes. Parmi tant de lois et de pouvoirs qui passent, elle dure, et la France continue. Et sans doute il est bon que, tous les cinquante ans, Paris la force à penser un instant, mais il en est de ce ménage comme des autres, et le contraste y fait l'harmonie.
En quittant l'archéologue Philippe rencontra le père Pitollet qui, en dépit de ses quatre-vingts ans allait encore chaque matin, militaire et vigoureux, faire ses achats au marché. Le «Général» s'arrêta, et mystérieux, tira de sa poche un papier à chandelles surmonté d'une vignette grossière.
—Lisez ceci, dit-il à l'ingénieur en clignant de l'œil.
—Le Napoléon républicain, lettre de l'Empereur à son peuple, lut Philippe surpris... Français, j'avais désiré que mon corps reposât sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Je reviens après un quart de siècle instruit par le malheur, la retraite et la méditation. Je n'étais pas né pour la guerre....
—Hein? tout de même, fit le vieux, s'il n'était pas mort...
Dès le mois de mai 1848 la Révolution entra en agonie. Elle ne mourait pas comme le croyait Philippe de l'erreur de Lamartine et d'une élection prématurée. Elle mourait parce qu'une bourgeoisie encore vigoureuse n'hésitait pas à descendre dans la rue pour apporter à ses lois l'appui de ses baïonnettes, et parce que la province écrasait l'émeute de tout le poids de sa saine et puissante médiocrité.
«Le cardomnel avait raison, disait Bertrand d'Ouville, la propriété n'est pas un droit de l'homme; c'est un droit de la Garde nationale: elles vivent et périssent ensemble.»
Cependant le peuple de Paris, justement déçu, frémissait encore à tout appel. Dans les Ateliers Nationaux, que nul n'essayait d'organiser, quatre-vingt mille ouvriers vivaient dans une paresse qui leur était odieuse. Des provinces arrivaient par chaque train des compagnons nouveaux qui venaient s'y enrôler. Le gouvernement, inquiet, les traitait avec une bienveillance sournoise et songeait à s'en débarrasser.
Philippe, énervé et anxieux, tenait aux ouvriers des Clubs des discours dont la violence étonnait leur placidité et les engageait à se rendre à Paris pour y défendre la République.
Un matin il reçut à son bureau une lettre urgente du sous-préfet.
ARRONDISSEMENTRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
d'ABBEVILLE
CABINETLiberté—Égalité—Fraternité
DU SOUS-PRÉFET
CITOYEN INGÉNIEUR,
Je suis informé par le commissaire de police que vous avez hier soir invité une réunion assez nombreuse d'ouvriers sans travail à se rendre à Paris pour s'y embaucher aux Ateliers nationaux.
Vous ignorez certainement la circulaire du Citoyen ministre de l'Intérieur en date du 11 avril dernier, qui fait connaître qu'il importe de prendre des mesures pour mettre fin aux départs de ce genre. Des ordres formels sont donnés aux gares, diligences, gendarmeries, pour que les ouvriers sans ouvrage soient empêchés de se rendre à Paris et pour que ceux qui se trouvent à Abbeville soient renvoyés dans leurs communes respectives, au besoin avec un secours de route.
Je ne doute pas qu'il ne vous suffise de connaître les intentions de l'administration pour vous employer avec zèle à agir dans ce sens de toute votre influence. Si cependant vous persistiez dans votre présente attitude, je me verrais obligé de soumettre votre cas au citoyen ingénieur en chef et au citoyen commissaire du Gouvernement pour le département de la Somme.
Salut et Fraternité.
Philippe était déjà de fort méchante humeur: il revenait d'Ault où les dernières marées avaient triomphé de son mur. Il avait longtemps regardé les énormes vagues verdâtres qui arrivaient lentement du large, et s'abattaient avec une force terrifiante sur les débris de l'ouvrage qu'elles roulaient dans les champs inondés. Des blocs de maçonnerie à demi enfouis dans les sables prenaient déjà l'aspect de rochers anciens. La courbe du mur était parfaite, mais les galets avaient traîtreusement miné les fondations insuffisantes.
Il quitta son bureau pour rentrer déjeuner, la tête basse et l'âme sombre; sur la place il remarqua un groupe d'ouvriers qui discutaient et s'approcha. L'un d'eux le connaissait et lui dit, en chuintant, leur colère:
—Nous avons été à ch'gare pour aller n's'embaucher à Paris: ch't'agent du bureau nous a refusé ch'billets... C'est les ordres de ch'sous préfet... Enfin est-on en République?
—N'accusez que vous-même, dit Philippe exaspéré, vous acceptez tout. Il y a trois mois, on vous adulait: vous vous laissez faire, et l'on vous insulte. Si vous ne les défendez pas, demain les Ateliers nationaux seront fermés... Et par qui? Par des ministres qui sont vos commis et qui doivent exécuter vos ordres. Le sous-préfet vous défend d'aller à Paris? Belle audace en vérité! Mais qui l'a fait sous-préfet, sinon vous? Allez donc le lui demander.
—Yes milord, dit une voix connue, et il y eut des rires.
—Allons-y, dirent quelques jeunes, piqués.
—Venez avec nous, dit un vieux, et nous irons.
Il tombait une pluie fine et serrée: Philippe hésita, regarda l'heure, haussa les épaules, et dit:
—Soit.
Trois par trois, se donnant le bras, ils se formèrent en cortège: quelques citoyens prudents disparurent au tournant de la Grande-Rue Notre-Dame. Il était midi et les ouvrières de Bresson, allant vers le faubourg, traversaient la place. Quelques jolies filles intriguées par ce bataillon de blouses, obliquèrent pour se renseigner. Quand elles comprirent qu'on manifestait elles se mirent bravement autour de Philippe. L'une d'elles prit son bras: cela l'agaça. Une autre qui avait un tablier rouge l'enleva pour l'agiter au-dessus de sa tête. Il y eut des murmures.
—Enlevez ch'drapeau, dirent des voix dans la colonne.
Mme Urbain qui les vit passer poussa un cri:
—Jésus, mon doux Seigneur, c'est la Révolution!
Et elle se précipita chez M. Pillet: ce vieux soldat la défendrait peut-être.
Cependant la petite troupe de Philippe était arrivée devant la sous-préfecture et s'était rangée autour du porche. La porte de bois sculpté était fermée. Philippe avait retrouvé son sang-froid et se trouvait ridicule: «Mais qu'importe, pensait-il, ces braves gens ont confiance en moi.» En effet les ouvriers étaient vaguement inquiets et seule la présence de ce fonctionnaire les rassurait un peu.
—Je vous recommande, leur dit-il, le silence et l'ordre: il faut qu'un de vous parle au nom de tous.
Ils eurent beaucoup de mal à trouver un orateur.
Un honnête garçon qui se nommait Lecadieu et auquel Philippe avait souvent prêté des livres accepta enfin de parler: «Ça me coûtera ma place, dit-il tristement, mais, ma foi, autant moi qu'un autre.»
Une des jeunes filles sonna, il y eut un long silence. Puis on entendit des pas sur les pavés de la cour. Une domestique montra sa tête et, voyant cette foule, se rentra vivement et dit: «Seigneur.»
Philippe s'avança: «Ces citoyens, dit-il, désirent voir le sous-préfet.»
—Mais monsieur est à table.
—Il aura l'obligeance d'interrompre son déjeuner.
Elle courut vers la maison. Une minute après, le sous-préfet arrivait achevant une bouchée rebelle et essuyant sa moustache.
L'orateur s'avança et dit la requête des ouvriers avec beaucoup de calme et de bon sens.
Le sous-préfet, pris au dépourvu, cherchait des phrases.
—Citoyens, mes amis... vous connaissez mes sentiments... Travailleur moi-même... les ordres du ministre... les ouvriers le comprendront sans peine... bon sens et patriotisme intelligents dont ils ont toujours fait preuve.
Découvrant Philippe, il lui lança un regard furieux; puis, il eut une inspiration.
—Avant tout, citoyens, laissez-moi relire les ordres du ministre qui permettent peut-être de vous donner satisfaction.
Il battit vivement en retraite et, tout de suite, par la petite porte du jardin, envoya un messager au colonel de la Garde nationale pour le mettre au courant de la situation.
Les ouvriers patients attendaient.
Philippe regardait l'heure, pensant à l'inquiétude de Geneviève; au bout de dix minutes, il proposa de sonner à nouveau. Comme il venait de le faire, on entendit dans le lointain un tambour battant à coups rapides.
—Le rappel, pensa-t-il, ce petit drôle s'est moqué de nous.
Sa troupe dressa l'oreille, il conseilla le calme et la fermeté; quelqu'un lança une pierre dans la porte, puis deux officiers de la Garde nationale arrivèrent à moitié habillés, achevant de boutonner leur uniforme; le sous-préfet enhardi reparut à leurs côtés.
—Citoyens, dit-il, retirez-vous. Dans dix minutes la force armée sera ici; les ordres du ministre sont formels. Quant à vous, monsieur, lança-t-il à Philippe, si vous n'employez votre influence à faire cesser ce scandale...
—Il n'y a aucun scandale, tout le monde ici est fort calme, sauf vous.
D'autres officiers arrivèrent; quant aux Gardes nationaux, prudents, ils attendaient des nouvelles rassurantes pour sortir de leurs maisons.
La pluie tombait plus fort.
—Moi, je m'en vas à m'maison, dit un manifestant fatigué. Beaucoup le suivirent et il ne resta plus autour de Philippe qu'une poignée de braves.
En face d'eux, ne sachant trop que faire, le sous-préfet et l'état-major de la Garde nationale discutaient à voix basse.
Soudain, une voix éraillée tomba du ciel.
—Et nous y voici... belle porte. Milord..., beau point de vue... beaux officiers... nommés par les Anglais.
C'était Jalabert qui ayant vu se former une troupe et se préparer une bataille avait, en vieux soldat, marché au canon et qui, commençant à s'ennuyer, avait escaladé par une gouttière un des piliers du porche.
—Toi, mon bonhomme, dit le sous-préfet, furieux, je vais te faire arrêter.
—Yes, Milord, répondit le bonhomme, si la paille est fraîche, allons-y gaiement.
Le rire rapprocha aussitôt les hommes de Philippe et les Gardes nationaux. Devant cette vieille plaisanterie abbevilloise, ils ne furent plus que des gens d'une même ville qui se rencontrent chaque jour dans les rues et s'amusent des mêmes fantoches.
Bourgeois et ouvriers unis au fond dans leur mépris du fonctionnaire se divertirent à entendre le sous-préfet discuter avec l'ivrogne.
Philippe, voyant l'affaire terminée, salua et s'éloigna lentement. Du bout de la rue, il entendait crier: «Vive le 106e! Vive le colonel Achard! Vive la duchesse de Berry!»
Il pensait aux belles foules nerveuses de Paris.
Geneviève avait été inquiète, mais quand Philippe la rejoignit dans le jardin, et lui raconta sa matinée, elle s'amusa comme une mère indulgente d'une plaisanterie de collégien.
Cependant, la bonne ville était mécontente. «L'Abbevillois» fit un long article: «Hier des bruits sinistres ont couru en ville; d'honnêtes ouvriers trompés par des agitateurs dangereux auraient levé, dit-on, le drapeau rouge de la révolte...
Le sous-préfet adressa au préfet un terrible rapport où la perfidie de l'ingénieur séditieux contrastait avec le courage de l'héroïque représentant de l'administration.
Le préfet proposa à l'ingénieur en chef la révocation de M. Viniès.
«M. Trélat, Ministre des travaux publics, est un homme d'ordre, adversaire résolu des Ateliers Nationaux, il vous l'accordera certainement.
«D'ailleurs, si vous ne jugez pas à propos de transmettre ma plainte, je demanderai moi-même cette révocation par l'intermédiaire de mon département.»
Lecardonnel et Bertrand d'Ouville firent ensemble une démarche pour sauver Philippe; ils parlèrent avec une émotion vraie de sa jeune femme et de son enfant.
Le préfet, qui n'était pas un mauvais homme, fléchissait et Bertrand d'Ouville trouva l'argument qui acheva de le convaincre.
—N'avez-vous pas, Monsieur le préfet, un intérêt personnel évident à conserver une opposition. Les socialistes sont fort rares dans ce pays du bon Dieu. Je n'y connais que M. Viniès et moi. Si M. Viniès s'en va, je reste seul et je les représente fort mal. Dès lors, vous vous privez de ces triomphes faciles qui font à la fois votre force dans le département et votre prestige auprès du pouvoir central.
Le préfet consentit à surseoir un mois, aussi bien, voulait-il savoir comment les événements tourneraient à Paris avant de se faire un ennemi car la dissolution des Ateliers nationaux allait jeter dans les rues 100.000 hommes désespérés auxquels cette injustice paraîtrait d'autant plus odieuse qu'elle leur serait infligée par des ministres qui leur devaient tout.
Le Gouvernement était encore composé des hommes de février que le jeu mystérieux des rouages du inonde acculait à un reniement involontaire et douloureux.
Ledru-Rollin qui se trouvait toujours porté en avant de ses propres idées s'étonnait d'avoir à se faire défendre de ses amis par ses ennemis.
Lamartine, pâle, défait, découvrait avec effroi des passions humaines dans la belle République qu'il avait tant aimée et dont il avait fait si longtemps l'Elvire de sa maturité.
Devant le danger, le pouvoir glissait, suivant une pente naturelle au général Cavaignac, honnête homme, qui savait manœuvrer des fusils.
La lutte fut brève et les deux côtés héroïques.
De Doullens, d'Amiens, de Rouen, des bataillons de gardes nationaux vinrent bravement faire ce qu'ils croyaient être leur devoir. «Un homme ce n'est rien, mais c'est l'idée» disait un ouvrier blessé à mort.
Les courages étant égaux, la stratégie gagna la bataille. Cavaignac comprit le premier, qu'une armée dans une grande ville doit, avant tout, demeurer concentrée. En février, les régiments, dispersés dans leur caserne ou occupant des points que l'on croyait importants, s'étaient trouvés isolés dans la foule et avaient vite capitulé. Cavaignac fit un camp retranché autour de la Chambre des Représentants, maintint les communications de ce camp avec son arsenal et sur ce centre appuya ses colonnes d'attaque; il fut vainqueur.
Alors, ceux qui avaient eu peur sortirent de leurs abris et réclamèrent des victimes.
Dans la petite ville même où les vagues de la révolution étaient venues mourir en rides silencieuses et légères, on demandait l'arrestation des meneurs, l'ingénieur Philippe Viniès et cet ouvrier Lecadieu qui avait pris la parole à l'attaque de la sous-préfecture.
Un dimanche soir, Bertrand d'Ouville entra chez les Viniès, fort ému; il arrivait de Paris et avait vu le ministre.
—Mes enfants, dit-il, il faut partir; là-bas, on parle d'arrêter Ledru-Rollin, Louis Blanc et Caussidière; le sous-préfet vous a dénoncés et l'on s'occupe aussi de vous. Lecardonnel et moi nous ferons facilement traîner les choses assez longtemps pour vous embarquer pour l'Angleterre; j'y ai des amis qui vous y emploieront.
—Pourquoi fuir, dit Philippe, je n'ai rien à me reprocher.
Geneviève le supplia d'accepter. Si même il n'y avait pas de danger immédiat, elle était malheureuse. Leur propriétaire leur avait donné congé; les commerçants refusaient de la servir; dans la rue, les hommes tournaient la tête pour ne pas la saluer.
Quand elle voulait fortement, Philippe était faible devant elle.
—Et nous laissera-t-on partir? dit-il.
—Cela, dit Bertrand d'Ouville, j'en fais mon affaire. Le préfet sera trop heureux d'éviter un procès qui serait ridicule. Je vous embarque à Boulogne dans trois jours.
—Quels tristes animaux que les hommes, dit Philippe.
—Eh! oui, dit Bertrand d'Ouville, mais on peut aimer les animaux.
Et, pour les distraire, il parla de Paris.
—Tout est de nouveau calme, j'ai été au Cirque! il y avait foule; tous les beaux, des demoiselles, des représentants... mon coiffeur du Palais Royal m'a dit: «Nous revoyons des Anglais».
*
* *
Les trois jours qui suivirent furent si remplis que les Viniès n'eurent guère le temps de penser à la tristesse de l'exil prochain; Geneviève remplissait des caisses, le bébé maladroit et affairé trottait derrière elle dans la maison, jetait ses jouets en désordre dans toutes les malles et se faisant renverser cent fois par jour, poussait des cris furieux qu'il fallait apaiser.
Philippe transformait en argent liquide la petite somme qui leur restait, mettait en ordre son bureau et, à ses moments perdus, aidait Geneviève.
Il était beaucoup plus découragé qu'elle.
—Ne cherche pas à prévoir, lui disait-elle, rien n'est jamais si beau ni si triste qu'on l'aurait cru; fais comme moi, j'emballe; je ne pense pas à autre chose.
Cependant, le matin du départ, quand ses bagages furent achevés, elle faiblit un peu. Avec la petite bonne affolée qui pleurait, elle fit le tour de sa maison, regarda les murs nus, les armoires ouvertes et vides, les lits sans draps et sans couvertures et, par les fenêtres sans rideaux, le petit jardin de curé qu'elle avait cultivé elle-même.
—Ma petite maison... dit-elle; elle n'était pas belle, mais j'avais fini par m'y attacher.
Mais, trouvant Philippe en bas, elle lui sourit maternellement.
Le bébé, que tout amusait, leur fut utile en chemin de fer. À Boulogne, Bertrand d'Ouville les attendait, il était là depuis la veille et avait tout préparé. Sa voiture les emmena jusqu'au bateau. M. Lecardonnel avait fait le voyage pour leur dire adieu. La tête sur l'épaule, son mufle de vieux lion enfoui dans le mouchoir jaune, il serra la main de Philippe.
—Au revoir, Viniès, ne regrettez rien... la vie recommence à chaque instant... série noire, série blanche... comprenez-vous?
Geneviève, tenant son fils par la main, se sentait enfin calme et presque heureuse. Le long du quai, le petit paquebot se balançait et la passerelle de bois craquait suivant un rythme lent.
—C'est curieux, dit-elle à Bertrand d'Ouville, cet inconnu ne m'effraye pas; je n'ai pas été heureuse ici, nos rares amis viendront nous voir et puis l'étranger... il me semble commencer une vie aventureuse.
—Oui, vous verrez qu'il y a une certaine douceur à vivre en Angleterre, les Français que vous y rencontrerez vous paraîtront si agréables.
Elle sourit: «Vous n'êtes pas encourageant.»
—Je m'explique mal: j'aime le caractère anglais... beaucoup, mais je veux dire que des hommes comme Viniès y apprendront combien tel Français qu'il méprisait ici sont plus près de lui vraiment que l'Anglais le plus libéral.
Sur le paquebot, une cloche sonna, le bébé effrayé se serra contre sa mère.
—Il faut partir, dit-elle... adieu.
Les trois exilés traversèrent la passerelle. Ils restèrent sur le pont du bateau. Geneviève s'assit sur une caisse, son fils à côté d'elle; de larges gouttes de pluie tombaient pesamment. La cloche sonna à nouveau; la passerelle fut retirée, et le bateau à aubes, maladroit, s'écarta lentement du quai. Sur le pont encombré Philippe et Geneviève semblaient se serrer plus près l'un de l'autre dans la pluie qui devenait forte.
—La dernière fois que je suis venu ici, dit Bertrand d'Ouville, comme les deux vieillards s'éloignaient, c'était en 1811. Je vis sur cette place l'Empereur qui galopait sur un cheval gris. Il voulut traverser le port à marée basse, mais sa monture buta contre un cordage et Napoléon roula dans la vase. Il était furieux.
Bertrand d'Ouville à Geneviève Viniès
Abbeville, octobre 1853.
Abbeville est en fête aujourd'hui: M. Bonaparte et l'Impératrice nous rendent visite pour la première fois. J'ai donné congé à mes domestiques et suis seul dans la maison. Des souris trottinent derrière les boiseries. Mes chiens couchés à mes pieds méprisent comme moi les grands de ce monde. Par les fenêtres ouvertes m'arrivent le son des cloches et le bruit du canon. Des bouffées de musique, des cris de marchands, des rires de femmes surgissent du murmure continu de la foule que l'on devine autour du jardin. Je jouis de ma solitude, et je rêve.
Tous nos bourgeois ont pavoisé: ce gouvernement protégera leurs placements. Notre sous-préfet, inamovible, vient de passer en bel uniforme. Je vois maintenant que c'est avec sagesse qu'il divisait sa vie en trois parts: il devait consacrer la première au Roi, la seconde à la République et la troisième à l'Empire. Il était hier fort occupé à faire effacer des monuments publics l'Égalité et la Fraternité.
Par ses ordres aussi on coupe les arbres de la liberté et on en distribue le bois aux pauvres, ce qui est peut-être un symbole profond.
Cependant la bonne ville, assise au milieu des terres, tient ses marchés rustiques, aux jours consacrés. Mme Urbain vend des légumes, monsieur Pillet des chapeaux et monsieur Larcher du latin. Le gendarme Gorenflot fait des rapports sur les suspects d'aujourd'hui qui sont les mêmes que ceux d'hier. Et Milord Yes montre la Cathédrale et couchera ce soir au violon. Vous seuls, mes pauvres enfants, êtes exilés de ce beau pays pour avoir renversé monsieur Guizot au profit de monsieur de Morny.
Ce gouvernement a pour lui les baïonnettes, l'Église, la banque et la légende: il durera. «L'anarchie est heureusement accouchée du despotisme: la mère et l'enfant se portent bien». Ainsi Paris se console par des mots, mais ne les croyez pas: la mère est morte en couches.
Faut-il en pleurer? Monsieur Bonaparte est l'élu de la nation et la voix du peuple sous mes fenêtres ratifie le plébisciste. Pour moi j'en reviens à mon Pascal: «Qui doit passer le premier? Le plus savant? Mais qui jugera? Il a quatre laquais: je n'en ai qu'un. C'est à lui de passer. Il n'y a qu'à compter et je suis un sot si je conteste.»
Ma cuisinière rentre, radieuse, Elle a vu leurs majestés:
—Monsieur a eu tort de ne pas venir. C'était bien beau, mais l'Empereur est laid.
—Comment, laid?
—Oui: il a l'air triste. Mais l'Impératrice est très polie: c'est une belle rousse.
Et elle veut dire blonde: tous nos malheurs, dirait Lecardonnel, viennent de ce que les peuples emploient des mots qu'ils ont négligé de définir.
Je ne le vois plus souvent, Lecardonnel; il vieillit beaucoup, et ne quitte guère ce tableau noir où il se prépare de la besogne pour l'éternité.
Vous souvenez-vous de ces pierres gravées que je vous disais préhistoriques? Je viens d'en trouver au Moulin Quignon un admirable spécimen. C'est un homme qui lutte avec un renne; le dessin est d'un naturel vraiment vigoureux.
Mais les savants officiels se refusent encore à admettre mes théories. Ils les disent maintenant contraires à la religion. C'est pour toute découverte, la seconde période. À la troisième on vous répond: «Cela est vrai, mais nous le savions depuis longtemps.»
La sobre lumière de l'automne picard nous fait ce soir un couchant gris rose sur lequel les pignons du Bourdois détachent leurs silhouettes pointues et grêles; les tours de Saint-Vulfran unissent toujours à la beauté sévère des nombres l'esprit de leurs balustrades ajourées; dans la cour voisine, la grâce précise de l'Hôtel de Vence me rappelle votre visage. Les couleurs et les formes me consolent des hommes; mais je suis quelquefois triste et j'aurais grand besoin de vous.
À bientôt donc, et comme nous disions au temps de notre courte république: salut et fraternité. La formule m'étonna jadis; je la trouve maintenant assez belle quand on la réserve à ceux que l'on aime.
End of the Project Gutenberg EBook of Ni ange, ni bête, by André Maurois
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NI ANGE, NI BÊTE ***
***** This file should be named 63271-h.htm or 63271-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/2/7/63271/
Produced by Laura Natal Rodrigues at Free Literature (Images
generously made available by Hathi Trust.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.